Vincent Tchorski ~ Trasenlai Lazones ~ 2020
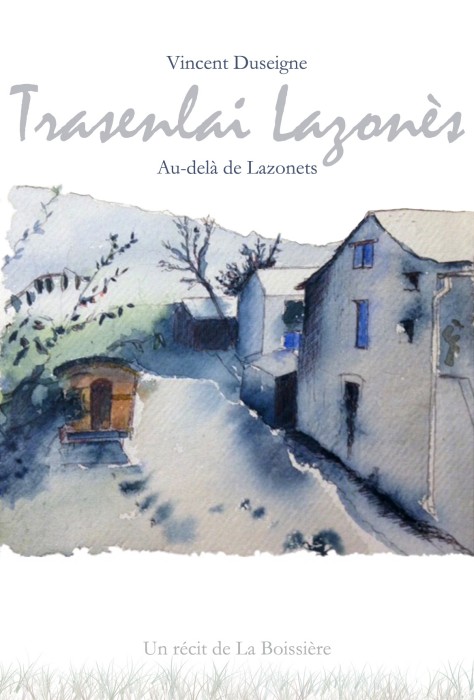
Trasenlai Lazonès
(Au-delà de Lazonets)
Un récit de La Boissière
Cet ouvrage est dédié à Dana Hilliot, à Vivre ici, à Iris de la Loupette, à Émy ; à nos parcours communs en quelque sorte. Comment aurait-ce pu être autrement ?
1
Prendre la route
Je suis arrivé à La Boissière.
Ce matin, d'épaisses nappes de brouillard noyaient les contreforts de la Haute-Loire ; dans une descente aussi abrupte qu'imprévue, le paysage rural s'est découvert d'un seul coup, c'était joli. De la sorte, j'ai attaqué la longue rampe descendante de Mayres, à 10%, tout doucement et sans problème à vrai dire. La fatigue magnifiée, tirée par l'exaltation, s'estompe en de courtes nuées insignifiantes. Aubenas fort chargée mais sans plus de soucis, à partir de Lablachère, j'ai monté la rampe à mon rythme, puis redescendu vers Thines très lentement : un compte-rendu de route, basique, plat, méthodique, guide Michelin insipide si possible.
Pause. Je désattelle Raymonde Deux, ma roulotte traditionnelle, sur le parking de Thines. Je pars évaluer toutes les largeurs de voirie jusque La Boissière. Ca ne provoque pas l'ombre d'un souci d'après les mesures. Je réattelle puis démarre. J'ai peur.
Très stressé, ce notamment par le manque d'espace inhérent à cette vallée encaissée et sauvage, un demi-tour adroit sur le parking de Thines, puis un second demi-tour salvateur sur le fameux tournant vers Tastevins, me permettent le cheminement ; ça fait plaisir. Je n'y croyais même pas. Sympathique imprévu. Comme quoi il ne fallait pas en perdre le sommeil depuis des mois.
C'est très-très-très étroit. Je dois régulièrement procéder à de l'élagage sommaire. Au-dessus du Pialet et vers le hameau nommé Vallée, c'est limite avec un rocher, mais ça passe. A Lazonès point dur de même, ça continue d'être positif. Ambiance première vitesse, cinq km heure maximum. Pas un chat, c'est bien.
Tout au bout et après les kilomètres de l'impasse étroite, j'arrive aux deux ponts, dont le premier est en angle droit, formant une baïonnette.
Ca ne passe pas.
Je me retrouve dans une situation extrême. J'avais mesuré que j'avais 2,5 cm d'espace disponible de chaque côté de la roulotte, mais c'était négliger ma longueur de convoi, ce faisant qu'un rocher m'empêche de me placer suffisamment dans l'axe. S'ensuivent quarante minutes de manœuvres dans un stress intense. Je n'ai à vrai dire aucune capacité à tout redescendre en marche arrière. Réellement : aucune.
Manœuvre désespérée. Je colle à gauche le mur du pont. Je ne peux même plus ouvrir les portes pour contrôler l'espace, je passe jusqu'au coffre dans la voiture en grimpant dessus les sièges, contorsions, quinze fois, avancée centimètre par centimètre. Prier, ne pas craquer.
Ca passe finalement à 2 millimètres, encore en est-il finalement
que je n'en sais rien.
Je n'arrive même pas à réaliser que c'est vrai.
Je suis en bas de chez Marité, remerciant le ciel et les oiseaux, le
souffle court, le coffre écrasé de stress.
J'attaque la pente de La Boissière. C'est dur, ça monte, c'est
très-très-très lourd. Il reste 100 mètres et le
défi s'achève.
Dans le dernier lacet précédant la Boissière, très étroit, la manœuvre m'oblige à mordre dans la terre. Je dérape, perd l'angle, dégringole en biais sur cinquante centimètres, à une distance proche du ravin, faramineuse, écrasante. Je mets tous les freins des véhicules à l'arrêt. Le moindre dérapage supplémentaire me plongerait dans les crevasses.
Je vais chercher les voisins et leur annonce que je suis en détresse.
Je vide toute la voiture pour gagner du poids. Au bout de quarante minutes, la température moteur étant redevenue correcte, ils descendent un vieux fourgon et me tractent avec une sangle, tout en même temps je tracte aussi. Ca a grondé sévèrement et... me voilà dans la cour de la ferme.
Les jambes tremblantes.
En y repensant, de nombreux mois plus tard - le recul aidant - l'épreuve
d'une vie ; arriver à La Boissière comme ça, des mots brefs,
saccadés, maladroits, un texte inchangé, recopié ici télégraphique,
presque ampoulé, le récit envoyé aux amis, des mots bouffés
de stress, arriver, peut-être en pleurer, non même pas, être
longuement ébranlé oui. Certainement, aujourd'hui encore.
N'importe qui de raisonnable aurait dit que ça ne montait pas.
Personne du hameau ne comprend comment j'ai pu passer.
Moi non plus.
Vivre ici a débuté comme ça.
Vivre ici était un partir d'ailleurs, La Boissière n'est autre qu'un refuge, désormais ouvert à autrui comme un ineffable présent, une vocation aussi indispensable qu'inconditionnelle. J'ai vécu de longues années au sein d'un emploi maltraitant. C'est probablement le sort de beaucoup de monde désormais, j'entends cette souffrance dans d'innombrables témoignages. Chaque jour qui passe dirige lentement notre société vers un comportement odieux, individualiste, déshumanisé, dénué d'altruisme et déconnecté de la réalité. Rien qu'une telle énumération est un coup de massue de plusieurs tonnes ; pour les gens normaux probablement non, mais pour une personne sensible c'est lourd à porter. C'est toxique même.
Après un parcours de cinq mois de recherches, j'ai opté pour une roulotte. La belle naquit en Ariège. Elle s'appelle Raymonde, enfin après boire et déboires, Raymonde Deux.
Un peu comme tous les collapso, j'ai lu Pablo Servigne, écouté Anthony Brault, bu les paroles de Cyril Dion sur la revue Next. Oui il est très tard, oui il sera difficile de contredire quelqu'un qui affirmera qu'il est trop tard. En attendant les médias se concentrent sur le fait que Greta Thunberg est Asperger. Que peut-on en avoir à secouer si tant est que ses paroles sont justes ? Le décalage devient de plus en plus difficile à soutenir, des fois on a l'impression que c'est un fossé et ça invite à se décourager. C'est dur, mais il ne le faut pas abandonner.
En cet instant clé, j'avais tout sous la main pour effectuer librement le choix du nomadisme, envisager d'ériger un petit potager, quitter mon mode de vie égoïste et destructeur de ressources, aider autrui sans contrepartie, sans position de sauveur ; juste être humain. C'était le moment. Même à ce jour, ça reste dur, ça fait peur, mais c'est maintenant : un présent abordable et limpide. Ça rend heureux en fait. Ça fait comme si le sang de la vie se vidait de ses toxines. Il m'est dit : tu es en difficultés, occupes-toi de toi-même. Soit, oui, mais si je m'occupe de toi, je m'occupe de moi, parce que je suis radieux que tu sois heureux.
Il reste de tout cela le ressenti - presque un gâchis - qu'on est vide de sens quand on n'est pas à sa place. Louvain-la-Neuve a été et reste d'ailleurs une ville entraînante. Ville utopique, c'est un lieu un peu décalé même s'il reste bourré de contradictions. C'est avec regret que je mets les voiles. En même temps, je crois que le travail salarié a fait beaucoup de mal et en ce lieu, ma place n'était plus.
Au fil de journées de plus en plus surchargées, déménagement, alléger, ne presque plus rien posséder, je cherche une vie, je prends peur, logiquement, invariablement même.
Au gré d'une errance sur un site d'informations mainstream, ça se termine désormais quasiment systématiquement par un commentaire dépité, puis l'extinction sans consulter le moindre papier. Cela devient aberrant à force de constater le décalage qu'il peut exister entre leur verbiage semi-publicitaire semi-propagandiste (voyez l'effort prodigué dans la modération des propos) et la vie que l'on mène. On ne se trouve carrément plus sur la même longueur d'onde ou est-ce une dystopie ? : ils sont en 5G, on est en légumineuses ?
Même constat désenchanté sur l'aspect global d'internet. C'est l'inondation et elle n'est pas forcément jolie à chaque coin de rue. Entre les GAFA, les commerçants de chaînes, les faux-trucs vides d'hameçonnage, les milliers et milliers de sites d'auto-entrepreneurs, les youtube monétisés de super-bons-conseils-creux, absolument tous veulent ton argent ou tes données personnelles. Quelle ne fut pas la surprise lors de deux malheureux jours de panne d'adblock ; purée, mais internet c'est ça en vrai ? La submersion de popup vendeuses abonnez-vous-promo (tous ou presque) : il reste plus que 22 heures (SFR), voire même 120 personnes consultent cette annonce maintenant (airbnb, booking). Booking étant probablement un des pires exemples d'ubérisation de la société, le site se faisant passer pour un très gentil outil de mise en relation, basé sur le social et la confiance. Du genre Blablacar ou Couchsurfing, même tromperie et guère mieux, mais passons.
Internet provoque à force l'émergence d'un sentiment déprimant. Absolument tout est déjà fait ou tout se voit maculé de commercialisation, de surcroît potentiellement trompeuse. Il suffit de se coller quelques minutes sur instagram ou sur google images. Cherchez Trolltunga. Internet vous répondra assez prioritairement les sites de masse-tourisme : tripadvisor, allibert-trekking, earthtrekkers, 518 évaluations positives, etc etc ; les volumes payants de banques d'images : 123RF, istockphotos, depositphotos, shutterstock, dreamstime, fotolia, et j'en passe. Insta propose 127.946 photos à peu près identiques (véridique), du violent tourisme de masse au bout du caillou surfréquenté. C'en est à tel point qu'un site spécialisé en répétitions regroupe les photos de masse, toutes identiques, afin de dénoncer la dérive. Un autre site dévoile dans la même veine les instafake (you didn't sleep here). Le tourisme de masse défonce, l'impressionnante liste fait mal de véracité. Nous sommes responsables.
Face à cette déferlante, on se sent diminué. Quoi que l'on fasse, la diction sur internet ne comporte plus d'intérêt et se retrouve forcément plongée dans une nuée de conséquences négatives : stockage-données en salle serveurs, action pesante sur l'environnement, les autres font forcément mieux, c'est nécessairement déjà fait, voire même passons au pire : ce qui n'est pas encore fait va soit obtenir un succès relativement proche du néant (le plus courant), soit provoquer ce qu'on appelle un " overtourism ". Allez pour les cas les plus généreux, la production sera reprise dans un faux-ami & bon-ennemi, le miteux Pinterest.
Au beau milieu de cette jungle abjecte se débattent des milliers de micro-entrepreneurs, qui essaient de lancer leur affaire avec une faible illusion de profits, mais aussi et surtout une réalité crue, celle que le milieu du travail devient vraiment difficile. Beaucoup essaient de s'en sortir comme ça, les déchets nauséabonds du milieu étant les influenceurs. En bref sur internet ils ont tout marchandisé. Ils ont même réussi à rendre marchand l'amour.
Ces propos sont peu encourageants. Pourtant dans ce flot mercantile dégueulasse, il se cache des îlots. Ils sont étroits mais bel et bien existants. C'est le plus décrié des réseaux sociaux - le plus immonde en soi - qui se voit légèrement dévié : l'hideuse hydre à face de bouc. La conception des groupes privés a permis l'émergence de véritables communautés, sans chasse à l'égo démesuré puisque de toute façon c'est privé. Là-dessus, un bon adblock ABP, cumulé à un bon ublock origin, cumulé à un bon ghostery, cumulé à un bon privacy badger, et voilà facebook réduit à une purée rampante.
C'est au gré des forums de transition 2030 que je suis arrivé au nomadisme écologique (je déteste écologique parce que ça ramène aux politiques, quelle horreur, parlons plutôt de mésologique : la relation des êtres vivants avec leur environnement). Que tous ces anonymes soient remerciés pour l'aide spontanée qu'ils prodiguent, car internet en venait à faire désespérer. Que cela sorte de facebook est franchement ubuesque et une douce revanche.
En cela, tout n'est pas à jeter aux orties, très loin de là. Ce qui est fait est fait, ce qui a été fait le méritait. Reste qu'il faut évoluer. En errance ensoleillée dans Louvain-la-Neuve, je voyais une publicité de magazine féminin (le papier qui sous-entend superficiel, commercial, psychologie, bref on se comprend), dont la couverture aurait pu être celle de cent mille autres identiques ; c'est toujours effrayant de voir cette masse disparate de magazines dans les librairies : qui lit ça ? Des milliers de papiers au rebut ? On s'en douterait quasiment quelque part, sans même plus d'étonnement tant on touche les confins de la déglingue. La couverture titrait " renaître ".
Comme évoqué précédemment, j'ai refusé le geste de l'itinérance et de la ferme d'être celui d'une crise, ni d'une renaissance. A la place de renaître, j'ai lu " se réveiller " et j'ai trouvé ça beau.
La transition appelle à quitter et je suis très nostalgique de Louvain-la-Neuve. Pas que d'ailleurs, nostalgique des années Belgique. Ce n'est pas à jeter, ce qui justifie pleinement l'absence de crise ; c'est donc construire une autre chose. L'espérance est une conviction. C'est cette croyance - qui fut souvent un peu juste - qui a désormais basculé de l'autre côté. Que l'on regarde en arrière ou en avant, ça reste gracieux, et c'est ça qui est important.
Je prends le chemin de La Boissière, je tracte Raymonde Deux. Vous vous inquiétez pour moi. L'inconnue est gigantesque. Renversons ces paroles, c'est moi qui m'inquiète pour vous.
Parce que vous resterez soumis au travail salarié, une gangrène qui ravage l'existence de certains, selon le plus ou moins de malchance que l'on arrive à éviter (voyez que je ne parle même plus de chance, c'est un peu odieux car nombreux sont ceux qui rêveraient d'avoir un emploi. La souffrance endurée dans le travail salarié m'a fait atteindre un point de non retour). Parce que de manière indifférenciée, vous serez soumis à la politique, à l'administration, aux banques, à la proximité des pesticides épandus insidieusement sur les champs alentours, aux produits manufacturés, au déluge d'ondes électromagnétiques, à l'inhumanité, aux milieux urbains provoquant la grande déglingue et la violence, à la manipulation médiatique se généralisant à vitesse effrayante, promouvant désormais sans pudeur la dictature capitaliste. Oui j'ai peur pour vous.
Vous dites que je suis courageux d'avoir choisi cette vie. Renversons ces paroles. Ce n'est pas courageux, c'est lâche, parce que c'est une fuite, peu grand chose d'autre que ça : baisser les bras, ne pas ouvertement combattre.
L'inquiétude est une ombre. Elle ne va rien changer si ce n'est assombrir un tableau, ce dont personne n'a besoin ; ça empêche de voir la fin du tunnel, voire même de remarquer que le tunnel est agréable en fin de compte.
Le mode de vie adopté provoque une pauvreté à multiples facettes. Une pauvreté matérielle surtout et sur tout. C'est un peu comme quand on était en bivouac minier - un peu amélioré malgré tout - mais certes beaucoup de choses manquent au quotidien. Quelque part tant mieux, c'est un retour à l'essentiel : chaque objet a sa valeur. Ce sera aussi et sans ambages une pauvreté intellectuelle. Plus de sortie chaque week-end, plus de voyage long-courrier, plus de compte-rendu de dingue. C'est indéniablement un deuil, soit, mais tout doit mourir pour laisser place à autre chose : l'hiver meurt pour laisser place au printemps ; d'ailleurs la symbolique n'est-elle pas de bruler le bonhomme hiver ?
Hormis de s'éloigner de la dérive de la société,
qui remplit d'effroi un nombre croissant de personnes, le deuil est de quitter
en partie la vie qu'on avait ensemble. Ça, honnêtement, c'est très
dur.
Ce qui fait tenir dans cette tempête, c'est la solidarité. On peut
résister (comme on peut) à l'aliénation de notre société,
n'est-ce pas ce que nous essayons tous un peu de faire ? Il reste ces subterfuges,
loin d'être parfaits, tout du moins c'est déjà ça.
Cependant l'absence d'humanité c'est mortifère. Combien ça
rend heureux de donner, de recevoir, de remercier ? Sans rien attendre, sans
rapport de domination, sans sécurité affective : non rien, juste
comme ça, sans compulsion, parce que c'est bien à ce moment-là,
parce que c'est bienveillant, parce que c'est nécessaire.
Ne nous inquiétons pas et puisons dans la vie tout ce qu'elle peut nous offrir, tout ce que nous pouvons rendre à autrui, ainsi que les moments précieux que nous construisons ensemble.
Car si ce changement permet de reconstruire une (assez large) fraction de la vie qui était toxique - c'est tout de même né de là - il s'avère aussi qu'il s'agit d'entrer en désobéissance fertile.
Reprenant un commentaire de " Nikopol ", un anonyme sur un espace de défense intellectuel, celui-ci évoque : Le problème reste toujours de trouver les modes d'actions qui auront une chance d'aboutir à quelque chose, ces modes d'action qui peuvent nous faire avancer d'un petit pas à chaque fois. Agir d'accord, mais comment agir ? Brandir des banderoles en respirant des lacrymo ? Hurler des slogans sous les coups de matraque ? Jeter des pavés et se manger une balle en caoutchouc ? Marcher de Bastille à Nation encadré par des syndicats ? Occuper des ronds-points et emmerder les autres ? Tout cela ça sert à quoi en fin de compte ? Le système poursuit sa route et ne dévie même pas.
La désobéissance civile n'étant plus suffisante, à défaut de preuve du contraire, il faut pousser plus loin. Une des voies, la désobéissance fertile, décrite par Jonathan Attias : créer de nouvelles sociétés qui ont comme objectif absolu de vivre au plus près de la Nature pour en régénérer la Vie, et ce quoi qu'en dise les lois existantes.
Dès lors Raymonde ma belle ne constitue pas l'itinérance d'une vie identique exportée sur des roues ni une pseudo crise d'adolescence de la quarantaine. C'est, même si c'est minime, couper les vivres autant que faire ce peut aux dangereux psychopathes qui nous gouvernent. L'on pense en ces mots bien sûr, aux révoltes du moment, ou des quelconques moments d'ailleurs. Mais, il est facile de vous assurer au vu de la position stratégique que j'ai eu la chance d'occuper durant 12 ans, que le pouvoir local est fortement empreint de sociopathie. Si l'on prend la définition de base : trouble mental caractérisé par une indifférence vis-à-vis d'autrui. Ca fait peur, c'est avéré et c'est sincèrement anormal, si ce n'est inacceptable.
Leur couper les vivres signifie les empêcher d'exister de cette façon, car plus aucun espoir ne peut naître d'eux : ne plus se soumettre à l'impôt essentiellement, c'est un défi de taille. Autant qu'on y arrive, dehors l'impôt sur le revenu, le foncier, la taxe d'habitation, la TVA, les ordures ménagères, et j'en passe. Que cela inclut ? Vivre sans argent, donc sans consommation de produits manufacturés, sans production de déchets non compostables, sans salaire, en autonomie, en partage, en échange, en don, sans avion, sans autoroutes, un compte en banque quasiment vide, un logement petit, essentiel, partagé. C'est un chemin énorme.
S'ajoute ne plus voter. La confiance est totalement rompue. On ne peut rien attendre de ceux qui nous ont délibérément foutu dans la merde. Au vu de ces aspects, commençant à se répandre comme une trainée de poudre, " ils " feront tout ce qu'ils peuvent pour vous en empêcher. Leur première arme est la loi ubuesque. Leur seconde arme, éventuellement encore pire, est la falsification, c'est-à-dire le monstre au regard de doux : greenwashing, mensonges écolos, verdissement marketing, bêtise par automatisme, inertie administrative.
Raymonde est frappée de TVA lors de son achat, je paierai une taxe de roulage ainsi que du carburant, je ferai un mois ou deux de travaux dégradants afin de payer les quelques charges, ce livre est hébergé sur internet. Autant le dire dès le départ, la démarche n'est pas pure. Ça va être très dur. Qui le contredira ? Mais bref, chaque ressource qui leur sera enlevée sera déjà, même dérisoire, cela qu'ils ne pourront exploiter. Ça donne un sens à la vie - essayer, voire peut-être réussir d'approcher cette visée - et en tout cas un objectif très féroce qui permet de moins souffrir face aux dérives angoissantes de la société.
Nous ne sommes pas en démocratie. Dès lors le but est aussi de construire du lien social, aider et donner. Personne n'est réellement sauveur de l'autre, mais qu'à cela ne tienne, cela ne permet pas d'effacer la solidarité. Des moments très importants de mon existence ont été jalonnés par la solidarité des autres ; ce qu'ils m'ont donné sans compter. L'émotion n'est pas absente d'y repenser encore aujourd'hui.
L'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir dit Bernard Werber.
Profondément éprouvé, stressé, mais plein d'entrain,
il fut un jour où enfin, je pris la route vers La Boissière. Demi-esquisse
d'une vie sans domicile. Voilà l'histoire, le petit pont, les millimètres.
Maintenon juste avant mon départ avec la roulotte, ville médiocre,
au bord d'une rivière, je mords dans mes inquiétudes, je pense
à mes pauvres collègues torturés, je songe à la
société ; sommes-nous relativement nombreux à être
numéro un sur les croquis d'Arthur Keller, totalement inconscients de
l'effondrement socio-économique anthropique ? Ici en cette grisâtre
ville de lointaine banlieue voire même cité dortoir, la réponse
est oui. Ça va être choquant. Quelle sera l'inquiétude lorsque
les situations globales vont se dégrader vers une courbe descendante
difficile à maîtriser ?
Étant largement numéro quatre depuis des lustres, conscient et proactif, je vois les flots lents de la rivière : et si nous inventions le numéro cinq ? Se mettre volontairement tout en bas afin de reconstruire les fondations ? Irréaliste, utopique ? Certes qui pourrait en dire le contraire ? Il n'y a guère de réponse et plus que des questions tant on se sent démuni face à l'immobilisme sociétal.
Certains estiment que je me suis fait embrigader dans une secte, notamment et surtout sur les questions d'un effondrement imminent de la structure économique de la société thermo-industrielle. Puissent-ils avoir raison, car la chute sera douloureuse ; si elle peut s'avérer moins brusque, ça ne serait pas un mal. Quelque part désormais, ce qui (me) compte est d'œuvrer pour un monde meilleur, sans prosélytisme : chacun fait ce qu'il peut. Je ne parle même plus de ce qu'il veut. Imaginez-vous des gens plongés dans le travail salarié ne compensant pas par une intense vie de loisirs ? Impossible. C'est assez directement dépressif et dénué de sens.
Dès lors, j'ai réfléchi - gambergé en errance obscure, quelquefois sombre de mélancolie, je me suis désorienté - dans une immensité de possibles. Comment donner un sens à La Boissière, comment être soi-même une vie meilleure ? Sans être présomptueux pour un sou (petit problème de confiance en soi), j'ai établi mon existence future dans cet espace de possibles en trois grands axes et en fin de compte, un peu tout est destiné ouvertement à y figurer.
Premier axe : l'autonomie alimentaire. Faire de la nourriture, ce n'est pas facile. Le projet consiste à cultiver paisiblement, au gré des saisons, et dès lors se séparer de la nourriture manufacturée. Le chocolat, le café et le riz figurent parmi les plus mauvais aliments en matière d'empreinte écologique. En somme c'est compliqué.
Ça semble à ce point hors de portée.
Deuxième axe : régénérer. Désormais, je calcule les grosses dépenses carbone. A chaque dépense, je me suis imposé de compenser. En quelque sorte, imposer n'est pas le bon mot : c'est plutôt le marqueur d'un souhait vif. En résumé vu de loin, ça signifie que si je fais un trajet de 40 kilogrammes Co2, je vais planter un équivalent permettant de régénérer.
Avant tout, je songe à planter du fruitier sur de nombreuses terres en déshérence, afin que tout un chacun puisse en profiter plus tard. C'est niais, mais en résumé cela ouvre un état d'esprit : apprendre, agir, quand bien même ça implique une certaine forme de désobéissance civile.
Troisième axe : aider. Outrepassant que l'effondrement sociétal sera graduel ou brusque, puissant ou étagé en mille millier de petites destructions locales - qui saurait le dire sans charlatanisme, il faut et faudra du monde pour aider. Sans détour l'axe le plus important pour moi, bien qu'absolument indissociable des autres.
C'est aussi parce que la solidarité locale s'est plus ou moins éteinte. Bienveillance gratuite, ça fait tant de bien. Aider les vieux, aider les gens qui seront perdus, dans le besoin. Les survivalistes prévoient un Mad Max Trois. Pourquoi pas... Mais ce n'est pas en cela que je veux œuvrer.
Les routes du cœur sont longues. C'est en ces matins frisquets, peu après Maintenon, ici au bord de l'Yonne à présent, que je sais intimement que je n'appartiens plus à avant ; ce désormais éloigné monde du travail n'existe plus : il me parait désuet et repoussant. Les ponts sont coupés. Non pas une vengeance, inutile et stérile, mais le juste retour des choses qui s'écrit entre les lignes ici à Pont-sur-Yonne. Les comportements odieux, malsains et répétés, ont généré une énorme prise de distance. En réalité ces paysages ont toujours été ce que j'aime du fond du cœur. La seule nuance est qu'auparavant ils étaient une brève échappée pour survivre, désormais ils sont la vie. L'existence d'avant est totalement déconstruite. La reconstruction est longue, petite brique par petite brique. Elle avance, comme une longue série évoquant presque moqueusement l'épisode 1325 des feux de l'amour ou de la croisière s'amuse. Soit, c'est tout sauf de l'immobilisme. En fait c'est déjà bien.
Au sein de ce parcours, philosophique peut-être, qui saurait-le dire, puis ce jour de montée à La Boissière - le pont, le lacet - j'ai reçu de plein fouet un véritable miracle du quotidien. Les voisins m'ont tiré d'une situation périlleuse. Eux aussi, parmi d'autres, permettent d'avoir la conviction que ça valait le coup de faire ce choix initialement difficile, déconstruire une vie aisée mais malsaine en vue d'un espéré-meilleur plus respectueux, plus humain. Sans héroïsme aucun, nous sommes désormais nombreux à porter ces choix.
Là-haut désormais, ce domicile permet de diminuer drastiquement la consommation de carburant (divisé par 20 aux premières estimations), et de commencer à vivre avec moins d'argent.
Au 21 décembre, le soleil passera parait-il derrière la cime de l'Everest de Thines à 13h45. Comme le dit Madeleine, faudrait la dynamiter cette montagne ! Solution simple ma foi ! A Mayres, les monts ont pris leurs atours d'automne, c'est beau à tomber. C'est ceci la vie désirée. Même si c'est dur, même si c'est long dans son évolution, c'est ça qui emplit le cœur d'une lumière surpassant tout hiver.
Dans l'attente de posséder la ferme, presque longue comme la salle d'un médecin durant une épidémie de grippe, la vie en roulotte permet d'épouser la nature, s'adapter, écrire ce récit durant la pluie. Pas de frigo, pas de douche hormis la rivière, et pourtant le quotidien fonctionne. Mes voisins ont abandonné leur repas pour me sortir de la détresse ; j'ai tiré des nouveaux voisins-voyageurs des embarras ; à l'aube des oiseaux se sont battus sur le toit de la roulotte ; dans la nuit, Émy, une chienne trempée est venue chercher abri. Quoi d'autre à dire que c'est beau comme un refuge, cette Ardèche rude que l'on se surprend à aimer de plus en plus.
Cet apaisement, cette sérénité, cette rassurance, cet espoir de plus en plus fou, c'est le plus grand cadeau que je peux offrir à ces dizaines de personnes qui m'ont protégé ces derniers mois ; c'est aussi tout ce que je dois rendre à la vie (d'aucuns diront que ce n'est pas nécessaire), et pourtant c'est ça qui fait plaisir : offrir, partager, consolider. Quelque part, outre solidifier les fondations de ce désir, c'est ce qu'il reste à construire, le bonheur est dans ce pré.
Inévitablement ça s'est dégradé. C'était prévisible. Trop précaire, trop fragile.
Au gré d'un petit envoi quotidien, j'écrivais à Nadia ces derniers jours : au fil de la journée, j'ai vu un être humain, un chien, vingt cochons et une oie. Une autre simple série de constats permettant d'introduire cette plongée serait : consultant la météo, j'ai vu que les températures vont chuter d'un degré tous les jours durant dix jours. Je me lave dans la rivière, je vais aux toilettes dans la forêt, je fais la vaisselle dans le bassin de récupération d'eau de pluie, j'ai un chauffage rudimentaire, le système de chauffage et la cuisine génèrent plein d'humidité, je vis dans une roulotte, le sol où je suis posé ne m'appartient pas.
Automne, couleurs d'hiver sur le plateau, hier il y avait un vent terrible, aujourd'hui un brouillard à couper au couteau, le tout entrecoupé de pluie glaciale. J'ai ramené Émy la chienne border-collie chez Laurent son papa, elle est redescendue aussi sec dans la nuit. Lors du trajet d'une dizaine de kilomètres, je n'ai vu personne.
Lorsque j'étais arrivé " ici " le 19 août, Yoan, un habitant rare à l'année, m'avait dit : l'hiver, il faut avoir la niaque. Souvenir clair de ses paroles, tout en ne saisissant pas trop ce qu'est de la niaque, mais il est à supposer - on s'en doute sans trop faire le malin - qu'il s'agit d'un fort courage.
Et bien en fait l'hiver ici, c'est chouette, même si je l'admets ce n'est pas encore l'hiver novembre. En résumé, il n'y a personne, il y a un sanglier, oh tiens ah oui ça allait vite, il n'y a personne et il n'y a personne ; il pleut, il fait dégueu, il fait froid, excusez-moi du peu mais il faut se laver dans la rivière et ça caille sa mère, tout en ajoutant qu'il y a du vent, il fait noir, tu es seul et tout seul.
Faut-il être complètement frappé pour aimer et / ou, faut-il forcément tomber dans un tel extrême ?
Clairement c'est un retranchement que je pourrais compenser, notamment par des séries de conforts que je ne saisis pas. Mais pourquoi ? A vrai dire, j'apporte plus de questions que de réponses.
Tout cela a commencé par un temps archi-dégueu rencontré sur les abords du Cézallier, qui m'avait plongé dans un auto-stop guère agréable en destination du Lioran et de Saint-Flour. En ce temps - et comme combien de fois d'ailleurs, je ne compte plus - nous (deux voyageurs) avions été hébergés ; quasiment un sauvetage, par un fromager du Fau, puis transportés par une famille salvatrice et accueillante, dont j'ai gardé les coordonnées ; l'homme exploitait du bois à Fretma sur le Méjean, puis s'était salement pété le genou. Bref de racolage de souvenirs, possédant une face sombre d'ailleurs, j'étais passé non loin du village de Dana Hilliot, puis dans la foulée, lui avait commandé son livre " vivre ici ".
Edifiant ouvrage. L'homme, assez misanthrope, quoique… mais surtout profondément
meurtri, construit une immense litanie sur les campagnes reculées qui
se meurent, désertifiées et devenues morbides (l'homme est du
Cantal) : ces coins sans âme-qui-vive, blessés par le froid, griffés
par le vent, plombés par des nuages lourds. Soit complètement
masochiste, il en a délibérément fait son choix, soit les
faits sont là et plus curieux alors, il aime. Or, à le lire dans
un insondable récit de meurtrissures, il appert qu'il n'est pas maso.
Il aime, non pas attaché à la désolation, dans un inexplicable
et d'ailleurs inextricable récit de soi, lequel mène à
conclure qu'ailleurs que ça, on n'est pas bien.
Et finalement, finalement… que dire d'autre que son texte m'avait fameusement
remué, parce que dans son Cantal que je ne connais à ce titre
pas, j'y voyais mon Méjean, mes Cévennes, ma Lozère.
Du coup je ne sais même plus dire si mon mode de vie actuel est un complet revirement, ou bien une simple continuité. Que dans les virées avec François ont toujours autant compté les mines, certes, on ne l'efface pas, mais aussi les solitudes et les paysages à ce point attachants de toutes les Lozère du coin. Que dire sur le fait que je suis parti ? En réalité tout le monde s'en fout que je sois parti, c'est normal, c'est bien d'ailleurs. Les lignes se croisent, s'entrecroisent, on se rapproche, on s'écarte, mais on ne s'oublie pas. Certainement pas.
Alors que je ramassais les châtaignes - toute la journée durant, je vais les manger l'hiver : donc je les débogue, les trempe, les épluche, les cuit, etc etc c'est laborieux - les doigts dans les épines, je me disais : là maintenant tu es dans une forêt abandonnée par les humains. C'est dur d'accès. Plus personne n'est venu en ce spectacle naturel depuis des lustres. Les terrasses sont splendides, elles témoignent du labeur des générations très-passées, c'est intact depuis 1930 au gré des exodes ruraux successifs, c'est fou, c'est vide d'humain ; pourtant que de soin, que de dur travail des hommes. Voilà c'est oublié parce que désormais de nos jours, on a autre chose à faire. C'est saisissant, un ermitage aux mille teintes de feuilles mortes, et toute la journée comme ça, vaquer aux marrons dans les couleurs d'automne, chatoyantes et magnifiées par la pluie, ça fout un sacré coup.
Ce lieu reculé, il pleut, on en vient à songer qu'on déteste les humains. Mais non, c'est faux et c'est injuste. Les humains ont été extraordinaires avec moi ; quand je repense à cet homme qui m'a hébergé alors que j'étais au bout du rouleau sur le causse Campestre. Non c'est injuste de laisser faire ce sentiment de misanthropie. C'est simplement qu'être seul, là, dans la forêt, c'est bien, aussi.
Alors du coup, ramassant inlassablement, je me suis perdu dans un dédale de questionnements, et au plus je n'y récoltais aucune réponse, au plus je trouvais ça quelque part assez étrangement satisfaisant.
Avant même les années deux mille et alors que j'étais ravagé par le service militaire, j'écrivais un journal appelé absences souterraines. Cette sorte de psychanalyse de comptoir essayait de me sauver - sans réel succès. Ca a duré ainsi jusque 2005, puis d'autres palliatifs sont venus se greffer, pour tenter de survivre dans un monde malsain. Cette maladie, c'est le monde du travail. Alors soit je n'ai vraiment pas eu de chance, soit cet univers n'aurait pas dû devenir comme ça. Le travail a décimé une certaine part de ma vie, par le manque de temps permanent, l'aigreur et les colères, les terreurs nocturnes, quelquefois même des passages non éloignés de la dépression : tout en essayant sans cesse d'inverser la tendance par des espéré-jolis processus créatifs, des projets altruistes, tout ce qu'on veut. Ca tenait quelques mois quelques années peut-être, mais cycliquement, le travail venait ravager. Concluons que ça a probablement été une certaine part de malchance ; mais l'on ne peut s'en foutre. Ca, aucunement.
Alors désormais d'être un peu seul, un peu débrouille-toi avec la forêt, un peu sous la pluie, ça fait bizarrement du bien, parce que de manière indéniable, de ramasser de la châtaigne, ça construit un équilibre de vie, tout autant que les coings, les alises et bon, soit pas grand-chose d'autre puisque nous sommes en fin de saison. En somme surtout, ça donne une place d'être humain parmi la forêt - pas au milieu des voitures et des gens réellement vicieux qui déversent leur hargne du monde avec leur formulaires déconnectés de toute réalité. Il me faudra longtemps, très longtemps, pour guérir du monde du travail, ou je n'en guérirai pas, mais tout du moins désormais (hormis le terrible transport de Raymonde), les terreurs nocturnes, c'est fini, la haine d'un peu tout, c'est fini, le manque de temps, c'est fini. Parce que j'ai le temps et je suis un être humain.
Il est très proche de dire que c'est du gâchis, tout comme la désertification du Cantal peut l'être et comme tout cela a finalement rendu le " vivre ici " difficile. Certes ce n'est pas spécialement une parade pour dire que je suis le plus fort et que je résiste bien au froid et à l'humidité. Non c'est plutôt une réminiscence, celle d'une soirée récente à Namur, dans un complexe cinématographique que l'on qualifiera de à la mode. Des jeunes tapaient dans un punching-ball, qui inscrivait en rouge des valeurs de frappe ; ça caracolait hallucinant, des mecs de quartier habitués à taper. Et dehors des gens qui parlaient un langage que je ne comprenais même plus, des notifs, des snapchat, des visu et caetera, s'extasier devant la dernière toyota hybride. Et j'en passe. Je me ressens extrêmement loin de tout ça, fatigué, heureux, en communion avec la forêt en automne. Ces baquets de vie d'avant : notamment crier et voir noir, c'est je le suppose au regard d'aujourd'hui, la conséquence d'avoir été empêché d'être humain.
Lorsque j'ai croisé des destins en souffrance, j'avais une position professionnelle privilégiée pour ça, on m'a réellement empêché de les sortir de leur trou ; ils avaient besoin d'une petite impulsion, tout comme moi j'ai pu être hébergé et aimé simplement parfois, souvent même. On m'a sans arrêt ramené aux formulaires insipides voire même la négation pure et simple de leur douleur, à piétiner des deux pieds toute forme d'empathie, j'ai sans arrêt triché pour les sortir quand même. Ca a beaucoup marché en fin de compte (et fort heureusement), mais le fait de renforcer systématiquement la machine de contrôle, celle empêchant d'être un humain de cœur, a provoqué une réelle dégradation. On peut écrire tout ce qu'on veut, quand on subit cet acharnement professionnel, on ne peut réellement se poser les fesses sur un équilibre - ça ne marche pas. Même le soir ou ce qu'il reste de vie vraie rongée grignotée le week-end.
Avant-hier, Danièle, une éleveuse de brebis, s'exclamait : on me dit que je ne pars jamais en vacances, mais je suis au pays des vacances. Interpellant. Elle avait mal au dos, dimanche, elle bossait.
La forêt fonctionne comme un refuge. Soit, on n'est pas nombreux dans le coin, je n'entends pas grand monde s'en plaindre d'ailleurs, mais certainement quand solidarité il y a, elle est réelle. Probablement, cela émane du fait qu'on partage un milieu de vie rude. Ca n'en fait pas de nous des durs à cuire, mais plutôt des précautionneux. On fait très peu mais on le fait bien.
Hier ainsi, je me promenais vers le mont Perrier, un espèce de mamelon schisteux duquel on s'étonne même qu'il ait un nom. C'est un coin de nos campagnes, sans plus, beau, comme partout en fait. Ce lieu m'a fait surgir une puissante réminiscence du Méjean et l'orée de ce texte d'ailleurs. Sur cette rude terre bataillée par les vents, austère et semi-désertique, y'a pas la foule pour ainsi dire. Ce qu'il y a été vécu fut simple et fort. C'est probablement ce qui ressort ici de cette Cévennes d'Ardèche où je suis venu poser une ancre. En réalité je ne sais plus trop ni le comment ni le pourquoi - la terre continue de me faire peur tant elle est puissante, la nature y est majestueuse et impétueuse - le fait d'être un humain lent, simple, modeste fétu de paille parmi les arbres, me remplit d'un gigantesque apaisement. C'est peut-être ça qui, hormis toutes les duretés qu'on endure, provoque qu'on aime " vivre ici ".
Vivre. Dans un an ; automne prochain comme un renvoi vers un infini si éloigné : que va-t-il se passer durant tout ce temps là, une année ? A chaque jour sa peine, et d'ailleurs j'ai rarement autant traversé le quotidien au jour le jour. La nuit tombe de plus en plus tôt : je ne sais pas trop ce que je vais faire, ne parlons qu'à demi-mot du froid qui va de plus en plus m'empêcher de me laver dans la rivière. On verra demain. L'hiver ouvre ses portes. Pour sûr, les arbres à pain vont me manquer.
Les châtaigneraies m'ont empli d'émerveillement. Quelles sont secrètes et belles. Je suis ce que je mange. Chaque jour une poêlée de châtaignes. Je suis la forêt. J'aime lui appartenir, tout insignifiant que je suis. Les feuilles tombent, dans quelques semaines le spectacle sera éteint, ça deviendra morne et triste. Deviendrais-je de même que l'hiver une âme en dormance, en attente que les terres se réchauffent, vais-je envoyer mon sang dans les racines, caché, terré au fond des sols sombres ? Désormais plus rien ne me touche, engourdi de froid. Je m'en fous éperdument, car aujourd'hui a été une belle journée, le soleil a inondé la vallée quelques dizaines de minutes. Le reste m'importe peu. Etrange mélange entre laisser-aller et lâcher prise ; tout va si bien.
Cela devait arriver, aujourd'hui j'ai vu zéro personne. Un grimpereau,
des mésanges, un chien, une salamandre, un orvet. Le chien, c'est Émy
en fait, elle n'est même pas à moi. C'est une terre d'ermitage,
de reclus et de silence. L'hiver qui s'approche enveloppe l'âme et ralentit
les gestes. On est bien comme ça, même s'il fait si seul : pas
d'interaction, vivre avec soi comme son unique repère. Lorsque le printemps
frappera à la porte et que l'agitation du monde montera la petite route,
même au-delà de Lazonès, alors ça donnera un sentiment
étrange. Peut-être l'idée que ça devrait être
tout le temps l'hiver, mais sans regret non plus. Curieux équilibre fragile.
Avant, dans la vie d'avant, qui est la même vie que maintenant mais il
s'est passé une rupture - une cassure - j'attendais 16 heures. Pour être
sorti de cette forme de petit enfer, ni plus ni moins, banal quotidien, voilà.
J'attendais vendredi, pour une trêve, dimanche soir étant bien
pire encore que le lundi matin : purgatoire, l'idée d'y retourner. J'attendais
le congé, j'attendais la mine, j'attendais la randonnée. On est
tous comme ça. C'est normal. C'est la vie qui nous rend comme cela.
Désormais je n'attends rien. Je n'attends pas le printemps, je suis
hiver, amorphe, caché sous deux couettes et je suis bien. Il fait tellement
noir dehors. Je n'attends pas l'amour, je n'attends pas les temps meilleurs
je n'attends pas les vacances. Les temps sont bons comme ils sont, même
si je me suis coupé en épluchant la châtaigne, même
si le tan est incroyablement revêche. Y voir une désillusion et
un manque flagrant d'espoir - aigri, hargneux, distant, terne - est une distance
de la réalité, car c'est avant tout se satisfaire pleinement de
ce que j'ai ; or ce que j'ai aujourd'hui, c'est d'être minuscule dans
une forêt majestueuse. Oui ça n'a pas le sens ni le destin d'une
personne célèbre. Plus m'en importe, éloigné du
monde, un monde qui m'a fait mal quelquefois. En somme ça fait un mois
que je n'ai plus ouvert le moindre journal d'information. Désintérêt
le plus complet. Qu'est-ce que tout cela pourrait bien
changer ?
Il est vrai qu'il pourrait être valable de s'orienter vers un destin politique ou militant ou engagé ou qu'en sais-je : essayer de diriger le monde vers un meilleur. Je peux comprendre. Mon regard s'est porté au loin, vers les steppes du Méjean, le mamelon bleuté très éloigné du Gargo. Il fut un temps où je parlais de géopolitique, mais ces paroles n'ont strictement-absolument rien changé au monde, elles ont fabriqué angoisse de vivre. A quoi bon hier comme demain ? A quoi cela a servi ? Désormais au Méjean tout comme au plateau, là juste au-dessus de mon habitat - austère et venteux - ces considérations n'ont aucune importance. Et tant mieux. Ca apaise. C'est apaisant oui de vivre sans.
Tout s'est passé comme ceci, sur des impulsions immédiates alors que ça aurait du prendre des mois d'inquiétudes. Ca s'est fait naturellement, les rouages se sont enclenchés, de toute façon je partais, c'était décidé, c'était salvateur : une bonne somme de hasards et de conjonctions de bons moments ; mais non il n'y a aucun hasard, ça devait se passer comme ça. En février, lorsqu'ils ont vraiment été trop loin, j'ai pressé mon AZ-5, l'ultime manœuvre, l'arrêt complet, ils ont explosé en paroles furieuses, je n'ai pas rendu la pareille. Au départ j'avais peur, c'est normal, mais ce qui fut était bon. Sans leur agressivité, sans leur méchanceté, je ne serais jamais là aujourd'hui. En somme je devrais les remercier d'avoir été aussi profondément mauvais dans leur cœur. C'est eux qui ont permis ça. C'est probablement ce processus qui a provoqué l'absence de haine. Que cela est complexe, mais n'y pensons plus. Il faut tirer un trait.
Cette nuit les sangliers sont venus. La lune donnait une lumière forte juste au-dessus de la montagne. Ils ont chahuté dans les pentes emplies de genêts à balai et de bruyères. Ils sont restés de l'autre côté de la rivière mais mazette tout de même, que c'est impressionnant. Les chiens ont hurlé, ceux des voisins je veux dire. Émy n'était pas là, sinon elle serait rentrée dans la roulotte. Puis ça s'est calmé, mais le sommeil n'est pas revenu tout de suite. La lune s'est effondrée derrière la montagne et c'est devenu tout noir. C'est la géopolitique du sanglier, en fait désormais c'est ça qui compte.
Ce matin, même pas fatigué, peut-être parce que des évènements comme ça font partie de la vie, il faisait remarquablement humide. Monté sur le plateau, la température est descendue de 4 degrés. Les terres austères; grises, pelées, était engluées d'un brouillard collant et tenace. Personne à la ronde jusqu'à Planzolles, où seuls deux mecs, courageux ou obligés, changeaient un poteau électrique brisé. Ca n'offre pas grand chose des terres comme ça, ce notamment où durant l'hiver - particulièrement quand il est collant et sans neige - la seule chose qui compte est le moral. Peut-être est-ce à considérer comme un demi-cas de psychiatrie ou l'émergence d'une semi-secte guidée par Hildur Guðnadóttir, de prétendre presque sentencieusement ce que c'est chouette quand c'est triste comme ça. Y'a pas à dire, ça donne de la valeur authentique au printemps à venir ou à autre chose qu'en sais-je ; si ce n'est que j'avais prêté Without Sinking à une connaissance, laquelle m'a finalement avoué avoir tenu dix minutes. D'accord. Soit... il est peut-être indiqué de songer à des soins, sourire au coin des lèvres en y pensant (car je rigole tout seul comme un idiot et le froid forme des nuages de vapeur). Vous êtes chez vous, silencieusement au chaud, vous êtes bien, je suis sous deux couettes, la pluie frappe la toiture, je suis bien.
Il s'ouvre un fossé entre les gens venant en Ardèche en été, en vacances, et les gens du plateau en hiver. Qu'en dis-je, il s'offre un fossé, on ne se comprend plus quelque part, mais c'est tant mieux. Ils sont bien comme ils sont et c'est un bienfait. Nous qui ne revendiquons rien, juste la paix (et c'est d'ailleurs bien la première fois que j'évoque un nous, comme une appartenance), nous souhaitons - pas tous mais nombreux - vivre en reclus. Votre monde va trop vite, il fait trop de bruit, il nous plonge dans une souffrance poisseuse qui tombe comme un brouillard moite et froid sur nos sentiments, même si souvent ça s'estompe ; c'est à ce titre et après les sangliers d'ailleurs, je repensais à cette chanson de Françoiz Breut, vingt ou trente mille jours (c'est une vie en fait, qu'elle évoque par cette même pas demi-métaphore) : mais zut-flute-fourte, c'est si court ! Quand on y pense, mais qu'est-ce qu'on attend un vendredi soir pour ceci-cela après une semaine complète visqueuse ? Il n'y a pas le temps. Une coulée de brouillard voir les brumes ramper, avoir froid, partir aussi à un moment donné, car ça fait du bien.
L'écriture glisse vers de plus en plus austère, elle devient le plateau, vide, longue et inutile. Oui, l'aventure est terminée. Passer de ferme en ferme tel un petit oiseau migrateur, traverser les contrées (la belle Haute-Loire) avec la roulotte Raymonde : l'été, la liberté, le rêve idyllique aussi, celle d'une certaine légèreté. C'était bien, sans nul doute, mais là désormais s'ouvre la vie un peu plus grandie, affermie, avant ce n'était que préparation. Etant enfant, je rêvais, le soir avant de m'endormir, d'avoir un petit domaine, occupé par les radis et les poules. La vie a généré autre opportunité, comme un écart, c'était bien (souvent très bien même (on a une sacrée collection de compte-rendus épiques)) ; en somme, ce n'est pas poubelle (ce seraient des paroles dures et injustement revanchardes), là c'est autre chose, un autre chose dont on se demande bien ce qu'il y en aurait à dire, car qui peut s'en foutre que les terres soient doucement préparées à passer l'hiver ? Qui peut vouloir lire et partager le destin d'un type pareil ? Ce n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'égérie de Christian Dior ; et pourtant les mots sont fluides, le témoignage disert.
On est mille comme ça, j'en suis peut-être le plus bruyant avec ces mots qui s'alignent comme un tourbillon de roches dévalant dans la combe, mais mille, banal, chaque destin une richesse terrible. Banalité que Raymond Depardon, sponsorisé France Inter, a tenté de conspuer, droit chemin dans la moisissure, mais il a échoué. Nous ne sommes pas ses Profils Paysans la vie moderne (même le titre est ridicule) : nous sommes fragiles mais plein d'espoirs, nous sommes solitaires mais accueillants, nous sommes dans le brouillard, si dense que c'en est gris, mais le vois-tu si plein de vie ? Ambigus probablement. Il n'est pas anodin de partir, enfin je veux dire, partir autant. Ca n'en fais aucunement de l'héroïsme. Ca fait surtout des décalages qui deviennent un peu grands et des gens qui doucement, ne se comprennent plus. Ce n'est pas grave en soi, mais un peu quand même parfois, notamment en été lors de la rencontre des mondes, lorsque l'on est à côté, l'un de l'autre, et qu'on se rend bien compte qu'un fossé nous sépare. Au fond une rivière torrentueuse quelquefois.
C'est cet aspect banalisé qui engendre que je n'aime pas l'Ardèche : ce sont les gorges, les kayaks, les foules, les véhicules stationnés à l'arrache, les campings. Si j'avais à parler de mon territoire, je parlerais des Cévennes (nous sommes la commune la plus orientale du domaine, une extrémité en somme). Mais même les Cévennes ce sont les kayaks. S'il me restait qu'un seul mot à dire, mon territoire c'est l'hiver. Ce n'est pas un hasard, je n'ai jamais été en Lozère en été. La saison estivale des vacances est spécieuse. Le beau temps fait aussi plaisir, c'est sans nul doute. Qu'on est bien en terrasse, ombragée sous la pergola. Qu'on est bien avec un verre de vin blanc, dont le froid fait perler le rebord du verre. On est bien partout, été comme hiver, toutefois les humains m'ont fait du mal ; ils m'ont fait énormément de bien, ils m'ont fait du mal parfois, en certains sens irréversible. Quelque part l'hiver reste juste une question de facilité, ici il n'y a pas d'humain. Et quant au reste, Lazonès marque une frontière. Il n'y a personne plus haut.
Désormais je n'attends plus rien de la vie. Il n'est d'autre parole que ce qu'elle donne est ce dont j'ai besoin : tout diminue, plus de grands projets, plus d'exaltation la veille du départ. C'est tout petit tout petit comme un pipi de kiwi une existence comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est un bon verre de vin, tendre et liquoreux. Il est très urgent de plonger, tout un chacun, dans ce que son cœur réclame. Les écarts ne sont pas graves, ils construisent juste un peu d'amertume et de paroles dures amalgamées en vrac - inutiles et brutes. Vingt à trente mille jours, c'est court, trop court pour faire du mal aux autres avec des mots agressifs et si vains, trop court pour ne pas écouter son cœur, qui réclamait juste un peu (en chuchotant, mais bref une vie si pressée, on n'entend pas tout) ; on a vraiment tous fait ce qu'on a pu et si cela reste à répéter, c'était bien. Le thé chauffe dans la bouilloire, il y a de l'humidité sur les fenêtres de Raymonde. La soirée s'étire langoureusement sous une pluie glaciale qui crépite sur la toiture de la roulotte, une pluie qui mouille qu'on dirait. Je savoure l'urgence de vivre, en prends le temps : que ce bien-être hivernal puisse être vôtre aussi.
La pluie qui se calme parfois, Émy jardine avec moi. Elle creuse des trous parce qu'elle sent bien que dans le monde du dessous, les taupes s'agitent. Elle part aux châtaignes avec moi, fait de longues promenades dont elle ne comprend pas le sens : pourquoi s'arrêter longuement sous certains arbres ? Elle ne supporte pas la première châtaigne dans mon bac blanc. Elle la saisit et va la déposer 3 mètres plus loin. Les suivantes ça va par contre. Ce geste est systématique, jour après jour. Insaisissable. Touchant aussi. Mais pourquoi ? La première châtaigne reste alors sur place dans la forêt, c'est que ça doit être comme ça.
Aujourd'hui, il a fait beau temps, mais par contre, dès que la course du soleil amène la lumière derrière la montagne, il se met à cailler. J'ai froid. C'est dur le soir, mais c'est une vie choisie. Je pourrais être
un bureau fermé. quatre mètres carrés. un pc devant moi, enfin un écran plutôt je veux dire. derrière une fenêtre en PVC, donnant sur une toiture bitumée sans charme. au plafond, des néons. il a fallu en dévisser un sur les deux parce que ça brûlait les yeux. le téléphone sonne. encore. encore. sur le combiné, une collègue a mis un autocollant help. huit heures de présence. attendre.
un train de banlieue, un RER aux sièges durs et usagés, qui a vu passer des millions de regards neutres, fermés ou fatigués. dehors le paysage défile. invariablement gris, invariablement neutre, peut-être même fatigué. les maisons s'alignent par dizaines de milliers le long de cette banlieue parisienne laissant derrière des souvenirs un peu rangés un peu inutiles ; les maisons sont en meulière, ça fait penser à Ermont. ces destins s'entassent ici, par facilité ou par pas-le-choix. je ne sais plus très bien si dans la réalité des choses, on n'a pas le choix. c'est morose. à Trappes on traverse un grand no man's land un dépôt ferroviaire ancien et mal entretenu. un train de banlieue, un paysage pâteux et morne ; il parait que Londres c'est encore pire : plus long, plus gris, plus entassé. Nick Cave disait : il n'est jamais sorti rien de bon de cette ville.
Olivier à Brancourt a eu des paroles très dures quant aux maisons de lotissement (nous en traversions un quotidiennement, pas particulièrement avenant, toutes maisons en simili-toc, assez identiques, le long d'une impasse, encore des impasses de lotissements tous pareils) , (ces paroles datent un peu, j'espère ne pas les déformer) : Vincent vois-tu, ces gens vivent dans des mini-prisons. Ils travaillent toute leur vie dans des trucs de merde pour se claquemurer là-dedans le week-end. Contexte est qu'Olivier vit en camping-car. Ancien armurier, il travaille peu (pour un salaire) et offre ses services en wwoofing à droite à gauche. Cette personne a une philosophie de vie qui fait réfléchir, et Dieu sait que lors des longues soirées de Brancourt, vides, nous avions le temps de le partager. Dire ou presque sous-entendre que ces maisons sont des petits cercueils est dur mais ça offre une réflexion. Beaucoup de gens ont des vies belles, même dans un lotissement, mais il est vrai qu'en tant que tel, le lotissement-travail offre une vision de la vie morbide. Les maisons sont écartées, les voisins ne se connaissent pas trop (c'était ici le cas), les jardins - du gazon - sont entourés de clôtures. En été ça tond le samedi, en automne ça passe le bruyant souffleur thermique. Les feuilles d'arbres, c'est horrible, voyez-vous.
Je pourrais être
Mais je ne suis pas et tellement heureux de ne pas être. Dès lors j'assume d'avoir froid, même si c'est dur. C'est un choix, idyllique, je sais que ça fait bizarre de le dire. Nous sommes devenus fragiles. Nos anciens se lavaient à la bassine et comment dire, je suis tout penaud devant le seau, de devoir le faire à mon tour. Avons-nous, tous, autant perdu ?
Sommes-nous si loin de la vérité ?
Désormais, la marque carrefour indique sur ses emballages : issu d'une exploitation haute valeur environnementale. La farine utilisée est issue de blés CRC, cultivés sur des exploitations HVE, sur lesquels les traitements chimiques sont limités grâce à une culture raisonnée. Ajoutant encore Biodiversité préservée, Gestion responsable des sols et de l'eau. Parce que utiliser des pesticides, ça peut être raisonné, un peu comme raisonnable le mot, parce que c'est responsable ? Non mais je veux dire, mon cul c'est du poulet ?
Carrefour, comme tant d'autres, c'est le goût âcre de la vomissure sur les lèvres, comme les politiques et comme les administrations. Grâce à vos étrons nauséabonds, communs et inondant les espaces banalisés, vous facilitez mon départ. Oui c'est peut-être dur certaines soirées, de traverser un automne-hiver humide comme ça, mais je peux vous promettre qu'à penser à vous, je savoure la liberté : aucun chômage, je ne vous dois rien, je vis dans un environnement extrêmement spartiate : pas d'emprunt, quasiment plus de compte bancaire : le soir la lune bondit depuis le plateau, c'est beau, pas de clôture, pas de lotissement pareil, pas de train de banlieue [Simone : Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voie 4, le train TER numéro 48844 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Chartres, initialement prévu à 17h33, est supprimé. Merci de votre compréhension] : je travaille au potager toute la journée en ce moment : je pourrais être et ne suis pas : démuni devant un seau à se demander comment se laver sans en mettre partout, puis en quelques tours de manivelle, des solutions sont trouvées, du bricolage on dira. Les lotissement-travail sont devenus au fil des banlieues grises tellement banalisés, est-il encore clairement identifiable qu'une autre vie est possible ?
Je suis un monstre d'écrire de la sorte sur la vie des gens, même dans un lotissement banalement morne. S'il y a bien quelque chose qu'ils me demandent, c'est de vivre en paix. N'en fais-je pas de même ? Donc je retire ce que j'ai dit. Il faut parfois savoir retirer ce qu'on dit.
Les journées se suivent et se ressemblent, désherber les terres en vue de recevoir le potager. Ce sont des terrasses qui n'ont jamais vu une carotte ; c'est un peu intermédiaire entre un pré et une forêt de faux châtaigniers et de noyers. En creusant jusque 30 centimètres, je n'ai pas été foutu de retrouver la roche mère. La terre est incroyablement noire, tendre et humifère. Je désherbe le chiendent centimètre par centimètre, en essayant de ne pas bouleverser les horizons. Je recouvre les terres dénudées d'une épaisse couche de feuilles d'arbres. Je veux ressembler à la forêt le plus possible. En automne dans le brun, la vie de la microfaune est intense. Comme je dénude, il faut que j'offre ça à la terre.
Je n'utilise pas de motoculteur et pas un gramme de pétrole, pas de produit phyto et aucun désherbage thermique. Que l'on m'excuse, mais c'est ce que j'appelle de la haute valeur environnementale.
Quelque part, je ne demande pas à Carrefour de produire de la Bio. Par
contre, le prétendre sur des produits assimilables à de la bouse,
c'est le regard du démon, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai.
Que cela soit clair, j'ai toujours eu peur du Malin. Le pouvoir de nuisance
du démoniaque est terrible, sournois, menteur, violent.
Je ne peux avoir de mots plus durs.
Je pourrai être
Leur business Unit, leur project manager, leur senior system administrator.
Leur réunion de mise au point suite à l'incident du 9 novembre,
leur nouvelle procédure, leur formulaire de demande en vue d'introduire
une demande (un mois à l'avance est obligatoire).
Mais je ne suis pas
Ce que je ne suis pas et ce que je veux être détermine ma rage. Lorsque je désherbe, j'ai une détermination implacable. Je ne veux plus jamais -jamais- travailler, salarié, dans leurs trucs. Mon potager est ma vie car il me nourrira, la forêt est mon Eden car elle me nourrira. C'est pour ça que je fais peu, mais avec un soin méticuleux. Cette accumulation de je pourrais être aux regards de démon - ces gens qui détruisent des existences au gré de ravages ou de paroles mensongères, ce qu'ils ne veulent pas voir, leur vue altérée par leurs croyances furieuses, est l'allégorie de ce que j'ai fui. La rage sourde s'éteint chaque matin lorsque je vois désormais ces étendues de feuillages, car je sais que ça fait du bien à la nature ; j'anthropise des terres, c'est déjà lourd à porter pour moi [même si ce furent des terrasses dans des temps très anciens, la maison de Jean date de 1480, c'est peu dire, et restaurer ce dont les anciens ont mis tant de cœur à faire, c'est porteur de sens]. Le feu a brûlé des années, il ne faut pas s'étonner que les braises soient encore à couver. Seule la forêt permet d'apaiser cela.
Si la normalité forme un cadre, il est peut-être légèrement de fait que trombine n'est pas spécialement encadrée. J'imagine un instant le gag, une rencontre sur le marché de la très grande normalité, l'inénarrable Tinder. Tu vis encore chez ta maman ? Non non, je suis dans une roulotte qui s'appelle Raymonde (si je te jure, c'est une histoire de chat en plus), le matin quand je me lève, je fais de la vapeur avec la bouche car il caille sa race. C'est quoi tes passions ? Bah écoute, en ce moment je regarde un peu comment s'arrachent la festuca glauca et le nardus stricta. On fait un tour aux terrasses ensemble ? Tu vas voir c'est fun. J'aime les plans à trois, vous désherbez et je prends mon thé. Ah oui au fait, j'oubliais de prévenir, je me lave au seau dans la roulotte et la semaine dernière, j'ai attrapé une pneumonie de la couille. Ca dérange ? Ah pardon, je comprends...
Ce soir j'étais canné (comme l'aurait dit le tout autant inénarrable François). Du coup j'ai arrêté le potager, il n'y a rien qui presse, et j'ai été faire un tour. J'y ai vu, tout comme aujourd'hui et hier de même d'ailleurs, l'étourdissante foule de zéro personne. Au moins ça a un avantage, tu ne passes pas une demi-vie à t'engueuler avec ton prochain, puis à nourrir une rancune mêlée de regrets, de paroles trop dures, etc etc. Par contre, je me suis fait houspiller par un geai qui peu heureux de ma présence superfétatoire, a imité la buse histoire de me virer de là. Ca a marché, bien évidemment.
Le matin, je pense à mes transports en commun pour arriver au poste de travail. Dès que le soleil jaillit comme un diable depuis la Blacherette, je descends l'escalier fait de vieilles lauzes et commencent les séances d'arrachage. C'est 10 heures par jour en ce moment. Les journées sont courtes en hiver, très courtes. Il faut tout faire dans ce bref délai : le potager, la cuisine, la vaisselle au bassin, la douche aussi donc, mais bref j'en passe les détails.
J'appelle ça une chance, quand je pense aux pauvres qui se tapent des trajets de malade, subis bien évidemment car peu aiment, enfin soit. Le plus dur, c'est de garder le cap, la motivation, surtout dans ces instants de solitude. Il ne faut que très peu de souvenirs pour que je redouble d'ardeur.
Je ne suis pas sûr que tout le monde bénéficie de cette sorte de chance ; il faut absolument que cesse ce jeu d'écriture médiocre de juger les gens, quand bien même je voudrais voir du maraîchage partout, des vergers à chaque coin de pré, les terrasses des Cévennes réparées, des Carrefour puis Super U en ruine (cibles de pillages et d'urbex), et j'en passe. Ce n'est pas ; il en découle que ce coin cévenol est désertique, sauf du 15 juin au 15 septembre. Est-ce un bien, est-ce un mal ? On est bien quand ce n'est pas la foule, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'inhumain soit autant répandu : le périphérique de Paris c'est inhumain, le Châtelet Les Halles c'est abomiffreux, mais Montfermeil aussi en fait. Quel mirage a pu se construire fut une époque pour que de cette campagne cévenole, après un je-ne-sais-combientième exode rural, on puisse se rendre à La Courneuve ? Là où je suis, inévitablement je pense à Ainielle et à la pluie jaune. C'était précieux à l'époque, ça l'est encore tout autant aujourd'hui. Peut-être que c'est la rudesse des choses qui a fait fuir les gens. C'est vrai que c'est dur.
La vie dans un aussi petit logement permet de reprendre contact avec les choses, l'existence brute et belle. Ne serait-ce qu'aller faire ses besoins dehors, il est une heure du matin, on se rend compte qu'un énorme roulis de nuages arrive sur le plateau. La lune, presque pleine, inonde les paysages d'une lumière blafarde pâle et bleutée. Ca fait comme les belle étoile au jardin en juillet, sauf que novembre est bien en route. Un aussi petit logement en contact avec le climat (ce n'est ni une maison ni un appartement), rythmé par le froid, ça veut dire tout cadencer. A 14 heures, c'est l'heure de la douche-vaisselle : surtout ne rien remettre à plus tard car juste après, le soleil passe derrière le Ron Sourd. L'ombre promet un glacial pour ainsi dire immédiat. Bien prévoir le repas car dès 17h30, la nuit envahira les terrasses. Sans électricité, tout doit être très organisé. Se laver les dents à 10 heures, car avant l'eau est tellement gelée, ça fait mal. Il fait quelle température dans Raymonde ? Je ne sais pas, celle de mon huile d'olive qui est figée, un bloc. Ca dans une maison ? Pas spécialement, on est protégé par le confort douillet. C'est salvateur le manque de confort, ça replace crûment l'humain à sa place, petit-être assisté de technologie. Une autre situation permet de connaitre ça, c'est la pauvreté. Je ne la souhaite à quiconque. C'est beau de vivre la vie-vraie.
Le soir, je me réfugie sous deux couettes. Une bougie brule à côté, offrant des teintes pastels à tout un univers de bois. Le site est très silencieux, c'est un calme ultime. Ca fait de longues soirées à ne rien faire. C'est agréable. Rien, vraiment rien. J'avais une vie frénétique bercée par le manque de temps - évidemment, il fallait beaucoup d'activités pour compenser le vide généré par le travail salarié ; désormais j'ai du temps, plein de temps, et ça provoque une vie différente.
Cette nuit, ou tout du moins dans les pourtours de cinq heure trente, il s'est mis à neiger. Emy a dormi à la roulotte pour la troisième nuit de suite. Elle déserte sa maison. De plus, elle s'est chopé une petite épine de châtaigne dans un coussinet. Dès lors ce matin, nous avons pris les chemins de traverse pour monter aux Coulets, chez son papa. Comme le chemin n'est pas très franc, surtout avec la neige, c'est Émy qui m'a guidé. Je lui ai demandé où c'est, ayant une vague idée, je ne savais pas beaucoup plus que ça. On a traversé les genets en vrac, bref un chemin de chien. Une heure et demie plus tard nous étions là-haut.
Émy pète les plombs parce qu'elle n'a plus de brebis à garder. Sans nul doute avec les agnelages et les chevrotages, ça va s'arranger. En attendant elle tourne en rond, ce qui fait qu'elle est toujours fourrée par là. C'est un peu long pour elle et inquiétant pour nous, mais bon si ce n'est que ça, on s'en occupe. C'est un peu ça d'avoir le temps, on gère, on s'entraide, pour des conneries quelquefois, mais soit après tout, pour des choses importantes aussi. Laurent a expliqué qu'avec les vents de l'autre jour, son bâtiment d'exploitation a bougé d'un mètre au sol. C'étaient des vents tournant et ça a semé une certaine pagaille. Un épicéa est tombé, fort heureusement aucun cochon n'était en dessous - ça a dû se jouer de peu. Le retour a été humide, il s'est mis à pleuvoir plutôt sévèrement.
Au regard de la loi, enfin de leur loi je veux dire, je suis un oisif. Hier j'ai beaucoup avancé sur le potager car je savais la météo défavorable aujourd'hui. Ainsi donc ce jour, je ne fais rien. La pluie tombe sans discontinuer. Dans la roulotte j'ai des conditions d'humidité exécrables. Le chauffage ne s'allume plus. Le piézo est trempé. A ce stade, ça ne m'étonne même plus. Laurent évoque que sur le plateau - tout le monde appelle Montselgues comme ça, le plateau - les conditions climatiques sont nettement plus dures qu'ici. En février, il se trouve une période d'une quinzaine où ça descend longuement jusque moins dix. A ce niveau je ne pourrai plus tenir. A vrai dire ça ne m'inquiète même plus : pas plus moi-même que mon huile à ce titre, puisqu'elle est totalement figée. On se débrouillera bien tous deux, on s'est toujours débrouillés. Regardant en arrière, en fait, il me semble comprendre que ça fait trois semaines que je n'ai pas vu une douche. J'avais évidemment l'intime conviction que ça allait être compliqué. C'est la vie quotidienne qui se transforme au fil des pages, la vie n'est pas spécialement simple.
S'il y a bien une chose qui va débarquer, que je le veuille ou non, c'est que je ne sais pas comment je vais passer la nuit. Humidité fracassante au gré du gel persistant qui va s'installer graduellement de plus en plus puissant, un sacré quatre heures du matin en perspective. Le moins qu'on puisse dire est que j'en ai vu des pires, des nuits. La plus extrême sera sans nul doute celle dans le transformateur abandonné et demi-écroulé de Drigas [de toute mon existence, je ne pense pas avoir été plus en danger que cette tempête là] ; alors là cette nuit à venir, de la gnognote mon frère, comme qui dirait j'en ai vu d'autres. Il serait injuste de ne pas partager ça, je dis ça maintenant en vrac car c'est tellement commun et au fond tellement important aussi. Au demeurant, je ne parle pas de l'odeur générée par les absences de douches, certes, mais plutôt de ces récits. Cette foncière banalité prend forme d'une traversée à la fois complètement dingue et pourtant si terne. C'est à revenir dessus, mon vivre ici, et pour autant que je lui doive bien ça, ces textes seront en miroir aux crépusculaires récits de Dana Hilliot. Pourquoi en être arrivé là sera l'éternelle question qui se pose, sans que les réponses n'en soient réellement satisfaisantes.
Le récit n'apporte rien, si ce n'est quelques milligrammes d'errance inutile ; au départ je pensais apporter une impulsion afin de montrer que c'est possible, d'être critique de la société et d'être un véritable militant riendutoutiste pas écolo et plutôt naturo-simple : une autre forme de vie est envisageable. Cependant elle ne l'est pas à portée de main / simplement je veux dire / comme ceci ou comme cela / ça prend un temps fou. Plongé dans une telle galère, c'est finalement Jean qui est venu me tirer de la poisse. J'étais trempé, il m'a amené jusque l'âtre de son feu. Tout seul je n'en sortais pas, englué dans les brouillards. C'est la vie de monsieur-tout-le-monde qui a claqué la porte, critique de la société décadente, acerbe et désabusé, épris d'une nature farouche et pétri de bonne volonté ; cette fois-ci il à fallu de l'aide. Cette maison ces terrains ces terrasses cette eau, c'est là où nous sommes, c'est notre dernier refuge. La vie s'accroche à tes vêtements tel un rameau d'églantier : elle ne te lâchera pas pour si peu (il faut de l'effort, de la détermination, jamais lâcher), car sinon, au moindre relâchement, au moindre moral en baisse, elle viendra pourrir tes rêves. C'est de tout ça qu'on voudrait s'extirper, se gonfler d'un optimisme de bulle, de l'oxygène, chaque jour repartir avec encore plus de courage, encore plus de volonté. Nous y arriverons malgré tout. Tout réside dans le nous.
Après avoir séché ma veste et mon bonnet auprès du feu, après m'avoir encore une fois sorti de la poisse humide et gluante, Jean m'a donné un nouvel élan. Mes vêtements secs, ça permettait de passer la nuit. Le lendemain contre toute attente, au milieu d'un champ de boue et de neige demi-fondue, il a fait beau. Une mer de nuages roulait dans la vallée. C'est dans ce genre de moment que tu sais pourquoi tu es là. Je me suis lavé au bassin, l'eau à zéro degré. Puis, que dire d'autre que ça a été. A chaque fois, le pays m'a fait subir, en me chuchotant à l'oreille : je suis très rude ; à chaque fois j'ai été tiré de là plus ou moins in extremis, par chance, par pure bonté aussi.
L'antenne téléphonique de Montselgues a craqué avec les conditions météo déplorables. Je suis monté à l'Echelette afin d'écouter les nombreux messages téléphoniques, certains inquiets. Sur les bords de routes, notamment la piste, des monceaux de neige. Au loin où que porte le regard, l'immensité de la vallée. C'est pour ça qu'on vit ici.
La première fois que je suis arrivé là, j'ai arrêté le véhicule quelques kilomètres avant, à Lazonès. C'est un peu une frontière invisible, un monde du bas un monde du haut, l'ancienne maison de Lucien la Brocante. En cet instant, j'avais uniquement connaissance que c'est une impasse et comme qui dirait, pas spécialement avec des centaines de voisins. Il s'avère que la route devenait si étroite et si malaisée, je m'étais évoqué intérieurement : je n'arriverai jamais à faire demi-tour. Ca place le contexte. Dès le départ et comme qui dirait, là où je suis, c'est un bout. Du monde, presque, mais en tout cas la dernière maison, ou à peu près, enfin bref. Du coup je me suis stationné chez Marité et je suis resté quatre jours, à camper discrètement entre les deux ponts.
Il s'avère qu'il pleuvait, (ma maman aurait poétiquement évoqué cela comme une vache qui pisse) et d'ailleurs ça a duré les quatre jours. Je venais de Villefort puis suis logiquement passé par Pied de Borne. En gros, ce n'est pas l'autoroute qu'on pourrait dire. Routes longues et très étroites, le ravin du Chassezac, puis franchement rien à la ronde, c'est l'Ardèche : aucun de nous ne compte en kilomètres, on compte en temps.
Le premier contact a été effrayant. C'est très-très-très-très isolé. Le pays est rude. En face et de l'autre côté de la rivière torrentueuse se trouve une montagne ; de la lande, des genets, des bruyères puis franchement, rien. Alors que j'étais trempé et glacé par la pluie, un 15 août tout de même [c'est le seul jour formant la saison nommée été en Belgique], Jean m'a hébergé et rassuré. Sans lui, je redescendais à Gravières et brutalisais pour ainsi dire immédiatement au téléphone : mais vous êtes des dingues ? D'ailleurs ça s'est un peu fait tout de même, dans l'espèce de curieux cimetière semi-monastique en bord de route. Pas facile la vallée. Rien que d'y remonter, bref depuis Gravières quand même, 13 kilomètres pour 50 minutes (je me suis amélioré, maintenant je roule à vingt).
C'est là où je suis.
On appelle ça la vallée. Les chasseurs locaux, ceux de la fédé de Malarce, disent que c'est bien d'avoir acheté là. Si tu n'aimes pas les kayaks des gorges de l'Ardèche (soit, oui, donc, je me suis payé les gorges du Tarn étant ado et ce fut à proprement parler infernal, donc ça reste un peu coincé là depuis, mais passons), alors ici tu seras bien, parce qu'en résumé, y'a personne. Mais, tu as entendu les cochons alors ? Quand ça, la semaine dernière ? Purée y'a un de ces trafics en ce moment. Ici on ne parle pas de sanglier mais de cochon, on a notre vocabulaire, des choses banales, Bernard dirait : des histoires de pays.
En réalité, du fait que ce soit au bout, ce qui s'appelle le bout du bout puisque de toute façon après ce sont les bognes, il s'avère qu'en bas c'est en bas, et en haut c'est ici. Quand on descend aux Vans, en résumé quelque chose comme 3000 habitants, on va en ville. Mais on se démerde de plein de manières. Jean-Marie livre son pain à Thines, Greg fait du fromage à Montselgues et quand bien même tu aurais un ennui ou l'autre, Philippe du Gerboul aura vite fait de te faire une photocopie. En ville(s), on a tout sous la main ; ici c'est comme la montagne ou la mer, ce n'est que de l'entraide. On a rien mais on se débrouille pour tout.
Alors que je montais la piste, la route qui mène à la D4 - l'antenne du téléphone étant en panne depuis des jours, j'allais chercher du réseau là-haut au Mas de Peyre ou à l'Echelette, bref des coins faits pour la neige comme les chiens sont faits pour mordre, (il s'agit juste que j'attendais des e-mails important, je ne monte pas là-haut pour Tinder hein) - une camionnette pourrie me stoppe. Une fille, punk à chien, a perdu son chien. Du coup après avoir donné des nouvelles aux amis, en bref de ne surtout pas s'inquiéter, le hasard fait que je trouve l'animal, Gitane, accompagnée de deux pouilleux et en train de décimer une poubelle sur le parking de Thines. Ni une ni deux, je vais à Laviô. Exclamation de sa maman : la grosse fait les poubelles !
C'est sur ces entrefaites que j'écrivais relativement dépité à Nadia : à Thines, une moitié des gens s'appelle Léo, une moitié s'appelle Lucien, et la dernière moitié s'appelle autre chose (ah, ça ne marche pas en fait) ; mais en tout cas, tout le monde a des problèmes de chiens !
Nos problématiques sont primaires et se résolvent de manière pragmatique. On n'a pas d'eau, de toute façon c'est comme ça pour presque tout le monde. Quand on va en chercher à Thines, à Planzolles ou aux Vans, on propose toujours aux autres de prendre leurs bidouilles (car là-encore, on ne parle pas de bidon). Nous sommes préoccupés par la fermeture des robinets des cimetières, bien avant de savoir si un gouvernement est formé en Belgique, mais ceci étant, il n'y a pas fort à parier que c'est encore bloqué, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut s'en foutre. Tu n'as pas voté pour eux mais ils s'arrangeront pour faire ce que de toute façon tu ne voulais pas, et dès le gouvernement formé, se rattraper par des hostiles mesures antisociales. En clair nous, on parle de chiens, de cochons, de marrons, du vieux Darboux qui est mort et que c'était quand même un chic type. Voilà.
La vallée se resserre au niveau de Roussel et nous, on appelle ça le canal de Panama. C'est beau d'ailleurs. C'est une vallée farouche, les gens se donnent très lentement parfois. En somme pour eux, tu resteras toujours un étranger. C'est peut-être parce que tous les habitants ont conscience d'une chose, cette volonté de conserver l'authenticité rude du site. D'ailleurs, n'ai-je pas arrêté ma course à Lazonès chez Laurent, enfin un autre Laurent. Alors il y a le monde d'en bas, Chambonas ses couleurs vives son château, c'est quasiment estival, et puis il y a notre monde d'en haut. On l'aime comme ça.
L'habitat est dispersé parce que c'est granitique, un peu comme les monts d'Arrée ou les monts Lozère, tous deux esseulés et fantomatiques. Il y a des sources partout (curieusement d'ailleurs, elles sont en haut), et les anciens ont placé les maisons sur les débits d'eau. Logique, ils n'étaient pas idiots à l'époque, d'ailleurs en Lozère on appelle ça des gouttes. Donc à défaut de maisons en poquets, resserrées autour d'une source, l'habitat est très solitaire. Quand je dis très... Faut aimer être célibataire ici, car sinon c'est un peu la déprime. D'ailleurs, aujourd'hui, des conditions un peu exceptionnelles ont conduit à ce que six personnes soient présentes en même temps dans la cour : oh cette foule. Ca donnait une impression bizarre d'anormalité, presque un malaise ; qu'est-ce qu'on peut être bien dans cette solitude crue.
D'ailleurs bien sans transition, ces personnes se sont éloignées comme elles sont venues, et cette fois-ci un certain nombre de voisins partis pour l'hiver, c'est l'ouverture de la porte d'un gigantisme de solitude, des milliers d'hectares dont je suis le seul gardien, tout bonnement illégitime puisque je ne suis rien d'autre qu'un minuscule humain dans un territoire auquel je n'appartiens pas : s'il y a bien quelque chose de certain, c'est qu'il s'appartient à lui-même, sauvage et impétueux. Mais voilà, je suis là, seul. Ainielle plus que jamais, pluie jaune au fond du cœur, combien ces temps-ci je me vois nulle part d'autre qu'à Otal ou Escartin - ce sont des souvenirs importants, qu'infiniment peu peuvent saisir (ce sont les villages abandonnés des Pyrénées, la solitude d'ici est une promenade de santé par rapport à là-bas, personne n'en parle, personne ne connait, ou si peu, presque dira-t-on) ; ainsi je deviens gardien des clés, moi qui suis si médiocre, arrivé un quinze août un jour de pluie, novembre les gens m'offrent leur maison, leur cheminée, leurs chambres, leur cave, les caisses de pommes et les cartons de kiwis. Partir d'ici ? Fou toi. Pourquoi ? Ce soir le soleil éclairait uniquement La Blacherette au loin, tout le reste était noir-gris sombre. Partir non, comme une Ainielle accrochée au cœur. Je comprends maintenant. J'avais été bouleversé étant ado à la lecture de cet ouvrage (relu vingt fois), maintenant je suis cet ouvrage. Il ne peut y avoir de meilleur hommage.
Ce midi, lors d'un timide soleil, je prenais un repas sur les marches d'escalier menant à Dorpstraat - c'est un peu mon repère ce petit coin - et dans l'aubépine crevant la terrasse attenante, un merle m'observait. Très longuement, ici tout est long car on prend le temps de n'importe quoi, le merle babillait. Je pensais que seuls les rouge-gorge gazouillaient de la sorte. C'est un tout fin babil, long et ininterrompu, comme si ce beau merle noir se parlait à lui-même, se chantait une petite chanson dont il avait le refrain en tête. Pour ainsi dire inaudible, ce chant chuchoté a offert un instant précieux. Soudainement il a pris une baie, puis vivement s'est écarté vers les bambous. Petit ami de l'aubépine, je te vois souvent tôt le matin, marquer ton territoire. On sera amis, je le sais, un jour viendra.
Le pays est ambigu. Il s'offre extrêmement lentement et parfois, subrepticement, rapidement : trop, franc, brut, fort. S'il y a une question qui revient toujours, dans chaque parole : tu restes à l'année ? Lorsque je réponds oui, il se trouve une sorte d'approbation, un respect presque immédiat. Je ressens que le pays a souffert de l'exode rural et peut-être encore plus des résidences secondaires tertiaires ou plus-rien-du-tout. Quelque part c'est farouche, parce que notre vallée est intime et il nous est radical qu'elle le reste, d'autre part tout apport de vie fait tellement de bien (les terrasses crevées qu'on rêve tous de remonter, les genêts qu'on voudrait couper pour rouvrir les chemins) : ce dont nous ne voulons pas, ce sont des gens qui s'en moquent, que cela ne touche pas : il y en a, surtout l'été ; il est légitime que naisse une peur. Ambigüe cette crainte, je n'ai jamais rencontré de rejet jusqu'à présent, c'est peut-être implicitement un signal pour dire que la vallée a besoin d'amour. Celui qu'on a pour elle.
D'aucuns vous diront que c'est une route étroite et des arbres : il y en a des centaines des coins comme ça. Oui c'est vrai. Après il y a un moment dans la vie où on a besoin de poser ses rames. On ne demande pas au lieu rêvé d'être parfait, mais en contrepartie d'être la bienveillance dont désormais on aspire. Sans équivoque, le lieu est rude, ne le cachons pas sous des artifices. Il ne faut pas chercher de logique, rude c'est aussi ce que l'on veut - en somme aseptisé à la fin, ça manque de goût, fade, l'épice manque.
C'est ainsi, et d'ailleurs grâce à la bienveillance énorme de deux voisins qui - sans nul doute - ont largement contribué à ce que je m'attache à vivre ici comme un lichen sur son tronc, comme une anémone sur son rocher, que j'ai rencontré Honoré, ancien maire de Thines avant la fusion avec Malarce et Lafigère, Honoré dont la simple prise de contact, regards croisés, première seconde je dirais même, engendre un respect immédiat. Une prestance discrète, un personnage effacé, pourtant un sentiment prompt et fort : ses mains, elles sont magnifiques, comme taillées dans un bois solide : rudes, noires, abimées : son regard timide, presque gêné : il a passé 80 ans, il a acheté une nouvelle tronçonneuse il y a quelques semaines.
L'histoire d'Honoré, qui était parti aux châtaignes, on le fait tous ici. Les sangliers avaient creusé un trou afin de dénicher de savoureuses racines à trancher, ou je ne sais quel champignon semi-enterré. Dans la pente, Honoré ne pouvait voir le cratère, son pied a percé le toit de la grotte des terres meubles et remuées. Chutant, sa jambe s'est empalée dans une branche de châtaignier brisée, rescapée d'une tempête, formant une pointe acérée dont la surface n'était autre que sale et vermoulue, en proie aux rhizomes des champignons. La pointe de bois a traversé la jambe, c'est entré là, c'est sorti là.
Ca a dû faire terriblement mal ? Bah non. Stoïque, il a ramassé son bol de marrons, il est redescendu à la maison, personne ne savait où il était. C'est entré là, c'est sorti là, montrant sa jambe bandée : certes, un simple chemin de presque vingt centimètres, de la bagatelle. Les pompiers ont dû lui dire non lorsqu'il s'agissait d'aller au camion seul. Plus tard à Aubenas, l'urgentiste a immédiatement pris conscience du sérieux, opération le lendemain même, un dimanche matin à huit heures pétantes ; le chirurgien est revenu exprès. Tu vois, ça arrive même à un vieux briscard comme ça ; lequel raconte ça avec une telle humilité, bah oui. Voilà. C'est tout. Voilà. Comment ne pas fondre devant une personne comme ça ? Et moi qui ose encore parler de ma fracture de la phalange distale (ça fait mal en plus !) : non mais franchement quelle affaire dis !
Le temps passe lentement. Jean racontait tout à l'heure d'avoir entendu les cris puissants d'un geai affolé ; attaqué par un autour, il était en fâcheuse posture, sauf que le jeune autour si peu expérimenté, ne savait pas comment s'y prendre. Le geai a pris la fuite, probablement haletant sur une branche de chêne à quelques pas de là. Nos histoires sont d'une telle banalité, elles sont engourdies, ça pourrait être partout, cela pourrait être le récit d'un n'importe qui. Cette platitude ne reflète pas nos ressentis. Ces quotidiens de la nature nous touchent et nous imprègnent. Désormais quand je regarde l'Everest de Thines, cette montagne sans nom juste en face, je pense au bouleau qui a eu l'idée saugrenue de pousser là, au sommet et au milieu des gros cailloux gelés et érodés. Avec le vent et le froid, mais mazette il doit prendre très cher. A devoir passer une nuit là-haut, là maintenant, la durée de survie doit être quelque peu limitée. Oui voilà, ce sont nos récits, nos périples, notre vallée.
Me retournant vers Pierre Plantée, mélancolique sur le brouillard qui avance. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de si intéressant que ça, telle pourrait être l'entame de la moindre pièce de conversation ici désormais. Il fut un temps où j'étais plus ou moins vaguement un peu célèbre, disons un cercle plutôt large au delà des amis et des amis d'amis. Désormais circonscrite, l'existence est rabougrie à un quasiment plus rien : ce n'est pas spécialement volontaire, plutôt induit par le sauvage aspect du coin, quelque part il n'est pas désagréable non plus d'être désormais à ce point plus rien ; je pensais à cela en arrachant mes mètres carrés de chiendent, préparant depuis plusieurs semaines le potager à venir, lequel permettra un grand pas vers une certaine autonomie alimentaire, ce qui en outre idée absolument fixe, encourageante et salvatrice, me permettra de ne plus travailler salarié. Ca donne un plus rien de spécial, une personnalité limitée à la terre et ce qu'il en sort : qui peut en avoir quelque chose à cirer ? Les paroles deviennent terre à terre, voire même souvent enfouies dans les tréfonds, puisqu'il n'y a personne à qui parler.
Ce matin alors que je débutais l'arrachage, j'ai noté la présence d'un curieux monticule linéaire. Mazette, un rat taupin est passé par là. Dans la muraille de la ravine, j'entends alors du chahut dans les feuilles mortes. La petite souris me regarde avec un visage tout mignon. Arborant un grand sourire, elle me dit : je vais manger tous tes trucs ! Avec mes pieds, j'ai alors cassé les galeries. La souris témoigna : tes trucs ont cassé tous mes trucs (désolé, je n'ai pas été à l'école). Elle contacta son assurance et dans l'après-midi même, avec Mamy et les 42 enfants, ça creusait de nouveau furibard vers la ravine, de nombreux trucs en direction des trucs. On ne la revit jamais ai-je rêvé !
A force, mon langage devient animal. Centré sur l'existence d'ici, le
vocabulaire sillonne les trafics des cochons dans les terrasses du haut, la
rivière de Thines qui prend de l'ampleur, les bogues des marrons qui
trainent et qui piquent les genoux dans le potager, les nuages bas qui rampent
sur les contreforts de l'Everest de Thines. Puis, plus rien d'autre. La vie
d'ailleurs me devient étrangère, terne, ça ne me parle
plus, comme si une fermeture s'était opérée (probablement
un geste inconscient de protection) : la vallée demande d'avoir un moral
en acier-béton-armé, un physique sans faille, mais elle accorde
d'être fragile moralement, d'avoir le dos griffé de très
profondes entailles, les blessures du passé. La forêt permet cela,
c'est antagoniste, la ligne de démarcation n'est autre qu'une fine toile
d'araignée à peine visible, qui traverse le chemin au gré
des vents.
La vie d'ailleurs, politique des grandes villes et des centres périurbains,
on ne l'oublie pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici
il pleut cinq jours de suite. Je suis cloîtré à l'intérieur
de la roulotte, sans savoir quoi faire, dans des conditions d'humidité
extrêmes, de saleté démoniaque (rien que d'aller aux wc
à la forêt fait entrer des monceaux de boue, même sur le
matelas par mégarde) : la vie des villes parait abondante, sucrée,
attractive, facile, pourtant elle fait horriblement peur. Je suis devenu fragile,
j'étais fragile, mais cette fois-ci en plus agité d'une certaine
inquiétude, animé d'un sentiment diffus, les galeries sous les
caillasses de la ravine un refuge, la pluie attendre, sans rien d'autre à
faire que de regarder les nuages ramper, apaisé et rassuré.
La forêt a un rapport énorme avec la mort. On peut chuter entre des roches et honnêtement, il n'y a franchement personne pour venir à la rescousse. Alors, naturellement, on est précautionneux dans chacun de ses gestes - lent et mesuré. Je crois que tout un chacun en a une conscience sourde ici. Après la mort ça ne gène pas. D'ailleurs je préfère appeler ça la fin, parce que inévitablement, parler de la mort ça fait morbide. La fin ce n'est pas désagréable, c'est un truc comme un truc dirait la petite souris. [Tout ce que je demande, c'est que vous mettiez mes cendres sous une lauze au sommet du Gargo. Je me doute bien qu'on ne peut pas faire ça. Essayez de magouiller avec une urne vide, si vous y arrivez ça ferait une agréable revanche sur l'administration, une belle promenade pour vous, et soyez surtout heureux comme j'ai pu l'être follement dans cet endroit magique].
Il s'avère qu'en ville, on y va de temps à autre ; on essaie de grouper un minimum les obligations afin de s'épargner. Pour des raisons administratives, j'ai dû chercher une boîte-aux-lettres. Oui j'aurais pu la tailler dans un tronc d'arbre, je sais, j'aurais pu. L'article en métal avait été pré-repéré, j'attendais simplement qu'un bon de réduction soit valable, me faisant obtenir l'objet pour ainsi dire gratuitement, (je suis peu bons et cartes, etc, mais vivant sans le moindre revenu, je dois faire très attention à tout). Direct au but, au fond à gauche, puis je me dirige vers la caisse, et là j'ai eu peur. Angoissé, ai-je réussi à me laver -assez- dans la rivière ? Cette personne va-t-elle remarquer, percevoir, comprendre, ressentir, absorber le fait que je suis à-ce-point-sans-domicile ? Mais je crois que la peur ne provenait pas de là, j'ai mille fois affronté ces situations dans les randonnées, mille fois mille.
Je crois que dans la perception, j'ai eu peur d'être tronçonné, la chair découpée par la lame affutée. Alors, au-delà de mon écorce chavirée et entaillée de blessures sombres purulentes, la tranche de mon corps aurait révélé les rides, la cerne que chaque année forme. On y aurait vu des années fastes, avec de belles cernes épaisses et solides. On y aurait aussi lu les ronds noirs à peine perceptibles, l'été 2017, puis cet hiver de froid, la chair gangrénée par l'humidité dévorante.
Caissière à Weldom, semi-multinationale-multimillionnaire-hideuse, caissière anonyme, la cinquantaine bien affirmée, discrète et gentille avec les clients, probablement traitée comme un semi-robot dans une part non négligeable de la journée, qu'est-il advenu de cet instant humain - terriblement humain - où je ne voulais pas déranger ? Ces mots reviennent et blessent. Ca ne dérange pas tu sais, tout le monde sait que tu fais 'vraiment' ce que tu peux, honnêtement, sincèrement, dans les conditions qui te sont données : la boue s'était accrochée au pantalon, ici la terre est noire, humifère, puissante et fertile. En bas, la rivière gronde de torrents bouillonnants. Les genets sont ondulés par de féroces bourrasques chargées de nuages pluvieux.
La forêt a un rapport puissant avec l'amour. Tout à l'heure, une bergeronnette des ruisseaux traversait Térondel de son vol ondulant, la végétation aux couleurs magnifiées par la pluie. Elle permet d'être seul, d'ouvrir sa coquille, de la laisser au sol, d'être fragile-comme-tout ; l'amour d'ici ne fait pas mal, il est constant et doux. D'aller chercher cette fichue boîte-aux-lettres a lancé un malaise, nouveau, puissant et profond, celui de ne pas être par ici et simplement là-bas, de déranger, l'âme boueuse et humide, des flots de rivière traversant les pieds et les mains. Les gens parleraient : guérison par ceci ou par cela il faut consulter ceci ou cela blablabla, France-Vomi dirait (désolé, mais dans ce recoin de campagne, il n'y a que France-Inter qui passe et ce n'est pas un cadeau) : les politiques ce n'est pas bien tralala, mais on les aime tralala, c'est la vie tralala-blablabla, la bulle à verre dirait blink la bouteille ; leurs paroles sont un unanime brouhaha, un chahut surmonté de sacs plastiques, je n'y entends plus rien, je n'appelle plus. A la croix de Fer, un brouillard rongeait les pins noirs. Le causse c'est cela, un immense silence, un immense silence avec juste le ronronnement ténu du vent dans les pins, rien d'autre, un ciel gris plombé. Ce n'était pas le causse mais le même murmure. Il suffisait de fermer les yeux. L'amour c'est ça.
La pluie tombe sans interruption, cela fait maintenant longtemps mais je ne sais plus, c'est que quelque part le rapport avec le temps n'a plus de sens. C'est une simple attente putride, le matin où cela aura cessé sera beau d'une lumière nouvelle permettant une temporaire renaissance. Je ne sais pas. Je crois que ça fait très longtemps maintenant. Lorsque des amis donnent des signes (de vie), c'est très précieux, ça réchauffe, ça fait écarter la pourriture, ça fait reculer la moisissure qui grandit sous mon écorce. Jamais je n'aurais cru que tout ce monde soit si important, du plus petit au plus grand, jamais je n'aurais cru qu'ils auraient gardé contact, sentiment de culpabilité d'être plongé dans une situation aussi dure (j'ai essayé de l'éviter, mais ce n'est pas facile), je pourris, mais dessous la sève et vive, le sang palpite : quand je vois ces terres potagères gorgées de promesses, le bonheur réchauffe les parcelles ; ils savent, mes amis, que l'hiver, tout parait mort, que novembre est dégueulasse, mais c'est la belle-vie, celle de vivre en communion ultime avec la nature, faire-nature, quel qu'en soit le prix à payer ; certes je perds mes feuilles et me recroqueville dans les racines profondes de mes peurs. Tous m'aiment pour ce combat que je mène, parce que je suis fragile et nous y arrivons ensemble, le battement de cœur de ces amitiés est devenu un indispensable - auparavant dans le brouhaha je ne les entendais que peu ; c'est normal, ce qu'ils appellent vie active travaille un peu comme un poison, on n'a que peu le temps d'écouter.
La nuit tombe tôt, il fait noir, il n'y a désormais pour ainsi dire plus de lune. Mon cœur en putréfaction se noircit, prends corps avec la terre. Mes sentiments en décomposition deviennent amorphes et silencieux. Ca ruisselle au sol, la pluie battante frappe le zinc de la roulotte, à côté de moi pour seule lumière brûle une bougie. Je pense à vous, ce morceau de paradis que je construis au jour le jour évolue doucement sous mes mains noircies et abimées. Quand viendra le printemps, je serai tellement fier de vous l'offrir, tellement heureux.
Lorsque je suis revenu au potager, au sol se trouvaient de nouvelles galeries formant des petits monticules de terre. Au sein des roches de la ravine, une petite souris et sa mamy me regardaient avec un visage narquois. L'une me dit : article 23 alinéa 4 de la charte de ce lieu : il est interdit de tuer des animaux. C'est toi-même qui a truqué ce truc.
J'ai regretté d'avoir rédigé ce texte.
Me retournant, je me suis dit que cela était bon.
Puis arriva la pluie. Le courant de l'entre deux saisons après tout.
En arrivant ici, je m'attendais à vivre avec la nature. Je m'attendais à avoir une écriture contemplative et fainéante, la vie des oiseaux, les forêts de châtaigniers. Ce qui arrive est dingue. L'écriture devient nerveuse et imprécise, floue et dans l'urgence. J'écris pendant, et pas après.
Ca fait une semaine que la météo annonce un épisode cévenol.
J'en avais énormément entendu parler durant mon enfance, ceux
qui évoquaient cela parlaient de moments terribles. Chance ou pas, je
n'en ai jamais connu un seul. Au fil des jours, la menace s'est précisée,
autant en intensité qu'en période.
Les valeurs sont étourdissantes. A Paris, il pleut 637 mm par an, en
moyenne. S'il est à tirer un bilan du moment présent, je me paye
320 mm en 5 jours, 202 mm en 24 heures. Les vents sont à plus de 100
km heure.
Le programme est simple : la pluie : une pluie acharnée, en proie au délire, emportée par la folie, paroxysmique. Sans plus de possibilité que ça, je suis réduit à la claustration dans Raymonde pour 5 jours et demi. Advienne que pourra sur la durée réelle. Nous sommes vendredi, jour 3.
Jeudi matin, j'étais super content. En effet, j'ai bénéficié
de deux heures et quelques de trêve au petit matin. Effet remarquable,
la possibilité de faire toute la vaisselle au bassin (c'est plus facile
qu'à l'intérieur), aller aux wc, mettre les déchets de
légumes au compost, puis s'acquitter d'obligations administratives. J'en
parlais d'ailleurs, mais soit passons. Bref un instant de chance, ce de surcroît
que de passage à Lablachère, j'ai pu prendre un livre, la traversée
de l'Himalaya de Sylvain Tesson et d'Alexandre Poussin. Long et bien écrit,
c'est parfait. Aussi, j'ai pu bénéficier de plusieurs ouvrages
d'un déçu des poules, un riche enseignement agricole (et même
si la couverture est abîmée, ça se restaurera, ça
en vaut bien la chandelle). Paré pour la très longue attente,
je n'avais même pas un livre en
fait !
Ce vendredi matin, j'ai bénéficié de dix minutes de trêve.
Inespéré. J'ai foncé au bassin et fait tout l'essentiel
du nettoyage. Déjà qu'attendre c'est long, mais alors patienter
dans un pucier ! Depuis lors, ça tombe des trombes du ciel, ininterrompu.
C'est un évènement fou. Des vents rageurs s'engouffrent dans le fond de la vallée, les arbres ploient sous la férocité. Des pluies diluviennes s'abattent sur l'Everest de Thines, devenu quasiment invisible sous les trombes d'eau. Je ne peux même plus écouter de musique. La pluie bat la toiture de zinc avec une haine palpable. Pas de fuite pour l'instant, Raymonde a son certificat d'étanchéité, enfin... pour l'instant. La pluie passe sous la porte, que j'ai fermée à clé non pas de peur d'un visiteur, mais que le vent la force. J'ai sacrifié un torchon, celui que m'avait donné Nathalie - tant pis, je le laverai dans la rivière. Par chance, les vents sont en long par rapport au stationnement de Raymonde, c'est une pure furie.
Aux alentours de 10 heures ce matin, Émy, son mari et son fils sont
venus gémir à la porte d'entrée. Je ne peux pas vous accueillir,
vous êtes trois et des soupes, il en va de ma survie. Ils ont été
se faufiler au garage, puis le bref temps d'une accalmie à midi, ont
disparu. Un pic vert est passé à toute vitesse, un merle a déboulé
puis a disparu. Comment font-ils pour survivre ? Comment assument-t-ils leurs
besoins ?
Il fait nuit et je ne vois plus rien, c'est noir d'encre et détrempé.
Je sais juste que c'est dingue, nuit blanche assurée. Je pisse dans un
seau et jette tout dehors par la fenêtre (au moins ça c'est chaud,
le seau est en inox), pareil pour le reste, tant pis et je nettoierai plus tard.
Les repas sont des stricts minimum car je ne peux rien aérer, la production
de vapeur engendre une humidité tentaculaire.
Je pourrais être formidablement en colère de subir ça. Il n'en est rien. Je suis pour l'instant, à 19 heures, au sec. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette nuit, mais en tout cas là, j'ai la gratitude d'être bien. Oui simplement, d'être bien, sous deux couettes, quasiment pas d'eau. Le balai-brosse sous la porte est un point faible. La pluie frappe de ce côté, l'eau entre sous le bois, par la brosse. A coup de manche de cuillère, j'ai entré une bâche de randonnée là-dessous, blindé, obturé. Le maximum a été fait afin que cette survie soit douce.
Je ne suis plus lavé depuis cinq jours. Mes réserves d'eau tiennent bon, je fais tout avec parcimonie, voire presque de l'avarice. Sortir dehors n'est plus envisageable, c'est la mousson version 3 degrés Celsius, in the mood for love version dans ma caravane et dans le noir. Ce qui avait été très difficile avec la neige, c'est d'avoir eu mes vêtements mouillés. Cette fois-ci c'est bon. J'ai au cœur la gratitude immense d'être au presque-confort, quand bien même sont présentes la peur et la nuit blanche, dont je me fous comme de l'an 43 avant Louis 15. En ces instants, j'ai une pensée pour Gyumri, au petit peuple de Torosgyugh et des environs. Ils doivent être en plein hiver. Leur gentillesse et leur humilité ne sont qu'un enseignement : ne pas se plaindre.
Je ne sais plus me positionner entre l'exploit de tenir bon dans de telles conditions, ou simplement la contemplation, remercier la somme d'éléments qui font que ça va bien. Raymonde n'est pas renversée par le vent. J'ai accentué ses pentes vers l'avant (c'est désagréable mais utile) afin que l'eau des gouttières déverse plus vite les fleuves d'ondées folles de rage. Le sol tremble par moment, je pense que des arbres tombent.
Je pourrais détester ce lieu, qui décidément - dès le premier jour d'ailleurs - m'en fait voir de toutes les couleurs. Je pourrais être sans sentiment envers cet endroit ingrat. Non pourtant. Les Cévennes ne s'obtiennent pas, elles s'apprivoisent. Il faut apprendre à prendre le temps. Lorsque je décidai d'écrire ici, je ne me doutais pas de devoir arriver à de telles extrémités. Je ne sais pas si le potager survivra à un tel assaut, dehors c'est la guerre. Je n'en sais rien, on verra plus tard, quand bien même ravage probable il y a, il s'avère que je suis tellement heureux de survivre. Ca peut paraitre bête - et ça l'est probablement - des instants comme ça, c'est la reconnaissance, le remerciement et inévitablement une pensée pour les oiseaux, qui doivent vachement en chier.
Il ne vient pas d'autre mot que de dire que je me sens très petit.
La nuit fut pour le moins agitée, c'est le cas de le dire - on pense à un vieux tube des années quatre-vingt : nuit de folie. La pluie s'est faite rageuse. Plus verticale la pluie, horizontale, balayée par des vents déchaînés. Puis à quatre heures, plus inquiétant encore que la pluie, le vent. Ca a fait des boum sourds, ce sont les arbres qui s'arrachent et s'écrasent. Derrière, un grondement persistant, sombre et horriblement sinistre, ce sont les flots de la rivière de Thines qui deviennent un déluge de ressentiment.
Les vents ont fait tanguer Raymonde, même dans le sens de la longueur, c'est inconcevable. Si j'étais en large, je n'imagine pas un instant. Le bois s'est mis à craquer, sous la pression orchestrée par la tempête haineuse. En ces instants, assez longs tout de même - plusieurs heures - la pluie n'a plus frappé la toiture, ça volait de partout. D'ailleurs je ne parle plus de pluie, je parle d'eau, des seaux d'eau.
Au petit matin, heureux survivant, aucun dégât chez Raymonde (mazette !), j'ai suivi les ordres de François. Lors d'un épisode cévenol, tu ne dois pas rester au chaud. Tu dois sortir pour voir où coule l'eau. Mais je le redis, tu dois y aller !! Ceux qui le connaissent l'entendent sans nul doute.
Curieusement, les dégâts sont assez modérés eut égard à la violence. Le potager demande deux jours de réparation, les routes et chemins sont des flots, la rivière de Thines se prend des allures de chutes du Rhin. Ce ne serait pas si dramatique pour en bas, ça en serait même joli. Les deux ponts ont tenu et ça c'est remarquablement une bonne nouvelle.
Je suis vivant et au sec. Oui certes au vu de cette petite sortie, mes vêtements ne sont plus que soupe, mais il est vrai qu'il fallait voir. L'eau coulait à grands flots chez les canadiens, je n'aurais jamais cru. Les terrains sont inutilisables.
La tension va retomber au cours d'une très longue journée d'indolence, il n'est toujours pas possible de sortir, deux à cinq millimètres par heure sont attendus. Mais ce n'est plus rien. Le plus gros de l'épreuve est derrière. Tant de gratitude au cœur que tout se soit si bien passé.
La pluie s'est estompée doucement, permettant à nouveau la vie, la nature épuisée.
Cela fait à présent six mois que je suis sans domicile. De passage à Maintenon, domicile des parents. Quel changement de vie ! Puis l'hiver ouvre ses portes, les paysages ne sont plus verts,
Il peut paraître curieux de trouver un quelconque avantage à être sans domicile, et pourtant c'est le cas. Lorsque je suis parti de Belgique, j'ai effectué la démarche de me faire rayer des registres de population. Arrivant en France, je ne me suis pas recréé. De ce fait, je n'existe plus : administrativement je veux dire, car sinon, si une chose est bien claire, j'existe comme jamais. Fort. Au sujet des quelques démarches administratives (carte grise du véhicule), mon frère assure l'indispensable intérim - qu'il en soit remercié et il le sait ; autrement je ne suis qu'une émanation du néant. Le seul impôt que je paye est la TVA sur les objets de consommation courante, des achats qui se réduisent comme peau de chagrin, fabriquant chaque jour une autonomie de plus en plus forte.
Cette propension à ne plus rien payer est un acte de résistance : que les politiques n'aient plus rien de moi -à ce titre, je ne vote plus-, que les banques soient à sec autant que possible. Pas trop gilet jaune, grève et autres combats dévoyés de leur sens (respect malgré tout pour extinction / rébellion), ma détermination consiste à ne plus leur permettre d'être toxique : goutte d'eau certainement, mais je pose mon geste. Yannick disait à leur sujet : tout ce qui se passe est voulu, ce sont des architectes. Véridique ou pas, je ne le sais, mais effrayant pour sûr. Acte de résistance ultime, ne plus leur appartenir. J'affirme, ils m'ont perdu.
Le présent comme l'avenir se dessinent avec une certaine forme de précision désormais. Possédant Raymonde, la belle roulotte, je suis indépendant du point de vue logement. Presque au bout des démarches au niveau de la ferme, je gagne jour après jour des millimètres de petit escargot quant à une indépendance alimentaire. La source permet d'avoir de l'eau. Au niveau énergétique, le souhait est de turbiner la rivière toute proche ; en attendant je ne consomme rien, l'équivalent d'une charge de téléphone par semaine sur la batterie de la voiture, qui roule peu. Quant au chauffage, les prochains jours verront l'installation d'un poêle à bois, ce qui permettra de chauffer avec les arbres morts qui jonchent le terrain d'à côté. Le très grand avantage du lieu où je suis est de ne voir personne de chez personne, donc quelle que soit la philosophie de mon séjour, je ne dérange pas. C'est un essentiel.
En mars dernier, lorsque je remettais ma démission, j'avais une vision floue de la manière de quitter la société. Ca s'est affermi. Il est clair que j'ai traversé de fortes embûches, certains le savent, mais je reste convaincu que la démarche vaut la peine endurée et disons même d'être perdurée. Je comptais que tout soit fini pour novembre, en réalité un an est (et sera) nécessaire, donc février.
Mardi passé, je suis parti de mon havre de paix en Ardèche, pour une semaine d'absence, à durée indéterminée d'ailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait bizarre de retrouver des paysages urbains, dont notamment une curieuse et injustifiée sensation de danger ; la vallée du Rhône, l'industrielle vallée du Gier, la banlieue d'Orléans et surtout l'infâme ville fourre-tout au relent commercial-de-merde dans les boîtes à chaussures en métal banales et insipides + friches desdites, la périurbaine Saran. C'est une question de perception et comme tout on s'habitue, mais mazette que l'on est bien dans ce trou paumé dans ma vallée, autrement qu'une nuit de tempête. Ca offre une stabilité, un calme, une sérénité, un apaisement. Somme toute on en vient à se moquer d'à peu près tout. Le seul stress est la bagarre des merles sur la toiture de la roulotte (c'est dire), ou bien encore le regard passablement courroucé de l'écureuil, par la fenêtre, se disant c'est quoi ça chez moi ! Le destin est certes médiocre. C'est une vie modeste. On s'en accommode bien, je peux l'assurer.
On s'accommode de plus que ça. Curieux cheminement parallèle d'ailleurs - car étonnamment il m'en fut parlé, c'est rare - on se fout de la fin (et je n'aime pas parler de la mort, car ça donne un sentiment lugubre). La fin devient un évènement accepté, serein, lucide, non désiré mais non craint. Ca ne dérange pas. Ca devient banal, comme une pluie un mois de mars, comme la trille d'une fauvette à tête noire ; simple, beau, anodin, paisible, oui surtout très paisible. Ici les questions qui se posent sont d'un pragmatisme qui confèrerait à l'emmerdatoire pour 99% de la population : comment cuisiner les châtaignes, comment désherber de la fétuque bleue ? Par exemple je veux dire. En réalité c'est de ce type, mais il y en a plein des questions, et des fois un peu plus complexes ; mais surtout plus de train plus de voiture plus d'emploi salarié plus d'argent plus de relation sociale compliquée et fausse. Que dire du passé ? Une personne [vraiment peu au fait de la réalité] évoquait une sortie de crise. Mais il n'y a aucune crise ! La crise, pour autant que je la saisisse bien, c'était en mode diffus et collant ce que la vie d'avant m'obligeait à construire sur un biais permanent, un rapport à l'argent, à la relation sociale broyée dans un moule de conformisme : cela ne s'est d'ailleurs jamais vraiment bien passé, d'où le fait que j'étais pris au mieux pour un original, au pire pour un type désagréable. Au fond, mon âme violentée demandait à être hors de leur machine à mastiquer l'humain, la satisfaction d'être un plus-grand-chose ; rien de dépressif là-dedans, au contraire, un petit être rattaché à la terre, ce qui s'est par trop perdu, et pas rattaché au bitume au final. Les gens me trouvent sans fard voire brutal quand je parle de la fin ; voilà, en fin de compte je n'en suis pas le seul. Soit. Cela est bon.
Du coup, être ici en région parisienne, c'est à dire ailleurs, ne se fait plus porteur de sens, ou disons pas plus que ça. C'est vivre pour vivre, attendre demain pour demain, sauf que demain - le vrai demain sans évoquer dans je ne sais combien de temps - j'y retourne, vers mon refuge. Ici temporairement dans cet ermitage familial semi-urbain, je retrouve le mal de vivre, celui qui a dévasté mon enfance, à force de moqueries acharnées sur mon physique, mes vêtements, ce qui a provoqué un manque de confiance atroce, depuis surmonté à force d'un certain acharnement. Là-bas en la Vallée, ces souvenirs ne s'accrochent pas, les griffes ne se plantent pas, j'offre sans m'en rendre compte une planche savonneuse. Cela me fait revenir sur des paroles de Dominique A (pas plus d'affinités que ça), mais des propos forts tout de même : Ils reviennent sur les lieux où ils ont mal vécu / Contents d'y retrouver leur truc mal digéré / Vautrés dans du regret, dans tout ce qui n'est plus / Ils aiment tant ces histoires dont on sort accablé. C'est... Maintenon, une somme de ravage pétri de moisissures, mon frère et moi y sommes non par affection, mais plus par naturel et sain dévouement.
Dix-sept heures, sortie du collège, rue Maurice Lécuyer. Une horde de bus quitte l'école, destinations lointaines : Soulaires, Saint-Martin de Nigelles, Villiers-le-Morhier. Les villages environnants, la nuit tombe. On leur apprend à être serviles - le bruit des autobus - on leur apprend les transports en commun. A gauche, une maison avec clôture, une pub rénové par qualibat et autres du genre. Les maisons sont des boîtes. Les parents font tourner des boîtes, de com peut-être, au coin c'est un journaliste à l'Express. Juste à côté ils ont un petit chien. La longue file de bus s'éloigne. Cela me remplit d'une immense mélancolie.
Passons.
Dès demain, un jour d'après un peu plus symbolique et éloigné-mais-pas-trop, je reprendrai l'écriture de la vallée, celle de son immense solitude - là où les animaux ne sont pas pétochards tellement il y a peu (pardon il n'y a pas) d'humains : là où l'on peut se permettre d'être fragile, très fragile au fond du cœur, et où le moindre lever de soleil offre la réparation : d'un côté Tinder et ses sommets de normalité-glauque plus ou moins le burger-king de la sentimentalité, de l'autre côté les pentes rudes peuplées de genets, un geste rustre de la montagne lorsque tu grimpes, le silence touffu des châtaigneraies, jamais tu n'y auras mal au cœur. Simplement tu regretteras d'être si seul, que cela ne soit pas naturel pour les gens d'être là, mais au fond c'est bien, tu es bien, et tant mieux.
Il fera nuit quand je partirai. Ici l'offre est alléchante. Douche chaude, chauffage régulier, nourriture industrielle contrôlée, rassurante, la télé en berceuse de fond, électricité à foison, large espace de vie, supermarché et j'en passe. Aux creux de la nuit, partir vers le froid, le pas si sûr que ça, faire la nourriture de ses mains, être terriblement seul, se laver dans la rivière en décembre, une offre moins attractive certes, mais je peux garantir que l'air est bon et la lumière guérit le cœur. Il n'est point de douleur ici qui soit due à la méchanceté crasse des gens. Même si la Vallée est dure comme un vieux bois sec au sol, peu importe, cette pureté guérit. Aux creux de la nuit le bruit sourd d'un départ, alors je passerai Saran au lever du jour, bordé de la friche Quelle, taguée et jonchée de détritus incendiés. Puis voilà, simplement la route deviendra plus petite, puis plus petite, puis plus petite. Au fond ce sera la vallée. Il me manque que demain soit un simple aujourd'hui.
Puis, le retour au pays s'est passé comme les mots l'avaient prédit, les routes sont devenues plus petites et encore-encore. A partir de Lanarce, je n'ai plus vu personne, enfin plus un humain je veux dire - seul un vieux moustachu sorti d'outre-tombe arrachait un antique grillage peu avant le hameau, presque l'envie de s'arrêter pour lui prêter main forte. Ensuite... deux chevaux et un âne se promenaient sur la route, c'est ça mon coin, ce qui fait qu'on y est bien d'ailleurs. Loubaresse, Borne, les hameaux désertés sont passés doucement, reliquats de congères, à partir du col de la croix de la Femme Morte (quand même !), on arrive au plateau venteux et austère de Montselgues. Puis la Vallée. Les feuilles ont bruni durant ces huit jours, des cailloux sont tombés sur le parking de Thines, ça fait hivernal ; les températures sont clémentes malgré tout. Le silence m'a envahi, ou plutôt je me suis immensément laissé envahir par le silence. Sérénité.
La question du peuplement revient souvent, force d'insistance sur les pentes désertées : combien de fois le martèle-je, quasiment à en faire une uchronie. Une petite lumière là-bas au loin, seule, dans un noir gigantesque, la vie. Ici on n'est pas nombreux mais on s'organise, par là on n'a rien mais on partage tout. Je n'en fais pas un lieu idyllique - nappé de rêve et d'une bonne dégringolade lors du retour à la réalité - non c'est un endroit avec ses galères, ses noirceurs, mais quelque part aussi avec un lot de bonheurs qui permettent d'envisager la vie sous un autre angle : lenteur d'abord, lenteur avant tout, puis démantèlement de l'individualisme (qu'il dit en racontant sa vie à outrance à longueur de pages, soit, il fallait le dire quand même).
La vie est solidaire parce que le milieu est dur. Simplement. Et je voudrais en parler de quelque manière que ce soit, il ne reviendrait que cette logique. Cela explique que de mes quatorze kilos de crème de marrons, plus de la moitié soit déjà donnée. Oui, même pas vendue. Pourtant c'est une curée à produire ce genre de préparation. Peu en importe, on vit comme ça et voilà. Lorsque Raymonde s'est mise en travers dans le dernier lacet, menaçant de chavirer sévèrement dans le ravin, les voisins ne m'ont pas demandé du chocolat noir avant d'agir ; à ce titre ils ont abandonné leur repas.
L'individualisme tel qu'il se bâtit dans cette ferme sert à rendre
autrui heureux, partager ce que l'on produit de ses mains sans rien attendre
de retour. Lorsque je ne travaille que pour moi, je suis tout autant heureux,
mais la mélancolie latente n'est jamais loin. Il suffit d'un léger
basculement pour qu'elle devienne collante. Peut-être que d'un point de
vue pratique, ensemble fortifie ainsi que rendre heureux multiplie, mais soit
ce n'est pas à la vallée que vont se développer de telles
philosophies de comptoir (bar le Bluebird, à côté du Narval,
pour ceux à qui ça parle) : et en proximité peu ou prou
du miracle, nous ne sommes pas nombreux mais nous nous organisons.
L'église de Thines domine la vallée, majestueuse, imposante, respectable.
Dans le hameau complet, une seule lumière au-dessus du Gerboul ce soir,
le village est pour ainsi dire vide et ça fait beaucoup de noir, lumière
ténue, la vie, cachée derrière une fenêtre aux rideaux
tirés. Dès fois je me demande ce que je suis venu foutre ici,
le cœur rempli de noir, vague à l'âme virevoltant, évanescent
: du noir dans du noir ça ne se voit pas : c'est peut-être une
forme d'apaisement : se marier à la nuit pour disparaître telle
une ombre, ici on a la paix, ici on a la paix, l'absence de jugement quand on
est pas à la hauteur, les voisins ne m'ont pas jugé quand je me
suis gaufré avec Raymonde dans le dernier lacet ; ils ont aidé,
puis sont partis comme ils sont venus, fuyants, retournant à leurs solitudes
de ouate. Ca doit être un peu pareil pour les gens de la mer. Pareil oui
probablement. Des ombres dans la nuit, des gens franchement pas à la
hauteur mais qui y arrivent. Alors la crème de marrons.
Notre carte de géographie est celle des routes qui font plein de tournants, ce sont ces mini-routes blanches qui n'apparaissent que lorsqu'on zoome au maximum sur les applis de carto. Nos géographies sont les noms des lieux que personne ne connait (limite Lozère, massif des Cévennes, ça évoque les cèpes en automne, la bonne odeur de l'humus) ; trente kilomètres autour à vol d'oiseau c'est à peine si on connait, enfin nous-mêmes je veux dire : en certains endroits, je pense à Rocles, ça peut largement dépasser l'heure et demi de voiture. Une pensée pour tous les gens qui subissent les grèves dans leurs trajets, leur commute time, à tous ceux qui grèvent pour défendre encore un minimum de leurs droits en charpie, leur quotidien urbain est à ce point différent. Nos géographies sont en fin de compte l'héroïsme quotidien des ouvriers de la mairie, d'entretenir un territoire pareil - pour un peu, j'en viendrais à aimer la politique ici, tant elle confère au dévouement et au renoncement (il faut être retraité et rentier disait le maire), ils viennent d'ailleurs de renouveler les piquets pour la neige, des bâtons en bois dans du gravier - c'est peu dire que je ne les connais pas ces ouvriers, je ne les ai jamais vus, il faut avouer que je suis plutôt discret, mais leurs marques d'existence sont bien là. Il y en a plein des trous paumés comme ça. Plein. Mais la Creuse ça résonne mal. Vide. Moche. Insipide. Des sapins en mode sylviculture au kilomètre. La Lozère renvoie à des rêves d'enfance profonds. Noirs d'ailleurs. Les chemins sombres, la pluie qui vient de s'abattre cette nuit, il fait froid.
Maintenant se pose la question de savoir si je suis paysan. Je préfère cela à agriculteur (ceci étant, je ne suis pas), voire même à exploitant agricole (mon dieu, exploitant, du mot exploiter, bref...) ou alors des fois je me perds dans des longs monologues passifs : autonomie alimentaire, énergétique, etc etc ; dans des cadres plus spécialisés, on parle de survivaliste ou de collapso. A vrai dire, je ne sais même plus si cela me touche quelque part : la matière est intéressante, sans aucun doute, mais me semble curieusement étrangère, de plus en plus en fait. Même plus convaincu que c'est dommage. Paysan c'est quoi ? Celui qui vit de sa terre, de la forêt ? Le seul gugusse (avec un béret j'imagine, sinon il y a une faute de goût dans l'imaginaire collectif) qui va dans le vallon, là où le chemin finit en impasse, sente sur aucune carte d'ailleurs, le lieu perdu duquel les sangliers se repaissent. Paysan ramène à une imagerie rude et rustre. D'après le Larousse, personne qui vit à la campagne, de ses activités agricoles. Que dire de plus ? La tête du préposé administratif lorsqu'il faudra cocher la case du métier ? Agriculteur donc ? Il y a quelques jours, Ezéchiel a gravement " beugué " quand j'évoquais n'avoir aucune machine. Volontairement. Ce fut encore pire lorsque j'ai dit ce dernier mot.
Cela fait plusieurs semaines que je suis en errance, essayant de me positionner entre producteur local et cultivateur. A chaque fois la tentation est grande de n'être rien (parce que ça fait du bien), d'être noir dans la nuit, d'être humain, d'appartenir à la vallée sans que cette dernière ne m'appartienne pour autant, d'être mélancolique ou pas [dans l'emploi salarié, il faut être communicatif, souriant, dynamique, aimer le contact, avoir du leadership, voire même allons loin puisque c'est permis, avoir un esprit pour la vente] ; ici c'est exactement pareil sauf que c'est totalement l'inverse, à force l'emploi salarié perd son sens, forçant des gens à ne pas être eux-mêmes, masque, diversion, déguisement, dissimulation - ici en quelque sorte l'esprit premier est la lenteur (tout est très-très lent), la solidarité primordiale parce que seul c'est quand même dur, puis le reste est simple, être mélancolique parce que ça ne veut pas dire être dépressif [s'imprégner d'un paysage hivernal brouillardeux -voire cafardeux- tel un bonheur, une essence, une huile essentielle], être pas grand chose, c'est bien un pas grand chose. Peut-être même est-ce bon de ne trouver aucune réponse, n'est-ce pas l'ultime témoignage qu'aucune réponse n'est à donner ?
Un rat taupin a creusé mes semis et a mangé mes noyaux de prunes. Cette petite enflure a truqué mes trucs !! Je mets sa tête à prix, reward à 10.000 dollars, je l'offre à Jean-Louis si jamais le bandit est capturé ! Le ciel est lourd, plombé de nuages gris à l'aspect ondulant. J'ai méticuleusement réparé les dégâts puis m'en fut creuser mon canal d'évacuation des eaux, lequel évitera de bien fameux dégâts lors du prochain épisode cévenol. La nuit est tombée, noire d'ombres rampantes, le soleil depuis longtemps enfui derrière l'Everest de Thines, le cœur envahi d'un brouillard obscur et laiteux ; alors je monte la pente, le cœur griffé dans les rameaux d'églantier (j'avais vraiment dit qu'il fallait que je l'élague), puis la lune a bondi comme une foldingue depuis le Nogier ; ça lui a pris comme ça. Nos ruralités sont un peu cela. Ca en serait pour un peu affligeant, écrasé de banalité morne, si au matin très tôt, la fauvette ne venait pas babiller de son langage volubile et impétueux.
A Maintenon, lorsque je m'y rends - quelque part probablement un rythme de tous les six mois - on me dit systématiquement : tu verras, rien n'a changé. La petite ville se laisse mourir, négligente, encroutée, fainéante. Il faut dire qu'ils ont le même maire depuis 25 ans, vieux et triste sire assoupi. La ville respire le manque de dynamisme et le laisser-aller. Ici dans la vallée, à revenir après une absence, rien n'a changé non plus. Les feuilles d'arbres sont beaucoup tombées oui. Sinon rien. Ce grand rien presque-du-tout en vient à former une rassurance. La maison de Jean fut bâtie en 1480. Les ruelles en gazon, entre deux murets antiques, cela devait en quelque sorte être le paysage d'antan. Le hameau vit au rythme de la nature et offre un sentiment radicalement différent ; ici tout est pétri de l'absence. C'est de cela que l'on a besoin.
Un chevreuil a décampé alors que je traversais la châtaigneraie de Garidel ; dans les monceaux de feuilles, sa course a fait du bruit. Des gens lisent mes mots, des témoignages affluent, j'en suis ému jusqu'aux larmes. C'est dur voire fragile pour moi car les écrits sont écorchés et sincères, mais il faut assumer. Au-dessus de Garidel, vers le captage de Gilbert, la vallée s'ouvre en entier, il n'y a aucun obstacle à la vue : des routes qui deviennent de plus en plus petites, s'évanouissant dans un paysage de pentes abruptes. Parti tard, peut-être un peu trop mais ce n'est pas grave, je me suis fait dévorer par les ombres et gagner par la nuit. A mon tour, je suis devenu une toute petite lumière fébrile au loin, dans les combes ; la vie.
L'hiver bat désormais rage.
Je me laverai au printemps prochain.
10 décembre à 18h58.
Voilà le genre de pensée qui me vient au cœur - avec une
certaine sincérité - quand je plonge les mains dans le bassin
(et disons... un peu plus que les mains). La telle solitude qui règne
ici promet de sévères hésitations, et lorsqu'il s'agit
de se laver, c'est curieux, mais il se trouve toujours tant d'autres choses
à faire ! Disons-le assez simplement, Moulaine à côté
du bassin, c'est Center Park. Graduellement, le soleil décline derrière
l'Everest de Thines de plus en plus tôt. Je sais que dans 11 jours, ce
sera le plus court ensoleillement. Après ça remontera. C'est loin
mais ça sert d'encouragement.
Ici le temps ne compte pas, le temps n'existe pas, tout est lent, tout est long. On s'en moque complètement. On, c'est Émy et moi. Que peut importer qu'il soit longuet et monotone de faire ceci ou cela, ça ne pose aucun souci, il n'existe aucune relation sociale pouvant former contrainte. La vie d'ici est forgée par la nature - puissamment - le lever du soleil et son coucher, la pluie, la neige, le vent, les aller-et-venues des animaux. Autrement il n'y a rien. Plus précisément, il n'y a rien du tout, qu'une grande liberté, plus personne qui veut du mal, plus personne qui vient râler (puis faire exactement la même chose que ce dont il râlait contre), plus de trajet, plus d'heure. Au tout départ ça déboussole. On se sent vide. Puis la nature vient remplir. Le rouge-gorge vient picorer dans la terre fraichement labourée, ça en devient un évènement, c'est attendrissant : à part ça il n'y a strictement rien et en fait, c'est agréable.
Sur les pentes de l'Everest de Thines, les chiens hurlent. On entend distinctement leurs clochettes. C'est la chasse aux cochons qui est terminée. Les chiens sont en errance (là ce sont probablement ceux de la fédé de Montselgues), et ça peut durer plusieurs jours. Les aboiements lointains vont et viennent au gré des trajets erratiques des bêtes. Puis, un soir, on se sait jamais pourquoi maintenant, des phares très au loin descendent la piste. L'un d'entre nous murmurera entre ses lèvres : tiens, ils viennent les rechercher.
Les voisins sont pareils. Le temps ne les marque pas, d'aucuns je ne saurais dire l'âge. Sur leur terrasse, ils se moquent du temps, on a le temps (et on aura du temps pour toi quand tu viendras). Mais nous sommes solitaires. Fragiles et endurcis. Les voisins sont fuyants. Ils traversent le potager, de loin en loin ; probablement ils vont chercher du bois, ils ont fendu un vieux châtaignier mort le mois dernier. Un signe de la main, un sourire, mais une distance certaine : nous ne nous évitons pas, nous sommes simplement bien comme ça, loin, avec le rouge-gorge, les histoires de chiens et d'autres bagatelles telles qu'un lever de soleil rouge qui en viendrait à nous bouleverser, pour peu. C'en est pas loin.
Nous sommes des solitaires à apprivoiser, gentils mais fuyants, plein de tendresse mais renfermés. C'est d'ailleurs sur ce genre de décalage qu'est né adopte un collapso, au tout départ avouons-le d'une simple blague potache, puis ça a pris de l'ampleur. Peu importe adopte, ce qui compte est le fond de vérité : qui voudrait de nous ? Qui voudrait d'une vie vide comme ça, qui voudrait d'une vie rude comme ça ? Le silence vespéral nous convient, nous ne changerons pas, ou plus, ou peut-être que si, mais au fond du cœur, pour l'instant on ne l'espère pas
Lorsque l'on était môme, on nous ressassait régulièrement : si tu n'as pas de bons résultats à l'école, tu finiras caissière [la tête de la caissière le mois dernier, quand je lui annonçais : j'ai mis tous les codes barre sur le dessus, pour que ça soit plus facile à scanner (elle était touchée), puis lui ai quand même dit : j'aurai malgré tout un produit qui bugue, ce qui lui a donné un sourire rayonnant car évidemment, il y en eut un], caissière, comme si c'était pour les idiots-patates-débiles, c'est simplement dur et très avilissant, mais derrière ces êtres humains, combien de petits cœurs qui méritent d'être écoutés ?
Alors quand je faiblis au potager (ça arrive régulièrement car je suis tout sauf acharné), je me dis : si tu ne fais pas un beau potager, tu iras dans le bureau du Prince. C'est ainsi qu'avec mépris, j'appelle mon ancien patron, qui régnait (et sévit encore) en toute monarchie, ses servants n'ayant qu'à approuver sa voix sainte, ses manants à s'écraser sous le joug de sa noblesse. Dans le bureau du Prince le regard perdu sur sa pierre écrite en égyptien ou étrusque (je ne me souviens plus), sa chevalière de noble-société, à mendier un emploi salarié maladif, harcelant, violent, dégradant, toxique, haineux : on me donnât même un jour des consignes claires de ne pas intervenir, car il s'agissait d'une personne âgée en détresse. Sous étroite surveillance, cette fois-ci je n'avais pu intervenir, au contraire de bien d'autres (en stoem dira-t-on en belge, ce qui signifie en douce). Du coup, lorsque je pense au Prince, je retrouve une énorme ardeur à faire de ce potager un presque-eden ; le potager puis d'autres choses : les cueillettes sauvages, la cuisine, voire même en poussant le bouchon un peu loin, couper du bois : faire très peu mais le faire très bien.
Lorsque je suis retourné dans la ville du Prince, le Monarque tel que nous l'appelions entre nous, j'en ai été malade. Je rasais les murs. Heureusement tout ça est désormais loin et ils ont - pour la plupart - la décence de ne pas me recontacter (ce dont ils peuvent être remerciés, un servant avait d'ailleurs le cœur sincère, mais je crois qu'il était un peu le seul), du coup ici ces souvenirs douloureux s'éloignent, se nappent de positif, c'est un formidable moteur, une énergie renouvelable : si tu ne désherbes pas correctement, tu iras chez le Prince. Même épouvantail qu'à l'école, la caissière (et pourtant il y a pire métier : banquier par exemple), ça marche formidablement bien. Le chiendent vole au tas de compostage plus vite que deux merles en course-poursuite.
Puis très vite aussi, fugace, ces pensées s'évanouissent, car il y a plus agréable que de penser au visage bouffi d'alcool - le vin rouge à outrance - du Prince. Ca part, ça sombre, ça disparait, comme le glouglou d'une merde qui tourbillonne dans les chiottes d'un couloir de galerie marchande dans un supermarché le long d'une nationale, dans une vaste zone périurbaine dégueulasse. Alors, l'eau limpide donne sa clarté neuve et javélisée. Quand bien même la vallée offre aujourd'hui un ciel plombé de décembre - assez humide et assez frisquet - je peux garantir qu'on est bien. La rudesse est un obstacle dont on s'accommode, dont même étonnamment on s'attache : on ne voudrait pas que ça soit autrement. Le monde des Princes (ils sont si nombreux, malheureusement) apparait comme incongru, hostile et absurde. A demi à poil dans le bassin en décembre, le long du GR, je ne suis autre qu'un rude, un rustre, abrupt et primitif. Comme je le redis, on en vient à souhaiter que ce ne soit pas autrement.
Alors c'est comme ça, le hululement des chiens sur l'Everest de Thines,
ça devient une sonorité formidablement attachante. Parce que c'est
ici, c'est notre vie, notre rythme, notre terrible lenteur : d'avoir un cœur
fermé, un cœur gelé, de ne pas savoir quel jour on est, de
s'en foutre éperdument d'ailleurs, mais par contre le vent du sud ramène
la pluie, ça oui ce sont des signes auxquels nous sommes sensibles. Ca
n'en fait pas détester les gens, comme un furieux misanthrope reclus
dans sa BAD, armé jusqu'aux dents. Bien au contraire, c'est plutôt
une histoire de coquille sur une fragilité (d'ailleurs qu'on ouvre, ou
qu'on referme, je suis incapable de le dire) : en tout état de cause
ici on ne souffre pas du cœur, on souffre du froid et de la rudesse des
travaux. Quant à choisir, il est inutile de faire un dessin.
Lorsque arrivera l'été, ça sera étrange - totalement
différent - le tourisme se concentre sur le hameau plus bas, là
au bout du bout il n'y a que dalle (et tant mieux), tout le bonheur d'une impasse.
Tandis que vous rencontrez des gens ici, tous (sans exception) ont la même
question, invariable malgré le hasard des rencontres : vous vivez à
l'année ? Il y en a très-très-très peu. La réponse
oui donne une consolidation immédiate, un respect tacite. A l'opposé,
j'imagine simplement qu'une réponse non donnerait un : je comprends...
Les âmes solitaires qui furent ici des piliers (je pense notamment à
Tony) sont presque toutes parties, aux chants des sirènes, vers une vie
probablement plus facile et plus douce. A une personne qui part, je n'opposerais
pas la pluie jaune (s'enfermer dans le moulin et se cacher pour ne pas dire
au revoir), ni la colline des solitudes (se poster silencieusement au loin pour
regarder la personne partir, lui demander au préalable de ne jamais donner
de nouvelles), loin de tout ça, je souhaiterais bon voyage, aiderais
à charger les bagages, puis regretterais le départ - une maison
vide de plus - je dis ça simplement parce que c'est arrivé aujourd'hui,
Mathilde est partie. Il n'y a aucun héroïsme à rester à
l'année ni aucune lâcheté à partir. On fait tous
un peu ce qu'on peut, c'est déjà tellement tant.
C'est la pleine lune. La peste m'empêche de dormir ! Il s'est mis à
souffler un vent impétueux dans le fond de vallée, dans les arbres
près de la rivière, ça a duré comme ça une
bonne part de la nuit. Je pensais à cela en vrac, comme souvent, quand
j'ai été à La Bombine, un peu là-haut sur le plateau,
d'ailleurs c'est la photo. J'ai trouvé une mandibule de sanglier. Alors
j'ai cherché le reste du crâne, mais je n'ai rien trouvé.
Puis soudainement, je me suis rendu compte du silence. Total. Ce ne m'était
plus arrivé depuis une virée dans une vallée très
sauvage d'Aoste. Dix ans ? Peut-être. Ca m'avait beaucoup manqué.
Ce fut beau et simple, long aussi car j'avais le temps. C'est fou ce que la
vie est différente. Je ne puis plus dire tout ce qui compte désormais,
me touche voire me transperce, une beauté rude et simple - on ne demande
rien de plus.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui je me suis lavé, et ce
n'est pas le printemps.
Pas.
Du tout même.
Episode. Cévenol. Deux mots.
Indépendamment ils constituent un bonheur à l'orée du sympathique.
Un épisode, ça signifie des histoires à se raconter, une
suite existante, l'attente impatiente, de l'engouement en quelque sorte. Quant
à cévenol, c'est le doux parfum de l'enfance, les envoutantes
forêts de châtaigniers, la nature et la beauté. Lorsque l'on
accole ces deux mots, ça construit un tout autre sens. Pluie infernale,
quantités faramineuses, longue durée. Comme le dirait François
à ce sujet, si j'en parle c'est parce que j'en cause. Et bien simplement,
si l'épisode 1 avait été un cauchemar sans nom, c'était
le 22 novembre d'ailleurs, un mois après, je traverse l'épisode
2, le 20 décembre. Super. Génial. Fantastique. Formidable. Tout
ça ensemble et rien que ça. Vlan. Ou biiim dirait mon frérot.
Faisons simple, on remet ça en janvier ? Je propose que ça soit
aussi répétitif que Questions pour un champion et aussi long que
la pub sur TF1. Avec ça, on est dans l'extase, c'est peu dire. Ne restera
plus qu'à accoler un autocollant fluo 'vu la la TV' pour que ça
soit l'orgasme.
Dès lors, j'ai indispensablement mis à jour mon profil Tinder, avant tout de nouvelles photos dans une cabine d'essayage chez Zara, puis surtout une nouvelle description plantureuse et avenante.
Homme amorçant une vie en autonomie complète en Ardèche Sud, joyeux pays des canoës et des campings baignés de soleil, recherche femme ayant un attrait pour la discussion avec les sangliers et si possible, des capacités développées pour le bûcheronnage. Tout un tas d'avantages à portée de mains : je n'ai pas vu une douche depuis un mois, j'habite au fond d'une vallée perdue, à une heure de la première petite ville et je suis en panne de véhicule. Vous découvrirez les indéniables avantages de la vie comme en 1904, la sérénité, le calme... et accessoirement mais ce n'est pas important, la vie sans électricité, sans eau courante non plus, enfin bref l'authenticité. Les rares jours où la température dépasse 9 degrés, vous vous laverez à poil dans la roulotte avec un seau. Sinon, vous bénéficierez de chaleureux matins à -2° et vous verrez, c'est splendide, le café fume (oui et quand vous pissez dehors à 3 heures du mat', ça fume aussi, hum, oui, pardon, je m'égare). Promotion spéciale : A toute vie de couple entamée, j'offre 20 stères de bois en bûchots de 30 (et une tournée chez Zara ou Jenifer si t'es sympa) (enfin je ne promets pas) (quoique ça ferait biiim, c'est si beau non ?)
Il est clair que depuis, j'ai reçu tellement de propositions que je me retrouve pour ainsi dire le chef de tribu malien polygame, accoutré d'un chapeau à plumes, et entouré d'une smala de 24 femmes toutes ébahies d'une vie si cernée de confort ludique et facile. Oui je ne sais pas pourquoi 24, ça donnait bien. Et je suis devenu actionnaire chez Zara. Loin s'en faut, c'est ça la belle vie.
De par la fenêtre de Raymonde 2, je regarde l'Everest de Thines. Il est balayé par des vents gorgés de haine, les pluies sont horizontales. C'est l'Eissero, le vent du sud, qui vient de Lafigère et qui monte là-haut, colérique et sourd, sur le plateau dénudé. Les arbres évoquent un grondement permanent sous les bourrasques pour ainsi dire ininterrompues. Ca s'engouffre furieux dans la vallée puis ça monte ravager Montselgues - comment ça je l'ai déjà dit le 22 novembre ? Pardon je radote, c'est l'âge certainement.
Epuisé, je tire le rideau fait par Mamy, dont je remercie la patience et la gentillesse. Ca permet de fermer les yeux, de ne plus penser à ça [essayer], puis tout du moins voir de jolis dessins maliens en teintes pastel. Derrière, un oiseau invisible murmurera : de quoi vous inquiétez-vous donc, des vents, des ondées ? C'est normal, parfaitement normal, puis il partira sur une autre branche remuante, impassible probablement. Ici le climat est sévère, les gens sont bourrus ; près de la borie de Bousquet, j'entendais un touriste bavarder (Alès probablement) : le granit c'est rude tout de même.
Désormais va se poser un acte, un geste, une couleur, une tendance, un avant-après au gré d'une ligne de démarcation : une frontière invisible. On va voir si je suis une locomotive, si j'ai la force de trainer dans mon sillon des gens : créer du bonheur à partir de quasiment rien [pour eux simplement], dès lors dans l'emphase voir si je suis un bulldozer, allez pourquoi pas même un supertanker, si ce n'est tant qu'on y est un Cosaque des Dragons de la Garde impériale. Tout dans la demi-mesure et la modestie discrète ! Rien que d'y penser - de l'écrire - ça me reconsolide, espéré-rustique comme un sanglier, désiré-fort comme un cheval-shire, rêvé-dur comme de l'iridium : même si je suis rongé, en réalité je ne trouve d'image plus juste. Je suis face à la dureté de la vie. La vraie vie. J'ai choisi. J'affronte. Je me sens petit. Pourtant j'y arrive ; à peu près on va dire. Locomotive ? Moi-même je ne sais plus. J'ai le visage comme les gens-des-photos-de-1904 : taillé sec, incroyablement marqué par la dureté ; mais je l'avoue j'ai un cœur en chamallow.
Je suis une abeille dans sa ruche en bois, attendant le printemps afin de sortir, en train de mourir du fait de la longueur-trop-longue.
Après la tempête viendra un soleil insolent. Comme la dernière fois, tout le bazar sera mis à sécher dehors et Madeleine se foutra allègrement de moi, disant que je fais brocante. Elle a bien raison après tout. Puis le temps passera et on n'en parlera plus.
Au gré d'innombrables textes au kilomètre, se déroulent de lancinantes plaintes chuchotées sur le froid et l'aridité du quotidien. Mais, sans doute aucun, c'est là que je veux être - il n'est aucun regret. Pour rien au monde je voudrais partir, ni même retourner au facile-quotidien-malsain d'avant. De certaines périodes dures comme il en fut, je pense en ces lieux à Berlaimont ou Rixensart, je ne nourris pas la moindre nostalgie. Je garde juste mémoire d'une grande pauvreté. Il est utile de vivre ça un moment de son existence, pour savoir-être, garder le recul, aimer autrui. Humble. Simplement.
Lorsque je pense à la Vallée, je nourris exactement le même
sentiment qu'à Otal, à Escartín, ou surtout à Ayerbe
de Broto. Une profonde paix, un puissant manque au moment de partir, une mélancolie
dévorante quand j'en suis loin. Le Méjean m'a d'ailleurs nourri
de moments inoubliables - un amour terrible - mais j'étais content d'en
partir (et tout aussi heureux d'y revenir). On est parfois secoué par
un lieu ; je pense notamment au brug van Kanne (en ayant déjà
parlé d'ailleurs). La Vallée offre un autre chose, c'est un amour
tranquille. Plus qu'un potager magnifique (même si j'aimerais bien !),
plus qu'un confort de vie basé sur une autonomie respectueuse de l'environnement
(idem), ce que je souhaite offrir aux résidents permanents tout comme
aux passagers du hasard, au-delà de toute métaphore lyrique présomptueuse
de supertanker et compagnie - si ce n'est que ça fait joli de l'écrire
- c'est cet amour tranquille. C'est ce qui émane de mon corps désormais.
Mon corps rejetant des phrases connues par cœur.
Quand ils arriveront sur les hauteurs de Sobrepuerto, la nuit, certainement,
commencera à tomber. Des ombres denses progresseront en vagues à
travers les montagnes et le soleil, trouble et défait, gorgé de
sang, se trainera devant elles s'agrippant, désormais sans forces, aux
genets et à l'amas de ruines et de décombres de ce qui en d'autres
temps (avant cet incendie qui surprit dans son sommeil la famille entière
avec tous les animaux), avait été la solitaire Casa de Sobrepuerto.
Celui qui ouvrira la marche s'arrêtera à sa hauteur. Il considèrera
les ruines, la solitude immense et ténébreuse des environs. Il
se signera en silence et attendra que les autres le rejoignent. Et quand ils
seront rassemblés près des vieux murs de la bâtisse brûlée,
ils se retourneront en même temps pour voir une fois encore la nuit s'emparer
des maisons et des arbres d'Ainielle, tandis que l'un d'entre eux se signera
à nouveau murmurant à voix basse : et que la nuit aille à
la nuit. Dans la pénombre en demi-teintes et à peine déchirée
par la flamme d'une bougie, à nouveau s'en furent les lignes connues
par cœur, précieuses, de la pluie jaune, après l'escapade
de l'après-midi à la ruine de l'Echelon ; combien de fois pus-je
les parcourir, leur dureté, une trentaine peut-être ? Le soleil
est passé derrière l'Everest de Thines à 13h35, comme l'avait
d'ailleurs prédit Léo. Une lumière sinistre à dévoré
le vallon, gorgeant les terres de froid et d'humidité.
Une fois les mains lavées au bassin, finement noircies de la terre, très
sombre ici du fait que c'est granitique, j'ai pris les chemins à travers
le hameau ; il n'y a pas âme qui vive : partir vers la hauteur de l'Echelon
permet de bénéficier d'une heure de lumière supplémentaire,
du fait que vers le ruisseau des Coulets, ça met plus de temps à
sombrer. Les chemins sont oubliés et envahis de genets, seul un œil
expérimenté permet de déceler ces pierres, détraquées,
qui dans des temps immémoriaux furent le bord de la sente, en terrasse
; à ce jour tout est soumis au pillage des pieds des cochons et comme
la quasi totalité des Cévennes, hormis le tourisme estival dont
on sait le ravage, l'abandon le plus complet dévore les hameaux aux rues
déglinguées. Cette semaine, les jeux sont d'ores et déjà
faits pour que je ne voie aucun humain, il se peut d'ailleurs que cela se prolonge
à plusieurs semaines du fait que j'ai réalisé de conséquentes
réserves de nourriture. Les voisins sont absents actuellement - quand
ils sont présents, ils sont fuyants comme des renards dans la pénombre.
Mes pas foulent les feuilles de châtaigniers, en épais tapis ici
étant donné que le bord de la sente est un muret, même chemin
qu'hier au captage de Gilbert, depuis longtemps parti, et probablement l'unique
homme à en arpenter les lieux depuis des mois ; seuls peut-être
des chasseurs y viennent, et encore ? Je savais, arrivant ici, que je prenais
part à l'histoire d'Ainielle, mes écrits des premiers jours, premières
heures, en gardent une marque, une gravure, un trait profond et hésitant
; le papier complètement trempé et maculé de tâches
d'encre, je l'ai encore. Après le ruisseau, j'ai pris la pente, dans
les arbres effondrés, les terrasses éventrées et les épines
noires.
La maison de l'Echelon se trouve sur un versant aride et caillouteux, au beau
milieu de plus rien désormais. Aucun chemin n'y mène. Sa position
en promontoire fait qu'on la voit bien, avec sa forme en L, de très loin,
même depuis le Ranc Fournassier. Il parait qu'elle appartenait à
Darboux, enfin c'est ce que le pays dit. Au gré d'une pente assez prononcée,
elle est précédée d'une vingtaine de cadavres d'arbres,
lançant leurs cimes décharnées vers le ciel brut - les
troncs à la base pourrissante, lourd de menaces de la nuit déjà
proche ; la lune s'est enfuie du Nogier depuis quelques instants. On arrive
devant la vieille bâtisse par surprise, car un dernier éperon rocheux
en barre la vue. Elle parait belle, austère, rassurante, mais elle est
morte.
Anciennement sur trois niveaux, les planchers sont troués et assez dangereux, certains pans sont tombés. Les cochons entrent dedans, comme en témoignent de multiples crottes éparpillées. Au sous-sol, ce fut une étable. Le sol, constitué d'un antique lit de bouse, est crevassé de toutes parts. Mais le plus étonnant est probablement l'étage du milieu, dont la cheminée à côté de la porte : il s'y trouve un amoncellement de bouteilles, qui soudainement fait rappeler qu'il y eut de la vie ici, et pourtant tout respire le cadavérique, une épaisse couche de poussière, un magma indéfinissable, recouvre les objets. Je referme la porte, tout du moins ce qu'il en reste.
De retour au travers des châtaigneraies, j'ai brièvement regardé la maison de Darboux, funèbre respect, isolée au bout d'une longue terrasse en friche, seulement bordée de vieilles planches en état de putréfaction avancé. Que va-t-elle devenir, maintenant qu'il est mort ? Les acquéreurs ne se bousculent pas au portillon par ici, et si l'on en croit l'avenir du cimetière, je serai peu ou prou sous peu, un temps hivernal certainement, le dernier d'Ainielle, (puisse-cela être un symbole, mais il est vrai que l'analogie est étonnamment proche). Les terrasses de Darboux sont profondément gravées du signe de la solitude et du recueillement, les ruches sont vides, le terrain respire le sommeil du mort, on le sent encore présent, c'est d'ailleurs probablement le cas. Lorsque, vingt ans auparavant, mes mains se posaient sur la pluie jaune, lorsque, dix ans auparavant, mes pas foulaient les rues enherbées / inoubliable et ému / en pèlerinage précieux, Ainielle, Escartin, Otal, Berbusa, Oliván, Cillas, Cortillas, Basaran, j'étais loin de me douter que je serai à l'aube d'être l'un de ces derniers, au milieu des sangliers et des chevreuils, seul - il se passe comme une projection, non c'est faux, c'est une outrance, une démesure ; puis, passant le bassin dans lequel reposent actuellement des têtards noirs de salamandres, mon regard s'est porté sur les hauteurs du ravin de la Devèze, gorgé d'humidité glauque, puis la Boissière surmontée de la maison brûlée, en ruines depuis une trentaine d'années, j'ai ressenti la déréliction, le regard afférent de n'être plus rien qu'un tout petit être invisible dans les ondes de genets balayés par les vents nocturnes. J'ai refermé la porte sur la nuit et le silence, s'en fut la lune, sous les hululements d'une chouette hulotte solitaire.
Après un repas silencieux et sans le moindre but, je suis ressorti, la veste serrée, le bonnet engoncé. La pleine lune offre une lumière pâlotte et lugubre, qui porte des ombres gigantesque sur les parois de granit des maisons froides et désertées. En errance, je suis absolument seul dans la rue, la rue qui ne porte pas de nom et qui n'en est pas une, la seule voie qui finit en impasse après le passage de deux gués. Les arbres ont des silhouettes déchiquetées dans les halos blafards nocturnes. Remontant par le sentier, je me demande comment il est possible de subir autant de silence, autant de désolation, aussi longtemps. Quelque part cela me fait profondément plaisir, mais aussi me plonge dans une obscure indifférence. Je me ressens incapable de vouloir autre chose.
Saisi d'un profond mal du pays, je repense souvent à ces endroits où j'ai dormi, très seul, dans le noir complet en plein hiver ; ces images reviennent et le manque déchiquette une blessure douloureuse. Le plus émouvant est à l'Avergat, auprès du brug van Kanne, le long du canal Albert. J'y fus des dizaines de fois, une nuit même y être uniquement pour y être. Souvent je repense aux nuits brouillardeuses à Cadzand, au loin les bateaux qui vont chercher l'embouchure du Scheldeland, les teintes pâles de Scheveningen, mon immense solitude à Middelkerke, la douceur feutrée des petites rues de Mechelen. Mais je sais que tout cela n'est qu'illusion, un miroir dans une eau mouvante, un regard à peine perceptible dans les reflets : la Belgique avait grand peine à m'offrir un présent, en quoi pouvait-elle prétendre à un avenir ? Plus que jamais il fallait partir. Là-bas que j'étais bien, ici que je suis bien, de même esseulé, les pas silencieux dans des sentes sans âme-qui-vive. Ca fait mal de repenser à ces paysages brouillardeux de Flandre qui me manquent, probablement du fait que c'étaient des instants précieux, gardés au chaud dans un cœur qui palpite. Y songer remplit de mélancolie crépusculaire.
Aujourd'hui mon imaginaire appartient à ces terres de vents - le plateau qu'ils disent - la pluie bat le sol et fait rouler de minuscules galets de granit dans les pentes, les genets ploient sous les bourrasques, le regard hâve, le visage mouillé et transi par les ondées successives ; il n'est plus d'autre terre que cette solitude infinie à perte de vue, les vallons qui se succèdent, les nuages qui courent comme des dératés dans les combes écrasées, le vent qui chante dans les fils des clôtures à bétail, (ce fut ce qui m'a le plus surpris et enchanté dans le causse, cette étrange mélodie du vent, nulle part ailleurs que les plateaux pour le chant ondulant, presque vivant, presque dira-t-on, bien qu'une pensée profondément poétique permette d'en douter), puis inévitablement ces séculaires croix de granit au bord des chemins, érodées, austères, sévères, froides pierres au milieu d'une immense désolation : rien d'autre qu'un infini plateau flexueux battu par un vent hargneux.
En ces moments, dire qu'il existe autre chose qu'un hiver ne parvient même plus dans l'imaginaire. C'est probablement que le cœur est gelé.
Quelquefois en allant chercher l'eau à Thines, j'espère ne serait-ce qu'une personne, mais ça reste rare. Solitude glaciale, pour ainsi dire insupportable.
Le village de Thines est placé sur un promontoire rocheux qui en son extrémité, forme de loin l'impression d'un éperon abrupt. C'est beau et sauvage, notamment la rue du centre fait un mètre et demi de large tout au plus, creusée inégale dans le schiste. Au milieu se trouve accrochée au mur une boîte postale jaune - pourquoi ? Allez savoir. C'est un site touristique, l'église romane est à ce titre pleinement exceptionnelle (bien que lui préférant la méconnue église de Montselgues, mais soit, cela ne relève d'aucune importance ; allez voir les deux, cela vous permettra de pleinement faire la distinction entre la vallée et le plateau, radicalement opposés, jamais ennemis pourtant).
On accède à Thines soit par la route, soit par un chemin muletier qui fut récemment appelé le chemin des poètes (il a été décoré de vers, gravés dans le bois). Au vu de l'étroitesse de la voie d'accès et l'impossibilité de stationner, la route est interdite à la circulation. Il n'y a que nous qui y allons, car nous cherchons de l'eau potable en cet endroit ; on y remplit nos bidons un peu après le Gerboul, c'est une pratique locale. En été, c'est quelque chose qui se fait très tôt, car sinon nous recevons des regards noirs.
Le parking est un lieu qui n'en possède que le nom [le rat taupier dirait que c'est un truc où on met des trucs], mais bref c'est un espèce d'élargissement plus ou moins en graviers et de terre battue, en face de Térondel. Rien de plus. Ca va bien à tout le monde. D'ailleurs du monde, il y en a, là, (pas comme après Lazonès, qui fait office de frontière (car nous plus hauts, la solitude), peu étonnant d'ailleurs qu'intuitivement j'aie placé cette limite là, désormais pleinement invariable, car ce fut le domaine des Longueville, avec le château encore présent (et désormais magnifiquement rénové), au-dessus l'austère et sauvage mas de l'Espinasse (ou Espinas) et donc oui sans exagérer, il y a Thines et son flux de touristes, et il y a chez nous, au-delà de Lazonès, très au-delà, au bout). J'imagine bien que les gens de Prévenchet ont la même chose, une frontière en pointillés, surtout vu leur localisation, les seuls au monde être derrière Thines. Peut-être un bâton, peut-être un caillou, qu'en sais-je.
Au Pays, on reconnait les touristes. Vous allez vous moquer de moi. Ils ne sont pas fuyants. Eux. Tandis que nous sommes. Oh pas méchant. Mais nous avons chacun notre chemin. On passe par-ci par-là, on se voit de loin, on se fait signe de la main, on s'aime bien comme ça. Aussi on veille aux maisons des absents ; le vent a retourné une corniche (c'est bien tout ce qu'on peut surveiller, car en 20 ans, le plus grand acte de délinquance du hameau fut que les chèvres ont sauté sur un pan de toiture de la maison de Jean et ont pété les tuiles, que veux-tu). Nous avons chacun nos parcours. Moi, avec Émy, je prends la rue des fusillés. La rue. Oui, une voie très descendante en gazon, d'un mètre ou plus de large, bordée de murets en pierres sèches. Les fusillés, c'est relatifs aux résistants qui ont été trahis et abattus le 4 août 1943, une plaque commémorative figure sur la maison de Léo et Léa. Je ne suis pas sûr qu'autre que moi utilise la rue des Fusillés. Enfin, aucune rue n'a de nom ici, on s'en doute. Il y aurait quelqu'un, j'en serais gêné. Ce n'est jamais arrivé. Jamais.
A Thines, les gens du coin disent que la Vierge à l'Enfant a été volée en 1973. Ils se mettent le doigt dans l'œil. Elle est partie. D'elle-même je veux dire. Les années 70, le début de la grande déglingue, tourisme de masse, Notre-Dame de Thines s'est trouvé épuisée de ce défilé incongru de gens peu discrets et pas révérencieux. Alors elle s'est fait la malle. Il fallait s'en douter. Ca peut se comprendre. Elle a un regard espiègle. Elle est mutine. C'est une filoute (avec tout le respect que je lui dois, la vieille dame date du XIVème siècle). D'ailleurs je n'ai pas connaissance d'avoir vu ailleurs, une fois dans mon existence, plus belle statue, plus beau visage, (mais soit, je ne suis pas musée).
Il n'en existe que deux photos. Une exposée dans l'arche désormais vide, une seconde chez Camille et Jean. Cette dernière provient d'une autre espièglerie. Une vieille dame avait sorti la statue dehors, afin d'en faire une photo à la lumière du jour, puis l'avait re-rentrée. C'est tout ce qu'il reste et personne désormais n'attend qu'elle revienne. Des copies plus-que-médiocres sont déposées dans l'église (mais pas sous l'arche). Plus personne ne vénère la Vierge à l'Enfant de nos jours. Thines n'en reste pas moins un formidable village, isolé et préservé. Beaucoup plus d'habitants qu'on ne l'imaginerait. C'est bien, c'est bien comme ça.
Nos quotidiens sont d'une immense-gigantesque-ineffable banalité. On s'émeut que la rivière soit grosse après la pluie, on parle de la terre, des chiens, puis avec un peu de commérage tout de même, des voisins des voisins. On ne sera pas une ligne dans le livre d'histoire, on n'est pas grand-chose : un rapport aux arbres, au nid de l'écureuil qu'on voit dans le faux-châtaignier, c'est un peu tout. Les oiseaux ne sont pas dans les livres d'histoire non plus. Franchement au vu de mes activités passées, j'aurais pu, la porte était ouverte, mais je l'ai refermée sans bruit et sans heurt. Pourquoi ? Vous savez, on est bien à être quasiment rien. C'est une belle place. On peut mourir on s'en fout, on vit et on est bien. Quel jour est-on ? Ca fait longtemps que je n'en sais plus rien voyez-vous ? Juste inquiet d'être si pauvre, c'est normal, c'est sain, mais dans le fond ça ne dérange pas plus qu'autre chose. C'est peut-être, au-delà de toute considération philosophique étriquée, ce qui fait qu'on est fuyants, surtout et par dessus tout face aux gens qui-sont-pas-du-pays, on a crainte d'être pris pour des moins-que-rien, alors que nous nous satisfaisons d'être juste des un-peu-rien, des crève-misère parfois aussi, mais on se débrouille. Je sais que la frontière est mince, un peu comme celle qui se trouve au tournant étroit de Lazonès. Pour vous ce verbiage n'a aucun sens, pour nous c'est important, remarquablement, mais je comprends ; c'est normal.
Par dessus tout, que Dieu nous garde qu'il se passe quelque chose ici. Qu'il nous protège des nouvelles constructions, des antennes, des lignes haute-tension, des projets en grande-pompe - journalistes-et-politiques - des gens-tout-court à la limite, certains matins en tout cas, surtout quand l'écureuil réalise avec brio une intrusion dans la maison. Qu'on nous laisse en paix, lui et moi, lui parti, moi tout seul. Retranché(s). Solitude dans une marée montante de vent, qui grimpe à l'assaut hostile de la vallée vers les Boyer, puis Montselgues au fond comme ligne de mire. Crève Cévennes dirait Jean-Pierre Chabrol, du temps où l'on imaginait ne serait-ce que ça puisse avoir une âme, mais ce n'est plus vraiment car les terres ont été désertées au gré d'exodes ruraux successifs en millefeuille ; plus d'ici le moindre mescladis occitan respirant bon l'authenticité, un vieux au béret, au pantalon de velours, rude comme un bout de bois de châtaignier séché, nous sommes une consommation de ludique estival : Thines avec Vallon-Pont d'Arc et Ruoms en une seule journée. Notre-Dame de Thines est partie un beau matin de 1973 sans crier gare.
Dans l'humidité qui me dévore, encore plus que le froid, c'est arrivé sans trop que je ne sache pourquoi, ne pouvant même plus dire si c'est de la chance ou de la malchance (quelque part ça n'influe que peu), ou simplement - prosaïquement dirons-nous - si ce fut trop long, tout ça trop long, j'ai eu de la peine lancinante et longue que la vallée ait perdu ses cœurs vivants, tous partis s'entasser dans des villes crasses et malsaines ; tout le monde se plaint de la saleté d'Alès, et que change ? Une feuille morte de châtaignier bat sous le vent en faisant un petit bruit d'hélicoptère. Il n'y a rien d'autre que cette feuille, le soleil depuis longtemps parti derrière les roches granitiques lourdes, la pluie fine maintenant. L'hiver c'est fait pour résister, ça sert à ça, la végétation en dormance, les feuilles pourrissantes au sol, puis le corps moisi, plus qu'hier et plus encore. Trop appelle à se taire. Mélancolie discrète presque effacée dans des pointillés à peine lisibles, transparents, livides. Le jour qui passe, comme celui d'hier et invariablement d'hier-encore, ressemble à une tourmente tournoyante de frelons enragés, au milieu d'un terrible immobile. Ma bougie s'est éteinte à ce moment-là.
2
Être La Boissière
C'est l'histoire d'un chien ; peut-être que la moitié de nos histoires pourrait commencer comme ça. Nous sommes habités par une immense banalité, que notre pays : la vallée, transforme en petites pépites précieuses. Et bref, c'est l'histoire d'un chien qui était fainéant.
Manioc était un basset artésien normand, donc un chien de chasse. Bernard, son maître, ancien chasseur, sortait souvent et connait du coup le pays comme sa poche. Levé à cinq heures du matin, le samedi, le chien lui lançait un regard torve : il pleut, tu es sûr que ça vaut vraiment le coup ? Avec un temps pareil le gibier ne sortira pas dis... Tu ne voudrais pas rallumer le feu ? La voiture est mise en route. Le chien se met juste devant, la bloque et marche d'un pas très lent : aah, j'ai des rhumatismes, j'ai très mal, je me sens défaillir... puis le cirque durait de la sorte jusqu'à l'injonction d'embarquer une bonne fois pour toutes.
Et c'est ainsi qu'un jour, ils montaient le Ron Sourd (l'Everest de Thines),
du temps où il n'était pas envahi de genets, [c'est un peu comme
tout ici. Dans le temps et en tout cas avant 1914, Tastavins comportait 800
habitants et l'entité de Thines à elle seule 2000. Il se trouvait
des travailleurs dans le moindre trou. Le Ron Sourd, à l'époque
vingt minutes d'ascension, aujourd'hui une heure et demie n'est pas forcément
de trop à cause de l'envahissement des genets à balai]. Le chien
se trouve derrière. Il se traîne. Aaah, mais ça monte, aah
je me sens mal... Attendez-moi, mais attendez-moi... Les deux chasseurs grimpent,
le chien s'arrête. Puis, il se cache derrière un bosquet. Les chasseurs
en font de même et épient, déjà rigolards. Le chien
jette un oeil, oh, la voie est libre ? Il se met à redescendre.
Manioc, au pied !
Et là il fallait voir son regard... Et meeerde !
A Alès, les petits vieux l'avaient pris en amitié. Ils lui donnaient des os à moelle à ronger au travers de la clôture. Sauf que de ronger, oh que d'efforts ! Alors le chien mettait les os sur l'allée de garage. Lorsque la voiture évitait les objets, le regard du chien : oh mais les cons ! En effet, les pneus écrasaient les os et s'il en est un qui n'attendait que ça !
Ce sont nos petits récits, on se marre bien. Soudainement on compare nos mains. La mienne fine et douce, celle de Bernard une énorme paluche, qui a vu cent-mille gros chantiers : une main qui inspire du respect, une main bienveillante aussi. On se raconte les cent-mille histoires du pays. Que ferait-on d'autre ? Tu sais les histoires des polytocards, on s'en fout royalement ici. On évoque que trois mômes partent de l'école de Montselgues, sur neuf, déménagement, exode. Ca nous touche ça par contre, oui. Puis on parle d'une rue encaladée qui a glissé à Thines, lors du dernier épisode cévenol. C'est isolé - curieux pourtant, tout le monde est au courant.
Pour nous l'Ardèche ça ne veut pas dire grand chose. Certes cela reprend à quelques détails près le tracé du Vivarais, ça a un sens, mais rendez-vous compte, Annonay est à trois heures de routes. A l'échelle de la Belgique, c'est presque un pays.
Notre géographie est cévenole et lozérienne. La vallée, nous, sommes dans une Cévenne colérique. De profondes vallées luxuriantes très sauvages, encaissées, des châtaigniers des chênes verts, un habitat très dispensé, le plus souvent caché. En contrepartie, la terre lozérienne est celle d'un plateau ouvert, lent, taciturne, glacial. Les lieu-dits La Fage, c'est-à dire la boue, car l'eau stagne, voire même se trouve prise dans les nombreuses tourbières, celles de la croix d'Inassas, du Ranc Gla. Le village est resserré, se protège du vent du froid du brouillard de la neige : Montselgues, Loubaresse, le glacial Tanarce. Nous sommes juste à la frontière et c'est effarant de voir à quel point cette limite est précise, là où le plateau craque et se fond dans d'immenses vallées, (le local de chasse de la Cham de Chabreilles (la cham, c'est le plateau en patois), les poubelles au Clapeyrou, si si c'est aussi idiot que ça. Le brouillard démarre pile là, de même que la neige).
Nous sommes les rares à avoir la chance d'être sur cette limite.
On s'exclamait et quasiment s'extasiait, avec Madeleine, de faire exactement la même chose, à trente ans d'intervalle. Lorsqu'on en a marre que le soleil passe derrière l'Everest de Thines à 13h35, au creux de l'hiver, alors on monte au plateau, la plupart du temps à Pierre Plantée, là où sont les menhirs. Là-haut, on a le soleil jusque 17 heures, alors tu parles !
Lorsque je décidai de relater ces histoires - minuscules, banales, insipides - je m'étais dit qu'il fallait prendre comme titre La Boissière, et ériger en couverture un brin de bruyère. Mais non, nos histoires vont très au-delà de ce simple lieu-dit refermé sur lui-même. Dès lors, l'ouvrage s'appelle Trasenlai Lazonès, ce qui en cévenol signifie Au-delà de Lazonets. La maison de Lazonès est ma frontière : c'est violemment ridicule, je le conçois (et à ce titre Laurent l'ignorera, cela s'admet voire même plus que se comprend) : plus bas c'est le monde, plus haut c'est le refuge, en somme mes terres, celles qui ne m'appartiennent pas, celles auxquelles j'appartiens.
Il y a exactement un an, à deux-tiers d'encablures du nouvel an, nous étions dans une carrière souterraine avec mon bien-aimé frère. En soirée, nous profitions d'une bière (je n'ai plus bu une bière depuis le moulin de Sens, je n'ai plus entendu le rire d'un enfant depuis je ne sais plus, et ça c'est peut être plus choquant, ou tout du moins plus touchant) et c'est dans ce souterrain que je lui évoquais mon souhait, ma peur, mais mon désir intense de démissionner. En mémoire de cela, je traçai alors un grand dessin au sol, qui certainement est encore là. Il s'avère que, malgré l'angoisse, j'ai démissionné. Pas un seul instant je ne le regrette. Je touchais la mort, celle d'être vivant sans vie. Désormais je rayonne de vie, foisonnante comme une source glaciale, douloureuse souvent, compliquée parfois, mais inquiétante jamais. Il se noue des moments importants comme ça, banalité réelle, sans qu'on le sache, et pourtant c'était un instant clé. C'est l'histoire d'un chien c'est l'histoire d'un humain. Petit, précieux. L'or du monde.
Il me servit un tout petit verre de vin rouge, fruité et doux comme un nectar. C'était chez Jo et Bernard, une soirée au coin du feu, une improvisation presque (encore que), elle vérifia dans le frigo : il y a ce qu'il faut pour trois, qu'en penses-tu ?
Je revenais alors d'une virée afin d'aller voir une ruine, entraperçue quelques semaines auparavant depuis les hauteurs dénudées de l'Echelon [c'est comme cela ici, le travail du potager est tellement dense, un projet de promenade peut se voir mis en œuvre dans l'heure, la liberté aidant, comme le plus souvent par contre, quelques semaines plus tard, quand bien même il ne s'agit que d'un tour minime, enfin soit]. La ruine des Coulets donc. Très difficile d'accès, il faut passer le gué de Gilbert, monter le ruisseau en rive gauche, traverser en sautant peu avant une superbe et secrète chute d'eau, traverser à nouveau donc, et cette fois-ci, surtout, comme on peut. Ensuite un semblant de sente monte dans les terrasses éventrées.
Des terrasses centenaires, des terrasses millénaires. Dans une superbe forêt de chênes pubescents, la montée rude offre une vue surprenante sur la ruine. Soudainement les terrasses sont plates et envahies de fougères couchées par les récentes pluies. C'est de toute beauté. Ces faïsses ont dû demander des labeurs énormes pour être érigées, c'est à la fois touchant et saisissant. Suite à l'exode rural de 14/18, l'un des plus durs, puis les innombrables suivants, de nos jours l'abandon est frappant. Seuls les sangliers viennent ici. Quoique, la ruine est emplie de crânes de moutons et s'enfuirent trois chevreuils à mon passage.
La maison en tant que telle offre un rêve à couper le souffle : rénover, habiter ici. Il faudrait infiniment peu pour que cela se fasse, peut-être en fait - aussi simplement que ça - être en droit de le faire. Mais les gens ici s'arrachent les terres, se battent au sens propre comme au sens figuré. Ils obtiennent des droits d'eau, des droits de chasse, voire même le plus souvent l'unique désir malheureusement : le droit de faire chier autrui, celui qui la voulait, celui qui était juste à côté. Pour cause de rivalités qui font franchement mal au cœur, les terres sont achetées, préemptées, laissées dans un état d'abandon le plus complet, puis jalousement conservées telles quelles ; bec et ongles. Pour cela, la vallée est méchante. En somme il n'y a pas d'autre sentiment. C'est brut.
Cette toute petite maison offre une vue époustouflante sur la vallée. Pile dans l'axe. Au beau milieu la Thines, à droite la route de Tastevins (sur les cartes récentes), Tastavins sur toutes les autres cartes jusqu'à Cassini, puis à gauche la piste.
La route de Tastavins a été créée en 1932, les deux ponts dans la foulée. Auparavant on y accédait par le GR depuis Thines et puis c'est tout. Cela explique qu'un nombre non négligeable de maisons du hameau ont toujours une fenêtre qui permet de surveiller le GR. Lorsque je dis que la route a été créée en 1932, restons bien entendus qu'il s'agissait d'un chemin empierré. Ce n'est que très récemment qu'elle fut goudronnée. Quant à la piste vers la D4, n'en parlons même pas. Tous les un tant soit peu anciens du coin l'appelleront la route neuve, mais soit, on préfère parler de la piste ici.
La ruine donne du rêve dense, mais c'est vaporeux, évanescent. Dans le fond on sait que ce n'est pas possible sauf folie. On se rêve de longs instants, très longs instants, comme étant fou. Que c'est attirant. Puis voilà au retour, je fis signe à Jo, puis Bernard me dit : entre.
Comme il se doit, nous parlâmes du pays. Bien d'autres sujets de discussions étaient embryonnaires, mais à chaque fois cela revenait à la vallée. Nous lui appartenons, comme je pouvais l'évoquer auparavant, alors simplement voilà devrais-je dire. Cela permit de résoudre le mystère de la toujours-là voiture blanche des poubelles au Clapeyrou (Nicole, je m'étais inquiété pour toi, je te pensais perdue en randonnée sous la pluie glaciale du plateau), puis de ça de là logiquement, nous avons évoqué la clède de Maroles, qui lui appartient. Une sacrée histoire que ce tout petit bout de ruine à mi-chemin vers l'Espinasse.
Ici nous sommes survolés par les mirages de Salon-de-Provence. Comme le dit Jean : j'ai toujours connu ça. Ces survols font un raffut de tous les diables ; allez disons que c'est une fois par jour et durant dix minutes. 94 décibels que j'ai mesuré, une fois quelque peu agacé : allez c'est bon, elles marchent vos machines belliqueuses !
Près de la clède dans les années soixante et dix, un berger
s'occupait d'un troupeau de 500 moutons, descendant de Lespinas. Il fallait
voir les lieux. Rien de comparable avec aujourd'hui, c'étaient des prairies
à perte de vue, autrement dit 500 ovins ça a quand même
un certain appétit. De nos jours, les terres sont envahies de genets
et de prunelliers, quelquefois des ronces, quand ce ne sont pas les trois ensemble.
Les avions survolaient le troupeau puis faisaient des piqués dessus,
pour s'amuser. Sauf que le groupe se disloquait en autant de bêtes affolées,
pour ainsi dire impossibles à regrouper. Et pourtant le berger menait
avec des chiens à toute épreuve. Pas un mot pas un cri, un simple
geste permettait de guider. Cinq cent bêtes dis ! J'avais déjà
un mal fou avec vingt-huit l'été passé !
Une énième bravade des avions, le berger pris le fusil. C'est que ça va à mille kilomètres heure ces engins, il fallait viser juste. Il visa juste.
De retour à Salon, ils furent comme cela pourrait vaguement se comprendre, quelque peu embarrassés des trous dans la carlingue. Après une enquête, ils ont retrouvé le berger (miracle, ou pas ? Dur à dire). Quoi qu'il en soit, le vieux, un italien qui ne parlait qu'à peine le français, les engueula de tout son fort caractère bourru ; misanthrope, sinon il ne parlait à personne. Qui eut le dessus ce jour-là ? La transmission orale ne nous le dit pas mais pour sûr, il n'y eut plus de piqués furibards sur les troupeaux. Vieille histoire probablement relatée mille et cent fois.
Cette combe était partie en feu, un de ces jours de fin d'été probablement. Le même partit là haut à la clède. Tous les habitants le prenaient pour un fou furieux. Il voulait simplement surveiller qu'elle ne brûlât point - et eut surtout crainte dans la montée des châtaigniers, car là le feu aurait pu l'attraper. Autour de la clède, tout était brouté, et dès lors tondu ras. Pourquoi est-ce que cela aurait brûlé outre mesure ? Il suffisait de taper le sol avec un genet pour éteindre. Il y passa la nuit, la clède est belle et bien encore là, il redescendit sain et sauf bien sûr ; de nos jours, la borie est perdue dans une broussaille dense. Il faut se battre pour l'atteindre - on y arrive toutefois. Dedans subsiste une vieille pelle et c'est là bien tout.
Après le repas, alors que la nuit était depuis longtemps avancée dans les ombres denses (même si je connais mon chemin par cœur, c'est tout de même la nouvelle lune), Bernard me remit une lampe de poche qui déclara forfait au bout de quatre mètres et vingt-deux centimètres ! De tout l'intérêt de bien connaître son lieu de vie, son lieu d'accroche. Je passai le vieux moulin dont il ne reste qu'un trou de nos jours, puis au travers du potager, retrouvai Raymonde Deux, la belle, mon refuge.
Je repensais à ces paroles choquantes mais si vraies ; non pas que l'Everest de Thines s'appelle autrement, soit on s'en doute, mais que la Bogne fut tombée bardaf, et ça, ça a dû barder ; (l'Everest s'appelle le Ron Sourd. Le ron, le ranc, le rand, c'est le rocher en vieux cévenol, ça n'a pas d'orthographe, tandis que sourd, c'est simplement parce qu'il ne renvoie pas d'écho. Il restera l'Everest. C'est mieux). Bref donc, nous parlions que ce n'est pas une sinécure de monter l'Everest de Thines, envahi comme il se doit, comme partout, des genets. Je pensais que personne n'allait là-haut, mais non fausse imagination, c'est un col stratégique où passent les cochons.
Une fois là-haut et d'ailleurs il y a longtemps, très longtemps, Bernard était avec un géologue. Celui-ci s'exclama : elle est tombée ! Sans trop savoir de quoi il parlait, Bernard demanda des précisions. Le gars en question désigna alors le Rand de la Bogne (vieux cévenol faisant référence à la bogue, l'emballage cadeau de la châtaigne, j'en reparlerai), la montagne qui domine le vieux domaine de La Boissière. Il dit : cette montagne s'est écroulée. C'est tombé là. J'imagine qu'il y a une vasque juste en bas, dans la rivière de Thines. Bernard, complètement éberlué par le savant, répondit alors oui. C'est la piscine où nous allons tous en été ! Elle fut créée par le déluge de roches, retenant l'eau tel un barrage.
Le regard aiguisé de ce personnage avait détecté que les rochers de la Bogne s'étaient détachés, par milliers de tonnes furieuses dans les pentes acérées. Quand ? Cela tout le monde l'ignore, tout autant que la véracité qu'il y eut un fort à Thines sous le commandement de Chambonas. Quinzième siècle ? Personne ne pourra l'affirmer, mais par contre s'il y a bien quelque chose que nous pouvons tous constater, c'est qu'entre la Boissière et Tastavins, il n'y a aucune maison et le moulin est rasé, (la ravine menait l'eau à ce moulin d'ailleurs), les cailloux ont dévalé là, les cailloux, les gigantesques blocs devrais-je corriger. Lui, ce savant même-pas-fou, avait lu le paysage aussi vite qu'il le balaya du regard.
De retour à Raymonde Deux, j'écoute le hululement de la chouette. Cette fois-ci, elle est terriblement proche, probablement dans l'arbre qui surplombe la roulotte. Sur la sente de retour de la ruine des Coulets, j'ai glissé sur de la fétuque bleue ; elle est terrible, elle est archi-dure, lisse, refusée par le bétail. En chutant, j'ai amorti le choc avec la paume de la main, qui a écrasé une bogue de châtaigne. Une trentaine d'épines se sont plantées. Elles se cassent et logent sous la peau. Ca fait très mal. C'est un peu notre lot à tous ici. Ce sera pour demain d'enlever cette misère - c'est plus raisonnable - à la lumière du soleil, étonnamment généreux pour une fin d'année comme ça.
J'ai allumé une bougie, comme chaque soir, puis me suis réfugié sous deux épaisseurs de couettes. Rétrospectivement, je repense à cette journée. Ils ont mis des centaines d'années à ériger ces terrasses, elles émergent de partout-partout dans les forêts denses parcourues par plus-personne (les chasseurs quelquefois, encore qu'ils ont leurs pistes et leurs préférences dans la réserve, un curieux tous les quinze-vingt ans, un géologue et moi...) ; puis, devant moi en réalité, un châtaignier énorme, un tronc de dix mètres de circonférence, presque tout mort, gigantesque et respectable. Quelle pitié cet abandon, quelle immense pitié. Le seul honneur que je peux trouver, modestement, est d'aimer cette Cévenne comme tous les anciens l'ont chérie, durant tant de siècles et comme les quelques restants d'aujourd'hui la blessent de mépris possessif. Il n'y a pas d'autres mots. Aimer, brut, oui brut de décoffrage et en réalité, lorsque je songe à cette ruine des Coulets, ces sentiments sont vifs.
Après une dure journée de travail, je prends le chemin - ici il se trouve l'option vers le bas et celle vers le haut. Ce sera pour cette fois en direction de Montselgues, car je souhaitais voir cette vieille grange éventrée, derrière la rivière de Thines, et que l'on semble appeler la Paillère.
Des cartes consultées la veille, l'accès serait difficile. En effet sur place, il faut sauter la rivière. Par chance, cela se passe sans peine, ce qui est déjà un gain certain en cette belle journée. Par la suite, la ruine est dans la broussaille, par ici invariable (et d'ailleurs je radote probablement) : des genets, des prunelliers, puis quand il y a de la fougère il y a de la ronce. Quelquefois tout est ensemble dans des pentes bouleversées de cailloux invisibles sous les taillis, des trous, de la fétuque bleue terriblement glissante. Les passages les pires arboreront de l'églantier, qui même s'accrochera aux cheveux. C'est dire. Enfin bref présentement, il ne s'en trouve point et ça fait - pour une fois - du bien.
La ruine, comme toute bâtisse agricole cévenole, est pauvre. La charpente est bâtie avec les arbres alentours, du châtaignier ne craignant ni la pluie ni le temps (quand bien même des siècles), puis il ne se trouve guère d'autre architecture. Dedans l'enceinte de pierres centenaires, il ne subsiste plus rien, sauf une ancienne aire de pierres, dévastée. En bas l'étable, en haut la paille, désormais un vide béant et blessé. Un trou permettait de déverser dans l'auge. Au sol gît un squelette quasiment complet d'un mouton d'une autre époque.
Passant un très grand chêne, abimé par je ne sais combien d'épisodes cévenols puis de canicules féroces, une sente monte. Incertaine. Le seul repère permettant de savoir que l'on est sur un chemin (et le mot est présomptueux) est que ça et là, des rameaux de genets sont parfois coupés. Ca monte dru, sous un vent terrible. Ce n'était pas comme ça en bas dans le fond de vallée. Evidemment il aurait fallu le bonnet, c'est à chaque fois la même rengaine. Dans des arbres tordus, qui en disent très long sur ce qu'ils endurent, l'idée saugrenue -et trop tard désormais- de pousser là, le vent fait un raffut du tonnerre, ça souffle sans discontinuer, sous des rafales pourtant encore plus fortes parfois.
Puis sans avertissement la pente redoutable s'incurve. On arrive au plateau. La grange des Amoureyres est en vue. Un chemin large et soudainement radicalement différent offre un paysage paisible dans les pins maritimes. Sans transition, deux mondes qui s'opposent et s'aiment farouchement. Peu le diront, les paysans sont taiseux, mais ils le savent.
Ce chemin ondulant mène à la piste et je le connais que trop
bien, c'est démoralisant. Cette tranchée est l'autoroute à
sept voies de la forêt, un peu comme lorsqu'on arrive à Lesquin
en provenance de Valenciennes. Cela a dû être fait pour le débardage,
peut-être les pompiers au gré d'un gros DFCI, ou qu'en sais-je
? Mais soit, ce n'est pas une gloire ; à droite d'innombrables tourbières
bordées de bouleaux. C'est fangeux.
Rapidement, un chemin discret et sans nom permet de descendre aux granges de
la Rouveyrette (quand je dis rapide, ça semble toujours longuet, mais
soit on se comprend). Le chemin privé descend sur la maison. Une voie
herbeuse s'insinue maladroitement dans les genets, en crête de serre.
C'est merveilleux durant une centaine de mètres et puis fatalement, cette
sente se perd. Ca va vite, sans trop qu'on ne sache pourquoi. Ca se termine
sur un plus rien et c'est tout. Comme on le dit dans le pays : il manque quelque
chose. Enlevez au cévenol le chemin et nait un vif problème de
quotidien (nous arpentons tout un chacun les chemins dans tous les sens et parfois
même les écarts).
Alors, comme cela se doit, ça se termine par une rude bagarre dans les genets - un brin qui frappe l'œil - les trous dans la descente, les inévitables ronces. Là-haut à Lespinas, tout le monde se marre de voir la silhouette lente et pataude, mais non en réalité, il n'y a personne, il n'y a rien d'autre qu'une nuit qui avance. Les ombres s'allongent et deviennent menaçantes. Il est toujours un moment, aussi soudain qu'incompréhensible, où l'on en sort. Alors la hêtraie - grise durant l'hiver - mène au ruisseau de Vallée. Là le paysage devient familier, on retrouve le sentier descendant abruptement, en lacets, sur le château des Longueville.
Au passage on imagine que dans les temps reculés, tout ça était pâturé. Non cela ne s'imagine même plus en fait. En allant vite, ça permettrait de faire encore une heure de bois, cependant la nuit dévore le ciel, la fatigue est écrasante. Au loin résonnent les cris des chiens de chasse - deux cochons viennent d'être descendus du côté de Lahondès. Les abois sont ici des hurlements lugubres qui forment de formidables échos sur les parois des rancs. Ils n'aboient pas. Ils jettent une clameur lancinante, un pleur beuglant comme une longue plainte déchirante et par une pointe vantarde, on en viendrait à dire qu'il n'y a qu'ici que de telles sonorités se fassent.
Au loin le regard porte sur les hauteurs, même plus dévorées d'ombres ; elles sont à présent plongées dans une semi-obscurité. La lune jaillit comme une folle depuis le Ron Bel, au-dessus de Belle Rouvière, puis disparait comme une obscure magie : ce sera tout pour cette nuit. Par ici l'on jurerait que nos monts n'ont pas de noms ; il ne figure plus ou moins rien sur les cartes, puis la transmission orale nous apprend soudainement que telle ou telle forme connue par cœur, c'est le hasard centenaire et impromptu de l'une ou l'autre toponymie. On s'y habitue mal d'abord. Puis tout d'un coup, ça fait comme si ça avait toujours été comme ça.
Le chemin cévenol - tout du moins celui d'aujourd'hui - est à l'image de mon existence. Au tout départ lorsqu'il s'agissait de sauter la rivière, c'était l'épreuve de l'enfance (et l'on s'étonne d'ailleurs que cela marche, que cela ait marché surtout devrais-je dire, même encore à ce jour cela fuse dans quelques e-mails pathétiques : mais comment était-ce possible ?). Ensuite, la montée est rude, âpre et venteuse, les années de travail ; une pensée pour cette bande dessinée qui traîne chez mes voisins, une couverture sobre en brun kraft, un dessin de chaussons, le titre n'est autre que je n'ai pas de projet professionnel ; une belle simplicité touchante : oui la véracité. Puis là haut sur l'éternel plateau venteux, c'est l'autoroute à sept voies de la forêt, la routine du quotidien, le temps long, les années qui passent pourtant trop vite. On le sait, on y est, on continue, on continue comme ça. Tous. On fait ce qu'on peut tu sais.
Errance, l'on s'ennuie, comme tout le monde (ça se normalise à regarder tout un chacun pareil, et c'est peut-être ça le pire, ça paralyse les envies folles), puis à ce moment de folie-malgré-tout, on tourne vers la Rouveyrette sans réfléchir un instant, impulsivement. Et à obliquer si tant sans détour pour le moins raisonnable, à se retrouver coincé dans les genets et les ronces, on s'étonne de regarder en arrière et de voir que plus aucun ami ne suit. Mais comment s'en offusquer, si tant est que l'on ait plus rien à offrir sauf des tourments ? Alors on se retrouve seul [et ce n'est pas tant pis, sans nul doute c'est tant mieux car ça permet de reconstruire des ressources, apaiser les tensions internes : soudainement se retrouver bien avec soi-même, pouvoir s'offrir meilleur].
De retour le ciel est étoilé sur une immense toile de solitude. Ce sont de beaux jours de janvier, froids et secs comme on les aime. L'existence d'ici amène à s'endurcir. Enfant, j'avais un gros cœur mou, comme un camembert. Puis le temps passant, les épreuves ont endurci : le cœur est devenu tout petit, dur comme un picodon, peut-être trop parfois, enfin soit ce n'est pas bien grave. Le chemin cévenol est aride comme nos cœurs sévères, chacun sait d'ici que notre rudesse n'est autre qu'une gentillesse discrète. Nous ne ferons pas de grands gestes démonstratifs ni de vaines paroles en tous sens de promesses, mais nous serons là quand tu en as besoin. Le pays est comme ça.
Dans le noir complet désormais, le regard de mes proches m'apparaît. Ils doivent être inquiets, la vie au milieu des sangliers discrets mais pourtant à quelques toises, l'hiver en ses humeurs dévastatrices parfois, la solitude décharnée, l'immensité de cette solitude revêche : c'est inhumain. A vrai dire c'est peut-être ça le bon de chaque jour, cet inhumain dans une immense simplicité où chaque artifice se fait emporter dans les bouillons houleux de la rivière de Thines. Jamais je ne fus si attentif à l'existence des animaux, aux rythmes complexes et aux codes enchevêtrés. Cette nuit d'encre - aucun reflet de lune dans les ondulations du bassin de la source - offre une intériorité, un code tout autant complexe, une construction sentimentale organisant sans fard qu'un ailleurs parait tout bonnement absurde. Ce sentiment est probablement le plus vif lorsque, chaque matin (ouvrant les rideaux de Raymonde-Deux), la Blacherette s'enflamme dans les rayons d'un soleil nouveau ; tous ces mêmes matins où le troglodyte a repéré deux grains de riz échappés de la passoire (le repas d'hier soir) et fait alors un cirque pas possible parce qu'Émy dort sereinement juste à côté. Non sans nul doute, ailleurs est un chemin sans mes pas.
Chaque jour résonne de leurs absences ou leurs voix.
Les vieux te regarderont avec un air sage, celui du maître de cérémonie,
et te diront -toujours- que ça, ce n'était rien. Lorsque, aujourd'hui
encore, quelque peu effrayé par les deux épisodes cévenols
d'il fut deux mois, tu évoques la fureur des éléments,
ils te répondront tous pareil : mais ça ce n'était rien,
crois-moi ce n'était rien. Alors, en force de surenchère, ils
vont ressortir les éternelles histoires d'il-y-a-cent ans, nos vieux
bavardages du pays, sauf qu'à défaut de siècle, tout est
désormais récent, le vent de 1999, la tempête de 2005, les
calamités de 2011.
Dans ces instants, chacun racontera comment l'eau est passée à côté du pont, là où ça fait un angle droit - déjà là tu peines sévèrement à comprendre comment ça a pu tenir. Puis Madeleine ira plus loin encore, l'hiver 2005 c'était passé au-dessus du pont. Stupeur. Mais comment ? Alors la réponse n'est autre que : c'est fait pour. Puis dans la foulée, elle se met alors à raconter qu'un de ces hivers encore, elle a ouvert la porte et il n'y avait plus de paysage. Dehors, deux mètres de neige étaient tombés. C'était en 96. De la sorte, ça a duré trois semaines et les hélicoptères larguaient des paquetages de riz au-dessus de Tastavins. De ces récits, on sort essoufflé, étourdi, écrasé : mais comment vais-je tenir est la seule question, et autant dire qu'on ne pense même plus au pont en fait (quand bien même c'est une impasse, mais soit, on fera comme les anciens ont fait et toujours fait, constituer d'importantes réserves de nourriture et passer par le vieux chemin, en rive gauche de la rivière de Thines). Indéniablement, ça ira.
En ce moment le temps est radieux - ça fait deux semaines que ça dure - et pourquoi parle-je du mauvais temps, je n'en sais rien d'ailleurs, peut-être juste une réminiscence soudaine des paroles des vieux au nouvel an, empreint d'un respect de plus en plus marqué pour ce qui est paysan : de la réserve, de la dureté, du bon sens, mais surtout beaucoup de repli sur soi.
Je suis tellement isolé que je parle tout seul. En montant la draille, sous un soleil généreux, je murmurais "quel bien-être", puis cent mille petites autres choses, inévitablement maudire la fétuque bleue qui glisse (je ne le dirai jamais assez, jamais), puis s'émerveiller devant une grosse carcasse demi-vivante et splendide d'un châtaignier de mille ans. Je parle tout le temps tout seul désormais, écrasé par une solitude de mille ans aussi. C'est peut-être un premier pas vers la folie. Bof, ça ne dérange pas en fait.
C'est de la sorte, toutes ces idées en tête, foisonnantes, que je montais, à partir de Valbelle et plus précisément du Pradel. Ce recoin est particulièrement bucolique et, je ne sais pas, je dirais rassurant. On s'y sent bien tout de suite, sans raison. On se baignerait bien dans le ruisseau de Vernède. Mais les cévenols le disent de même, c'est le soleil des fous. Dans une semaine tout aussi bien, il peut neiger.
Le chemin qui monte dru est pavé, c'est assez incroyable de contempler ce travail titanesque des anciens. C'est la draille, la voie de la transhumance, et donc à mon tour je m'endraille, tout comme les bêtes pouvaient s'endrailler par milliers et ce, durant des siècles de tradition perdurée.
Mais aujourd'hui sur le plateau de Lespinasse règne une ambiance morbide. Si durant des décennies ont dégénéré les luttes entre les forestiers pour le reboisement de l'Aigoual et les bergers pour les pâturages [combats éminemment violents], ce qu'il s'est passé à L'Espinas est ma foi bien pire, bien plus redoutable, bien plus insidieux, bien plus irréversible. Comme aux Monts Lozère, comme au Méjean et tant d'autres endroits, ils ont planté du pin noir d'Autriche. Des kilomètres de simple monotonie sinistre. En dessous le sol est mort, acidifié, torturé. Sur le plateau de Montselgues, la serre des Fonts et tous les alentours, c'en est fini des pâtures. Tout au plus aux Gleysoles, des vaches Salers errent dans des parcs boisés.
Et me voici rempli de nostalgie, comme les vieux du pays, sur ce qui n'existe plus. De transhumance, je n'en ai connu qu'une seule, à Mandagout et c'était en 93, j'étais môme c'est dire. Tout d'abord on entend le grondement, comme un orage menaçant qui se forme au loin, ce sont les sabots qui battent le sol, puis singulièrement, les clarines se distinguent. Avant même d'entrapercevoir le troupeau, c'est avant tout la poussière qui précède, puis soudain apparait le menou, c'est-à-dire le meneur. Et là, dans une émotion terrible, nous voilà à croiser le pas rapide de 3000 bêtes, connaissant leur chemin, impatientes d'aller en estives sur les plateaux - par ici on dit aller à la montagne, (en Cévennes d'Aigoual, après l'Espérou et au travers des trous du Bramabiau, on dirait monter au causse (qu'il soit Méjean ou Sauveterre, peu importe)). Et donc cela, qui fut le quotidien semi-nomade de tant de bergers, ce n'est quasiment plus. Nos terres s'embroussaillent de genets, mais ça ce n'est rien à vrai dire, c'est la nature ; elles se sont surtout couvertes de forêts de pin noir de par la main industrielle odieuse de l'Homme et cela, c'est un parfum cafardeux. Lugubre. Funeste. C'est pour ça que probablement, je traverse toujours la cham rapidement ; les flaques sont gelées, les pistes sont toutes affreuses, uniformément crevassées par les engins de débardage.
D'est en ouest, le plateau n'est rien, car il est avant tout une longue bande de terrain gréseux érodé par la Thines d'une part et la Borne d'autre part, le sud forme une pointe effondrée à partir de la serre de la Croix. Au pas de charge, j'arrive sur la ruine de Liépertès, puis l'immense point de vue sur Sainte-Marguerite Lafigère et Pied de Borne. Tout le paysage m'est inconnu, je ne reconnais logiquement aucun repère. C'est d'une immensité belle.
C'est saisissant comment en fin de compte, en sautant d'une seule vallée au gré d'un plateau étroit, on se ressent comme devant des étrangers. Ce sont d'autres gens, d'autres solidarités ; on ne se connaît pas. Au soleil à l'abri du vent, contre un container abandonné dont une écriture antique mentionne qu'il provient de Gonesse (mon dieu quelle horreur, mais pourtant je jure que c'est vrai), je prends un court repas frigorifique, puis m'endraille de nouveau, vers le bas cette fois-ci, plus mélancolique que jamais.
De retour, un regard posé sur le potager, sur la ferme, rude et imposante
de ses pierres ancestrales.
La mort règne en ce lieu.
Il y a quelques mois, je venais d'arriver, nettoyant la ravine, j'ai glissé
sur le granit, les pierres érodées ont tendance à toutes
être rondes. Je suis tombé en arrière et eut une chance
remarquable de ne simplement pas me fracasser le crâne, raide mort sur
place, comme une bête imprudente. Désormais je me méfie
du granit et de la fétuque bleue comme de la peste.
Puis la mort est venue cette nuit.
A cause de la fédé de chasse de Sablières, j'ai été
très malade toute la nuit, et suis encore énormément affaibli
à l'heure d'écrire ces lignes. Je leur en veux, indéniablement.
La mort est venue s'assoir deux fois sur le banc de la table de Raymonde, je l'ai vue avec une acuité effarante. Elle sait dans le fond que j'ai un mépris féroce pour elle, parce que je n'ai pas peur. J'ai demandé, dans mon chant du loriot, d'être inhumé au Gargo. Je sais que ce ne sera pas facile, car ce n'est pas une coutume admise. Mais je sais présentement, face à la mort, que quoi qu'il se passe, je serai plus tard une mésange, ou qu'en sais-je (et peu importe). La mort a ressenti ça et elle fut penaude de ces instants. Je ne sais pas pourquoi elle est revenue, s'assoir, calme et attentive, une seconde fois. Il faut croire que l'ambiance ne lui plaisait pas ou voire même qu'elle n'en croyait pas ses orbites vides, il est vrai que ni Raymonde ni mon lieu de vie n'appellent à la décrépitude et l'on se voit plutôt guilleret - ou plutôt émerveillé dirais-je - de la beauté enfantine et limpide de tels lieux.
Dans le fond, je crois que je vis une solitude inhumaine, ces mots que je commençais à partager avec une personne proche ces derniers jours. Lorsque ce soir d'été du 15 août pluvieux, j'appelais depuis le curieux cimetière-monument de Gravières (j'y pense à chaque fois que j'y passe, aujourd'hui encore, je jure que c'est vrai), je me souviens de ces mots, cette solitude écrasante ; j'y repense encore beaucoup. La seule chose que je puis, c'est être la locomotive dont il y a nécessité pour l'instant, tracter de toutes mes forces, créer ce dont j'ai besoin, cette dynamique d'accueillir au gite dans une authenticité cévenole réelle [lorsque l'on monte à Montselgues, il existe sur la D4 un vaste panneau sur lequel un texte reprend les termes parc naturel, agricole et de loisirs du Tanargue - désolé, je n'en ai écrit les mots exacts. Le terme loisir a été rayé au caillou avec rage ; empreint de cela, je rêve de faire vivre authentique, ce qui explique que je vais voir le moindre bout de chemin dans les alentours], cette dynamique aussi d'accueillir à l'écolieu, je n'aime guère ce mot, trop à la mode, mais soit passons au-delà, on se comprend.
Cette nuit j'étais très malade et c'est là que la solitude, immense et très lourde, se ressent le plus. Je n'avais personne (et même si je sais, ça ne sert à rien, personne ne ressentant la moindre affection, ça, je le dis, ça fait férocement mal). Cette rosse de la mort le perçoit, c'est pour ça qu'elle traîne. Mais elle n'aura pas le dessus, sale bique, car locomotive je serai.
Ici tout au plus, il passe une voiture par jour, et encore, je dis ça, c'est une exagération, car de longues périodes peuvent être remplies d'un zéro bien pointé. Lorsque je fais le tour des maisons que je gardienne, autant dire que je ne cible pas spécialement les voleurs ni les vandales (mon ancienne vie s'efface peu à peu, rassurez-vous), car les pires délinquants sont le vent et les chèvres. Quelquefois les cochons ne sont pas en reste, mais c'est plus rare : ils préfèrent les terrasses élevées, sauvages et broussailleuses. Et donc bref, quand la voiture s'est engagée vers le Darbousse, évidement - construisant la serre et étant sur un promontoire -, j'ai regardé.
Et le Darboux, il est mort il y a deux mois. Alors faut dire que déjà une voiture, ça intrigue (toujours), là je pose la bêche et m'interroge.
Le mari d'Émy file voir. Je lui hèle : hé va voir, gos
de pargue !
Le véhicule revient, un gros pick-up qui grince terriblement, puis s'engage
dans la ferme. Ni une ni deux, je descends, tandis que le véhicule engage
une marche arrière. Me voyant intrigué, le mec revient et me dit
par la fenêtre ouverte :
Philippe : Hé je cherche mon chien !
Vincent : Ah ? C'est qui, je l'ai peut-être vu ?
Philippe : Hé, c'est lui derrière, je l'ai retrouvé, ça
faisait deux heures que je le cherchais ! Il s'appelle Sky : sky-comme-le-ciel.
Derrière, je vois Sky alias plus communément le-mari-d' Émy
qui me tire une tête du genre : ouais c'est bon ok, je suis totalement
grillé...
Vincent : Hé bougre de pastre, faut pas le chercher, il est tout le temps
avec Émy !
Philippe : Ah, la chienne de Laurent ? Ha bah elle est portante hein.
Derrière, Sky s'enfonce, de l'air de dire : heu surtout vous ne me connaissez
pas hein...
Philippe : Je suis de La Bombine là-haut. Vous m'appelez quand il est
dans le coin !
Puis tout en grinçant toujours autant, l'équipage se fait la malle
tandis que le chantier de la serre, au soleil couchant et sous une grisaille
persistante, se refait désert. J'en conclus sur mon éternel proverbe
comme quoi ici, punk-à-chiens ou pas-le-moins, on a tous des problèmes
de chiens !
Le lendemain matin aussi sec, Sky était redescendu, comme si de rien n'était (et surtout en niant totalement m'avoir prétendu durant des mois d'être de la famille de Laurent). Bref Sky un sacré coureur de jupons ! Comme quoi ceux qui ne parlent pas auraient bien des choses à raconter.
Ici il ne se passe à ce point rien que le moindre évènement prend une intensité folle, c'est un peu comme les longues périodes en mer. Lorsque je parle de ce rien-du-tout, c'en est d'une pureté éclatante. Les ruelles en herbe sont médiévales, inchangées - peut-être juste l'ancien, de passage, serait écrasé de voir autant d'abandon et de désolation, mais soit, j'en ai déjà parlé. Disons qu'ici j'aborde plutôt le petit-rien-rien du quotidien. On prend notre rythme. Je sais éperdument que si je passe le riz à la passoire, le lendemain matin j'aurai -comme à chaque fois- le cirque vibrant du troglodyte qui veut manger les quelques grains passés au travers et tombés au sol. Puis soudainement l'oreille se tend, deux mésanges nonettes se renvoient des trilles anormales. Mais que se passe-t-il ? On a beau regarder, ce verbiage spécifique n'est pas de notre entendement (bien que, il y ait énormément des paroles des oiseaux qui soient compréhensibles, quand vous viendrez je vous expliquerai, les cris stridents du merle systématiquement avant la nuit, parce que l'obscurité est une angoisse pour lui, la fauvette volubile qui gonfle ses plumes fait des bulles veloutées et criardes, cherche à impressionner pour faire fuir, puis tant d'autres choses).
Et du coup, comme ici il n'y a rien, on vit au rythme du rien. Un petit rayon de soleil ? Allez hop un thé. Cela ne cache pas une vérité crue, celle que les travaux de la ferme sont extrêmement durs, décourageants, physiques, salissants. Mais, simplement ça se fait. Et puis comme je me fous de mourir tout comme de vivre, alors autant vivre goulûment. Ca ne coûte pas plus cher.
Il faudra que je prévienne Sky, lui qui s'était approprié l'endroit, la serre est par terre. Ce matin tôt, aussi simplement que le soleil a émergé de la Blacherette, j'avais commencé à bâcher la serre, impatient de finir ce chantier aussi pénible que laborieux. Puis ce midi, il s'est levé une tempête sèche, ce qui n'était pas prévu à la météo, sinon je n'aurais pas entrepris les travaux. La bâche a fait voile de bateau.
J'ai soutenu ce que je pouvais afin que ça ne s'effondre pas. De grands renforts en forme de fourche devaient être posés à 45 degrés, après bâchage, pour contrer le vent. Ces renforts étaient à deux mètres. Ils étaient destinés à travailler en compression, les trous et encoches étaient faits. Soit je restais et je me prenais une poutre de cinquante kilogrammes sur le corps, soit je partais. Je suis parti. La structure a immédiatement plié. Les pieux enfoncés de 40 cm se sont déracinés, faisant éclater les fils de fer de torsion. La bâche s'est déchirée, dont une partie que je ne retrouve plus. Un pilier a éclaté. Le projet s'est écrasé au sol aux trois quarts désarticulé.
Devant le spectacle du tas enchevêtré, je n'ai pas ressenti de colère, pas même de la consternation. Je ne sais pas quoi dire, ça devait arriver. Il faudra construire autre chose, autrement, ailleurs. Je n'en sais plus rien à vrai dire ; comme le dit Julien Baker : au plus fort je nage, au plus vite je coule. Alors j'ai été prendre un repas bref, pensant aux miettes de pain et à mes potes, prenant même un pari sur la plus grosse miette et son court délai de survie. Pour arriver ici, il faut avoir coupé la lumière quelque part. Tout comme Thines vaillamment perchée sur son rocher [on n'y débarque pas par accident], on n'arrive pas sur les faysses de cette ferme - notre ferme - par le fruit du hasard. Lorsque tu cries tes peurs vers les pentes du ron Sourd, personne ne te répond, alors à la fin tu ne cries plus, tu te fais mal de toute façon, et tu n'as plus peur non plus. Ca ne sert à rien. Prend un thé.
A un moment, je me suis demandé, le breuvage fumant au gré d'un pâle et timide soleil d'hiver - il fait très froid - s'il n'y a pas un problème de câblage dans mon âme, pour autant rater, autant rater tout ça. Puis je me suis retourné vers mon adage premier : cacher en mon cœur le secret des hommes droits qu'un ciel clair suffit à rendre heureux. Mon regard s'est porté au loin, très loin, sur les cirrus surplombant Guinoalier. C'était à ce moment là ce qui blessait le moins et ce fut précieux. La grosse miette de pain vécut 10 minutes.
Dans ce pays, il existe une constante : dans un quart d'heure, tu ne sais pas ce que tu feras. Toi qui te prépare à venir, quelque soit le jour de ton projet, dans l'immense calme et la sérénité de cet endroit, apprête-toi à vivre ces bouleversements minuscules, comme l'eau fluide d'une rivière qui jaillit soudainement sur la bosse d'un rocher. Le pays est comme ça et il sera encore comme ça. Ce matin il pleut. A cinq heures, lorsque le pipi matinal à demandé à sortir faire un tour, comme un chien trop impatient d'ailleurs car il fait rudement froid, le sol était couvert d'une fine couche blanche duveteuse, un tout petit peu de neige, un rien à vrai dire. Comme le temps était comment dire, ce qu'il y a de plus maussade, j'ai profité de ce moment pour lire les brochures touristiques sur la Cévenne d'Ardèche. Ca aide à mieux connaître les producteurs locaux, savoir même comment est née Terra Cabra à Planzolles ; car mis-à-part sans cesse récupérer les pots de fleurs dans les poubelles du cimetière, les fortes charges de travail aidant, je ne m'y arrête jamais, à cette fromagerie de picodon dont on ne voit pourtant que ça. Connaître donne désormais une envie impétueuse de poser l'ancre et de les connaître.
Il pleut fin, lent, régulier, gris, hivernal, midi. Tandis que l'eau dédiée à la soupe commence à chauffer puis à lancer des jolis panaches de vapeur sous le couvercle dont la dimension n'est pas adéquate (encore et toujours de la récupération !), de rudes coups sont martelés à la porte de la roulotte. C'est Jean. Il me dit : Jo et Bernard sont là, viens manger ! La soupe retourne dans son éternité de froidure, du bonheur jaillit du cœur, comme les bonds d'une rivière au printemps.
Ca faisait deux semaines qu'on ne s'était pas vus, on se retrouve comme des gens qui s'étaient perdus depuis toujours. Oh tu sais avec le temps calme qu'il y a eu ces derniers jours, autant dire qu'il ne s'est pas passé grand chose, c'est bien, on est bien comme ça. Sky a sauté la clôture, il mendie par la fenêtre pour qu'on joue au bâton, sky-comme-le-ciel, c'est un gentil, c'est un brave celui-là. Puis évidemment, je raconte l'histoire de Philippe qui débarque à La Boissière, moi qui l'accueille avec une fourche ! Puis le fait que Sky ait engrossé Émy, bref on roucoule sur nos petites histoires à la banalité toute astucieuse, c'est notre vie. Puis évidemment, on parle de ceux qui sont morts. Noé Chat est mort, et le vieux apparemment, un monument d'ici, on l'aimait bien. Camille ressort de la chambre du haut, usé par amour, dédicacé d'une écriture tremblotante de personne très âgée, un livre sur lui ; il tenait un restaurant à Dépoudent (un hameau de Pourcharesse), genre de bouge avec un seul plat, adorable au possible en somme, puis comme un vieux paysan aux mains si admirables, il faisait un peu tout.
Puis voilà, c'est probablement un peu comme ça que nous sommes
arrivés à parler de Raymond Depardon : Profils Paysans, la vie
moderne.
Vincent : Oh mais non... comment peut-on donner une image aussi dépressive
de la ruralité ?!
Jean : Il demande au type, est-ce que vous aimez votre vie ? Puis le paysan
fait la moue comme ça, puis ne dit rien, dit rien, dit rien...
Vincent : Le mec qui mange sa soupe, complètement tout seul, le plan
fixe et sombre, affreusement muet, et comme ça pendant 10 minutes, slurp,
slurp, slurp.
Bernard : Et bien moi je vais te dire, j'ai connu le moyen-âge, et ce
qu'a fait Depardon, c'est fidèle à la réalité. Les
mecs, ils étaient comme ça. Ils étaient totalement seuls.
Ce paysan n'avait pas le petit intermarché du coin. Et quand bien même,
il n'aurait pas pu payer, il n'aurait pas su. Il savait très bien que
s'il voulait bouffer, il devait planter ses patates, récolter ses châtaignes,
sarcler ses dizaines d'acóls accrochés à la pente, faire
la tuade du cochon, quelques jours même lutter avec âpreté
contre la burle. Des bergers dans cette veine-là, j'en ai vu un paquet.
Alors je m'arrête, je discute et je dis, il reste combien chez vous ?
Oh deux.
Y'a moi j'ai 180 bêtes, et y'a le voisin là-bas plus loin, c'est
150 bêtes.
Silence...
Mais sur le versant là, je ne parle pas d'en face, juste ce versant hein,
y'avait 6000 bêtes avant. La déprise agricole, ça a vraiment
semé la pagaille, que dis-je, la merde. Là maintenant c'est foutu.
Tu as les fougères qui viennent, demain ce sont les genets. T'as plus
un homme, avec les hommes t'avais les chiens. Maintenant les sangliers descendent
et ils ravagent tout. Voilà c'est ça la vie d'ici.
Vincent : Oui mais cette solitude si âpre. Bon je sais que ça a
été tourné au Pont-de-Montvert, c'est plus haut et donc
plus dur qu'ici, mais cette solitude poisseuse, tu sens, ça colle aux
mains...
Bernard : Tu sais les gens étaient comme ça, c'était comme
ça, c'est tout, et ils n'étaient pas malheureux.
Puis Camille dit : On a pensé à toi ce matin, avec la pluie persistante. Et là soudainement un espèce de flash s'est produit. Tu sais Camille il faisait si mauvais, j'ai simplement engrangé de l'administratif. Il faisait deux degrés dans la roulotte. J'ai mis les doubles chaussettes de Nadia, le bonnet rouge foncé sur les oreilles, engoncé jusqu'au cou dans le sac de couchage. La pluie crépitait sur le toit en zinc, j'étais si bien, je le jure, si bien emmitouflé. Alors je comprends ces vies rudes, ces existences paysannes dont il ne reste presque plus de traces, sauf des photos anciennes dans les livres. De vieux nés ici, il n'y en a quasiment plus. Seul Honoré on pense. Même les Duval, arrivés dans les années cinquante à Roussel, ne sont pas nés ici. Peut-être Line à Thines, on ne sait pas, on oscille. Mais quoi qu'il en soit, on ne parlait pas. On était avec les bêtes, avec le chien ; on ne disait rien en fait. C'était correct après tout.
Oui je suis tellement bien dans ma Raymonde, dans mon sac de couchage, ma bouche
fait des panaches de vapeur, mes doigts sont gelés à me dépêcher
de raconter ces histoires avant de les oublier, avant d'être submergé
par de nouveaux récits, et surtout de nouvelles émotions. Au contraire
de la ville - où l'on se trouve à être sauvagement seul
parmi le monde (et où l'on en souffre peut-être encore plus ; grand
bien me fait au cœur que mon frérot ne vive pas cela), cette campagne,
on s'arrête et on vit. Camille et Jean, à peine arrivés
ici, de ça une bonne grosse dizaine d'années, voient un vieux.
Ils se présentent.
Je sais, répond-il péremptoirement. Je connais votre véhicule
!
J'ai 94 ans qu'il lance soudain ! Hé, vous ne me croyez pas hein ! Puis
il tend sa carte d'identité.
Il fait glacial et humide, je pense à mes proches, que j'aime plus qu'avant
je pense [le cœur en a le temps]. Cette citation d'Ella Maillart (Des monts
célestes aux sables rouges) : il aime mieux manger du sorgho toute sa
vie, ne plus voir de sucre ni de viande, mais n'avoir pas de maître. La
vallée ici, c'est ça ; ces quelques mots résument tout,
ce que l'on est, ce que l'on aime.
Remontant prestement après ce repas - il fait froid, je ne traîne guère - je passe devant le monument aux morts des fusillés de 1943. C'est vrai qu'une fois, il faudra que je prenne le temps d'expliquer cette tragédie, de ces résistants piégés et fusillés par les allemands ; c'est l'actuelle maison de Léo et Léa. Et donc effectivement, il est bien mentionné le nom d'Alphonse Bataille, 25 ans.
Mais Bataille ce n'était pas son patronyme, c'était son nom de résistant. Ce qui fait, en outre, que durant longtemps, il n'est pas mort, tout du moins officiellement. Le souci, c'est que ça a bloqué l'héritage - certes, puisqu'il n'était pas mort - et donc sa ferme en Lozère est tombée en déshérence. Le frère a perdu son frère, assassiné, et est resté sans rien du point de vue de la pierre. Ca a si tant duré, c'est Chirac qui s'est occupé de ça. Juste avant la fin de son mandat, il l'a fait déclaré mort tout court, et ça s'est solutionné comme ça.
Camille renchérit sur une vieille histoire, des amis d'amis, donc ce
n'est pas du coin. Deux femmes étaient parties en Espagne, avec leur
voisin dans la caravane. Sauf que ce dernier, un vrai petit-vieux, est mort.
Il a été emporté par un infarctus. Complètement
paniquées, les deux filles décident de remonter en Belgique. Le
trajet étant long et fatigant, elles s'arrêtent à un motel
quelconque, en vallée du Rhône.
Sauf que dans la nuit, la caravane a été volée. Le corps,
enterré on ne sait trop où (nous devisons alors de la sauvagerie
immense de certaines de nos combes, dont notamment cette impressionnante crevasse
sous le col de la Croix), il en est ressorti que le pauvre petit père...
n'était pas mort, tout du moins officiellement puisqu'ils ne l'ont jamais
retrouvé. Tout le problème des disparus. L'héritage avec.
Dehors, Sky nous regarde par la fenêtre, beau et gentil comme tout, il donnerait un tiers de la moitié de l'univers pour qu'on lui jette un bâton. Comme ça, une seule fois, s'il-vous-plaît - nous craquons, nous ne devrions pas ! Assez soudainement, nous revenons à nos arbres. Il faut absolument que nous préparions nos greffons, c'est la période pour le faire, puisqu'alors nous grefferons en mars durant la montée de sève. Au loin, des nuages menaçants s'écrasent sur Maurine, sur Hugon, sur le ranc Lancié. Malgré les déboires, les échecs, quelquefois sordides d'ailleurs, sourds sentiments mélancoliques, l'esprit vogue en arrière, Louvain-La-Neuve particulièrement, cette cité ubuesque follement aimée, mais non, je ne regrette rien.
C'est un pâteux grisâtre lent-pluvieux et cela fait en quelque sorte une dizaine de jours que ça dure. Nous montons sur les hauteurs des Vans, stationnons le véhicule, puis abordons un bâtiment à l'aspect préfabriqué - cela pourrait être un hôtel formule un. De longues dégueulures noires d'humidité suintent sur les murs, particulièrement à côté des fenêtres. A l'intérieur, c'est monotone, insipide, hospitalier, empreint d'une écrasante neurasthénie. Le personnel est prévenant mais après voilà, le lieu est comme ça, c'est l'Ehpad des Vans, la même chose que ces centaines d'autres choses partout, cela ne fait nul doute en réalité. On n'en sort pas, ou tout du moins pas comme ça. C'est fermé ; pour éviter aux très dépressifs ou en démence sénile d'aller en errance, prendre froid, tomber dans le cours d'eau. Un clavier avec une étiquette mentionne Drôme Ardèche A. Le code est 2607A. La porte grésille. On en est là.
Nous allons voir le Bésigue, 85 ans. Il s'appelle Gilbert, mais ici nous avons tous des surnoms. Bézigue a plusieurs sens mais en ce cas présent, ça signifie le bon à rien. Assez lourdement handicapé, il a une main de guingois et une jambe le faisant boiter. Il n'en a pas moins travaillé, sans nul doute même plus que nous tous réunis. La vie était comme ça à l'époque. Voisin de Camille et Jean, anciennement de Marcel Clavel, il a habité à Tastavins jusqu'au dernier des derniers instants. Il restait sur sa terrasse, tout le monde lui rendait une petite visite dans la journée. Le Bésigue était comme ça. Puis des temps où son handicap se renforçait, il venait en voiture avec Camille et Jean, juste pour bouger. Il se plaisait à dire : cette terre, c'est à moi, cet arbre, c'est à moi, tu vois la clède là-bas, c'est à moi. C'était (et c'est encore) un grand propriétaire, paysan attaché à sa terre comme un monument sacré, qui préfère la garder quand bien même ce sera la faire crever, plutôt que de la partager.
Il eut un grave accident de voiture, l'âge accélérant le risque en fait, et il s'est retrouvé à l'hôpital. Dans ce rez-de-chaussée hospitalier, il ne s'y passait à vrai dire pas grand chose. Puis, au bout de deux ans de revalidation, tout de même tout ça, il demanda : qu'est-ce que je fous ici ? On lui répondit qu'il était en gériatrie. Fou furieux, il empoigna un papier, signa une décharge de responsabilité, puis il mit en œuvre les appels téléphoniques afin de rentrer. Bernadette et Marité firent les démarches pour emprunter un caddie au Carrefour des Vans, pour le transporter, système D si l'on peut dire ; il fut installé des rails dans la rue du dessus, enfin c'est un simple petit chemin pentu et caillouteux. Madeleine s'est occupé de lui chaque jour durant plus de six mois, probablement tout autant que Marité. Un grand dévouement.
Puis vint le temps où, exténué par l'âge et le handicap, il chuta, au deuxième étage de chez lui (photo d'entête, sa maison). Au sol, il implora de l'aide. Sa porte était fermée à clé. Personne de nous, dans tout le hameau, ne fermons, quand bien même nous partons aux Vans. C'est le courage de mes voisins, Léo, Laura et Auriane, qui l'ont tiré de là. Ils ont apposé une échelle et l'ont porté. Il en est encore reconnaissant et ému à ce jour, malgré l'immense dédain qu'il peut ressentir envers la vie ; peut-être même de la hargne.
A l'époque, nous dit-il, on allait faire les foins là-haut sur les prés de la Rouveyrette (ce ne sont plus que des hordes de genets à ce jour), nous redescendions par Lespinasse. Tu vois ça ? Oh que oui, c'est titanesque. On imagine mal les énormes bottes de foin, pour nous qui peinons aujourd'hui là-haut avec un simple sac à dos.
Et autrefois encore... J'ai une ruine là-haut quand tu prends le chemin
de Montselgues, la grange dont désormais un pan est effondré.
Nous avions des pommiers... Mais aujourd'hui tout est crevé, tout. On
allait chercher les pommes, de la rougette de la Borne. Nous les descendions
sur le dos, dans des sacs de jute. Et sinon on allait châtaignier là
un peu plus bas de l'autre côté de la rivière. On transportait
sur le dos du mulet. On allait tout porter à Salindres. On était
huit frères et sœurs, dis-toi bien que ça ne faisait pas
un salaire. Et tu vois la source face à la grange, avant les Boyer ?
Et bien elle est à moi. Il n'en reste rien des châtaigniers ? Ils
sont malades ? C'est quoi la bête qu'ils ont mis pour manger la maladie
? Ca marche ? Parce qu'il parait que ça marche bien. Enfin bon c'est
des ronces maintenant le coin.
Un de ces jours comme ça, on descendait les ruches-troncs [c'est une
pratique cévenole qui consiste à faire des ruches dans des troncs
de châtaigniers évidés, ensuite recouverts d'une lauze].
J'en avais accroché deux dans mon dos, avec une corde, ce n'était
pas facile. On avait mis un plastique autour, pour essayer de se faire piquer
le moins possible. Puis voilà, on a été jusqu'au Garidel,
comme ça, avec les troncs.
C'était dur à l'époque, y'avait tout un pan de la grange qui était tombé, alors on a fait ce qu'on a pu avec du bois. Mais bon, il a fallu monter le ciment. Soit, le ciment on va dire que c'est bien, mais il faut du sable. Où trouver du sable ici ? Dans le fond de la rivière... Un peu, c'est malingre ce qu'il y en a. Alors j'aime autant te dire que du sable, il n'y en avait pas un paquet ! Ca a tenu ce que ça a tenu. Maintenant y'a plus de bêtes là-haut.
Aux murs sont accrochées deux photos. L'une, c'est sa maison depuis les vergers, à ce jour inoccupée, l'autre une vue de la vallée depuis le grenier, une vaste demeure d'ailleurs. La troisième photo, ce sont les gours de la rivière de Thines. Il dit : avec leur dos, les femmes qui passent pour me laver, elles arrachent, ça dépasse. Nous voyons bien que personne ne remet en place. Puis au gré de quelques derniers mouvements, il insiste : ne met pas les fleurs ici, ça va déranger. Ca ne s'arrose pas de toute façon.
La respiration est lourde et pesante, une jeune femme vient pour le repas. On le voit, elle est infiniment patiente, mais pas un mot envers Monsieur Comte. J'en ai marre d'ici, je vais partir. Personne ne vient me voir, je vais partir à Alès. L'année dernière c'était pareil. En quittant, nous allons saluer Marcel Clavel, 94 ans, petit hibou souriant, qui dit oui à tout. Il ne sait plus quel temps il fait aujourd'hui. Ca respire le mal au cœur, c'est moche de partir comme ça.
Nous repartons le moral plombé. Tristesse mêlée de ces sentiments d'acidité reflués à tout va, de propos acerbes et certains tranchants ; pas même une nostalgie, juste une rancœur sourde, sans but, sans cible. Sur la route, nous retrouvons notre vallée, aujourd'hui plongée dans d'intenses brumes rampantes, puis des pluies longues, fines et hivernales. Au sein de la belle roulotte Raymonde, il fait si-tant humide que les dessins d'Aure et de Lou-Hann sont gondolés. On attend tous le soleil, Madeleine en premier on le devine, ça nous fera du bien. On prendra un thé sur la terrasse, ensemble, même s'il fait froid, on parlera du Bésigue. Et puis rédigeant ces lignes, me remémorant l'odeur de mort dans cet établissement, une dame sénile se dandine dans le couloir, parlant aux dieux du ciel ou bien nous ne savons pas trop à qui à vrai dire, une autre entend du bruit et nous demande à être changée, plus que jamais on ressent au fond du cœur une urgence : profiter de la vie, réaliser qu'elle est belle (même si elle est dure, malgré les innombrables épreuves). C'est un enseignement de vivre ça, un grisâtre dimanche matin sur les hauteurs des Vans. Tout mauvais temps - même long comme un train de marchandise - parait une aubaine.
Lorsqu'on en vient, comme ces paroles qui retournent, à ne jamais nommer les proches des amis mais des collègues.
" Moi je me suis fait une philosophie. Le plus grand des conforts, c'est d'être bien dans sa tête le cul posé sur un caillou. C'est là qu'on est le plus confortable. On est libre. Jean-Marie Naud, La Bastide, avril 2011 ".
Puis il y eut un jour où je partis de La Boissière, en vue de réaliser d'inextricables grasses fournées de démarches administratives, tout à la fois aussi bien souhaitées que factuellement abominées : en quelque sorte surtout le sentiment futur de satisfaction que cela soit derrière, enfin achevé, mais bref inévitablement s'en aller. S'enliser dans un dégoulinant ressenti de home sweet home, oui cet instant où l'on pourrait dire en fin de compte que de quitter Tastevins, je n'en avais pas une envie débordante. Soit, faire ce qui doit être fait, en toute légèreté, un brin d'honnêteté aussi ; ce n'est pas grand chose, puis bien des instants agréables sont d'ores et déjà prévus : tout enchaîné tel un jeu de dominos, emploi du temps serré, clap de départ.
La veille au soir et de partout, j'ai couru comme une demi-poule-sans-tête. Cela me rappelait les torrentueuses éructations de mes parents lorsque les vacances arrivées, c'était la redoutée veillée précédant le départ. Comme si cela n'avait pas pu être fait avant, oh oui à chaque fois simplement la même chose, pour ainsi dire un rituel. Certes, je nage en plein dans la mélasse, me jetant toutes sortes d'invectives douteuses : je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même ! En réalité c'en est si ridicule qu'au gré des escaliers, je me mets à rire tout seul : je me moque de moi. J'envoie un sms amusé au frérot, hé tu te souviens des parents !
Cinq heures vingt le lendemain matin, la porte de Raymonde se referme dans la nuit, surgit soudain le manque, oh purée, le manque d'être là ! Il va falloir faire avec et celui-là, je ne m'en serais pas douté, tout du moins pas à ce point. Ma lampe frontale balaye les fourrés alentours. Des dizaines de petits yeux verts clignotent dans la nuit, puis disparaissent. Peut-être renard, fouine, belette, un sanglier éventuellement, mais bref renard surtout. Peut-être un s au bout de chaque nom d'animal, aussi.
Cela pourrait être en heure de pointe le rond-point de la planche à voile près de Wavre tout comme les petites routes malaisées du Brabant-Wallon, saturées de circulation à n'en plus finir, cela pourrait être les archi-grises autoroutes urbaines du pourtour parisien comme la vallée de la pétrochimie au sud de Lyon, ça pourrait être les anciens collègues de travail, les chefs les virés les restants ou disons pour ces derniers les survivants, voire même encore cela pourrait se compter comme les anciens-amis-d'encore-aujourd'hui : il est impressionnant de voir que rien n'a changé.
Rien.
Le système n'a pas dévié, il n'a pas infléchi sa course, il n'a pas juste-un-peu changé, quand bien même disons alors, uniquement de l'apparence. Non. Brutalement, rien n'a changé ; c'est ça, rien d'autre à dire. Ceux qui ont été bons sont toujours bons, ceux qui furent mauvais le sont tout autant. Il m'avait été dit par Johan : ils en useront vingt avant de se rendre compte, parlant de collègues épuisés, de virés, de conflits, de procès même : tout est encore là. Non ils ne se rendront pas compte, pas plus hier que demain. Le bénéfice de la parfaite normalité. Les anciens procès s'enlisent sans devenir, de nouveaux se forment tels des nuages sur un front de mer colérique. Il en ressort une stérilité étonnante. L'abjection persiste à former rivière tel le torrent de détritus surnageant dans les eaux fangeuses du Gange, qu'en sais-je même peut-être un fleuve, derrière ça des gens au grand coeur restent à leur place, à rasséréner. Puis ça dure, ça perdure, la vie.
C'est à ce point stable qu'on en viendrait à se dire que ce fut un gâchis de partir ; c'était une foutaise de penser que la société thermo-industrielle allait se déliter, un fantasme bobo-écolo-naturaliste de cultiver au plus près de la terre. Et puis quoi ? Il suffit de peu de temps, que cela soit sur les dalles austères de la place Flagey voire même ce corridor autoroutier repoussant et saturé entre Nancy et Metz, pour que le manque renaisse voire même assaille. Deux questions : comment cela peut-il tenir ? Comment se fait-ce qu'immédiatement, je redevienne stressé et agressif ? Soit, c'est autocentré. La seule question est de savoir comment tout ce foutu boxon peut encore tenir. Tant de monde se trouve sur la corde raide : des trajets tendus, un métier tendu, des loisirs même tendus, pour un peu : vite y aller car le temps manque. Hallucinant oui, revivre ce temps qui manque. Douloureux le bazar. A La Boissière, le temps est long, il ne se passe que très-très rien. Une délectation peut-être. Un manque certainement. Il n'est d'autres mots.
Reste qu'ici à la ville, à les villes car c'est un tout, le mot vivre est facile et la solidarité prend la forme d'un tour de bras. J'ai collecté en quelques heures ce que j'aurais mis des mois à Tastevins : des seaux de récupération en métal, un pétrin pour le pain, des centaines de pots de confiture vides, des plateaux de semis, du bicarbonate, et j'en passe des vertes et des pas mures. Marguerite 2 est surchargée [oui je sais, mes véhicules ont des noms ridicules, et en plus pour d'obscures raisons, ce sont des deux ; mais soit au moins je ne l'ai pas appelée Titine, c'est déjà pas mal hein, et interdit de se moquer d'abord]. Puis encore, je passe les palettes sur les bords de routes, que j'aurais bien embarquées, mais je n'ai pas la remorque deux tonnes. Même comme ça, oui même au-delà de cette facilité dérisoire, je regrette mon trou-perdu. Soit, même quand il y pleut des cordes ; oui je sais, il est à se demander si c'est pour l'écriture parce que ça donne bien, ou si c'est foncièrement malhonnête ; jetez-moi la pierre, je suis méritant ! La Boissière, c'est dur, mais ça fait sens. Ici dans tout ce temps d'avant qui ressurgit pétrifié d'un inchangé cristallisé, la nostalgie pointe, mais ça ne s'éternise pas. Peut-être serait-il juste de dire qu'avant c'était bien, et maintenant c'était bien, enfin c'est bien faudrait-il édicter. Finalement, n'est-ce pas faire la paix ? Avec les autres, avec les lieux, avec soi-même. J'eus les paroles : j'ai tiré la chasse d'eau. Possible réminiscence de propos acerbes, qui furent nombreux en une période, je pourrais les ressortir du sac sans guère de geste superflu, mais en fin de compte j'ai purgé. Passons. A toujours regarder en arrière, je vais finir par simplement collisionner un mur.
Au fond ce qui est rassurant, c'est que personne ne m'en veut, ou tout du moins cela ne ressort pas. J'ai l'impression que c'est sincère. C'est un essentiel. Car ce n'est agréable pour personne, un départ, ce de surcroît que la suite -la fuite un mot qui ressemble- fut loin d'être le récit d'un prévu au long cours tranquille. Quant aux déjections administratives, il est peu dire que c'en fut la longueur d'un anaconda - injuste d'ailleurs, mais autrement que de subir et de réagir, qu'en dire et qu'en faire ? Le système est moribond, mais il s'accroche. Alors voilà, aujourd'hui, les paroles sont brutes : il faut faire avec. A terme, La Boissière sera un refuge - pour un peu, elle l'est déjà considérant le regret du départ - il n'est d'autre but ; refuge pour moi, refuge pour toi : la forme d'un nous. Après tout, n'est-ce pas une certaine célébration de victoire d'afficher cet optimisme désormais ? Hormis que je n'ai pas à juger, il s'avère que c'est inutile et pédant : lorsque la société thermo-industrielle s'effondrera sur elle-même, surtout une implosion à défaut d'une explosion, nombreux seront ceux qui en ressortiront du bon. Il est péremptoire de mépriser. Finalement, j'essaie d'honorer ma vallée perdue. Est-ce un devoir ? Peu importe. Ce qui compte est que l'humain soit bon avec l'humain. Que cela soit sur le rond-point de la planche à voile ou aux confins de l'église de Thines, il en est de même. Parfaitement de même.
Honnêtement, je ne sais plus quelle sagesse m'anime, mais s'il est une chose que je puis dire sans faillir : pour sûr, elle est lente.
S'il est un temps où réellement je ne sais plus, c'est ici sur la bascule : je ne suis pas encore fixé à La Boissière, et résolument les parcours de ces derniers jours m'ont prouvé, incontestablement et quasi-abruptement, que je ne suis plus de ces anciennes terres. Il n'aurait pas été étranger de déclarer, sans une quelque démesure, que je n'ai pas reçu d'émotion à l'idée de Louvain-La-Neuve. Alors apatride. De la terre de nulle part. En attente d'un passage, en fin de compte moi aussi ; ces sms qui disent : we are in uk ou bien, we crossed the border. Ces quelques mots après 149 essais, ou une quelconque valeur (en réalité je ne me souviens plus) : c'est de ça qu'on a besoin. Un jour il ressortira un pareillement je suis La Boissière. Une victoire, un rêve ? Non je n'ai pas cette sensation. Le rêve implique du grand, une consécration, la victoire sous-entend éventuellement d'avoir terrassé un adversaire. L'acte d'être impliquera avant tout du petit, une retraite, un laisser-aller, un apaisement. C'est peut-être ça, avoir le temps en somme. Avant j'édictais : je n'ai pas le temps mais je le prends. Aujourd'hui, je suis léger comme un petit oiseau, insignifiant sur une branche ondulante aux vents. Ca insuffle du mieux dans le cœur : le temps est un rapport absolument essentiel à la vie. Alors, comme il se doit, je redescendrai par Lanarce.
Et je sais très bien qu'après Lanarce, les routes deviendront plus petites, et puis plus petites encore. Exactement les mêmes paroles que la dernière fois, début décembre. Alors, au Clapeyrol, je m'arrêterai. Mon regard se portera au très loin sur cette vallée (c'est de là qu'on la découvre pour la première fois) ; en cette précédente occasion elle était embrasée par des panaches déchirés de couleurs d'automne, déchiquetés sur les pentes. Puis aussi soudainement que c'est apparu, le manque s'éteindra sans faire de bruit. Ca fait une semaine et ça ressemble à une éternité. Une simple éternité-longue qui, aussi banale qu'elle fut, a confirmé des sentiments ; ça fait du bien, ça démonte du doute. Lorsque je partais le 29 juin, je fuyais. Désormais je dis au revoir. C'est curieux, c'est différent. Bon vent entendis-je, sur un ton protecteur, pour de vrai je veux dire, pas simplement un mirage, là-bas très loin sur l'horizon de la mer. Même si rien n'a changé - ce dont on ne se surprendra pas - c'est précieux de savoir que le bon est resté bon, et désormais peu importent les restes. Là-bas dans le recoin courbe de cette vallée perdue, c'est à ça qu'il faut penser : encenser, chérir, protéger, au-delà du jour où j'enverrai ce fameux sms, à ma façon, we are in uk. Hormis d'indéniables bonnes choses, que tout cela manque.
De ce grand trajet d'un monde à l'autre, c'est peut-être celle d'un décrescendo dont il faudrait garder l'image. Tout d'abord à Montargis, l'on pourrait parler d'un déluge de camions. Pas la peine de dépasser, le suivant du suivant est en vue, transport de marchandise indonésienne, déforestation, huile de palme, du genre probablement. Les deux tours de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (ou plus-du-tout belle ville soit dit en passant) émergent avec peine de la brume, spectacle dantesque de mort, réminiscence d'images lointaines de Chornobyl, le même climat de plaine alluvionnaire peut-être, je ne sais pas trop. A la radio, les rebellocrates de France Inter (le seul truc que je capte, pour passer le temps, je n'ai toujours pas mes disques), s'excitent sur des conneries, virant à l'obsessionnel au fil des heures. Ca les travaille, ça sent le verbe pleinement parisien, l'accent, le mot parfois. Chansonniers de l'Etat en louanges indistinctes : les politiques on les aime, ils sont indispensables, ils vont permettre la croissance, la croissaaaance...
Au gré d'un déluge ininterrompu de conneries, Rance Inter méprise ce qui ne lui ressemble pas, allégresse fusionnelle d'un corps de métier devenu comme ça par glissement imperceptible, une question toutefois, et soudainement saisissante : qui admirez-vous ? Un grand temps de silence, non pas que trouver s'avère une gageure, non, plutôt la simple et limpide question : serait-ce autre chose que ? Par justesse, par pureté, par équité envers les autres ?
J'admire Julio Llamazares, pour avoir imagé la mort comme un moment ni effrayant ni désirable, un instant très doux, qui convient un peu comme toute chose, une tasse de thé fumante lors d'un repos impromptu dans un après midi frisquet, une mélodie emplie d'une sérénité suave et discrète. La mort est assez souvent abordée sous un regard d'intensité, honnie, douloureuse ; c'est la violence de la fin. Au gré d'un parcours dans la forêt, Llamazares en a fait une chose comme une autre - pas banale comme un livre de cuisine -, sans emphase, sans dépression, sans idée suicidaire, sans éloge mielleuse de la beauté de l'existence, et s'il est une chose que ça force, c'est l'admiration. Je ne connais pas, ailleurs, de monologue si pur.
A partir de Gannat, la longueur du trajet a paru infinie, mais au loin pointaient les premières couleurs vert-bleu-gris-noir tout ça ensemble des monts d'Auvergne. Un premier sentiment naissant, ça y est, c'est beau. Puis enfin la Haute-Loire, Costaros, Landos. De moins en moins de monde. Deux heures restantes. C'est abordable, ça se rétrécit.
A partir de Lanarce, je n'ai plus vu personne, comme la dernière fois. J'ai dû éviter des cailloux sur la route, puis contourner un troupeau en goguette à proximité de Loubaresse. Très doux sentiment d'être chez soi. Lorsque j'ai abordé Raymonde, la belle roulotte restée seule dix jours - long, rapide, intense, mille kilomètres heure - le temps s'est ralenti. Puis le lendemain encore. Ralenti, ralenti, ralenti. Je me suis à nouveau retrouvé devant le vide, j'ai senti ça très bon. Puis, face à cette immensité de solitude, de rien du tout, même pas d'absence parce qu'il n'y a personne, du temps à foison, une pression inexistante, un rythme engourdi, je me suis ressenti comme face à la mort : ça doit être ça, un moment ni court ni long, où bien comme tout, on lâche la course effrénée - presque ça sert à rien, stérilité des gestes inutiles - la grande, l'immense sérénité du vide. En repartant de mes terres-d'avant, je mêlais ces sentiments ambigus : beaucoup de gens adorables, mais beaucoup de monde, de mouvements, de bruits, de densité. Cet écart désormais est ma maison. Ca pourrait être aussi bien ici qu'un ailleurs ou toute sorte d'ailleurs comme ça, toutefois se nourrir intensément d'un rien-du-tout, modeste et tangible.
Il serait outrancier de dire que je n'ai pas apprécié ce séjour (au contraire, sans détour aucun, sans hésitation d'ailleurs). Les gens aussi bien charmants que simplement sympas ont répondu présent, malgré des délais plutôt brefs et des parcours un peu tendus, c'est un bénéfice mélangeant à la fois l'altruisme et le côté affectif. En réalité, c'est un peu une question de place. Certains aiment le très rangé, d'autre un milieu de vie désordonné, certains le foisonnant, d'autres l'austère. En réalité, ce qu'il ressort, c'est que la pression urbaine engendre un malaise, car quoi qu'il en soit, aucun humain n'est fait pour apprécier un embouteillage, une autoroute, le bitume surchauffé, l'entassement dans des appartements boîte-à-chaussure de faible qualité, l'emploi salarié dégradé. La Boissière offre un autre. Oh, disons-le, loin d'être parfait, on le sait. C'est ampoulé, dur parfois, douloureux en certains évènements ou certaines solitudes hivernales, mais c'est sain. Cette ruralité, elle pourrait être mille. Oui je suis attaché au caractère sauvage de la Cévenne, mais le Cézallier le vaut tout autant, l'Aubrac encore mieux peut-être, et qu'en sais-je.
Ce qui fait des nœuds dans tous ces cordages, lieu ou pas-lieu, c'est la solidarité. Certes nous n'avons pas servi à grand chose lors d'un passage chez Ut-ut près de Saint-Julien du Sault, à tendre une bâche de serre, mais ce qui compte est la solidarité : être là, comme ça, simplement ; c'est choupinou-positif. Pour le moral c'est énorme. Le reste suit, le reste du reste importe peu. Je le sais d'un vécu au parcours simple : cet hiver, La Boissière était d'un poids si lourd, je craquais de toutes parts, des fissures dans le corps. Les gens qui m'ont soutenu liront (ou ne liront jamais) ces lignes. Ce n'est pas moi qui aie tenu, c'est nous. Nous tous. Ensemble. L'entraide, l'autre loi de la jungle.
Le présent, tout comme le futur rêvé chaque jour, fragile, vaporeux, n'est que ça ou quasiment. Lorsqu'on me demande de quoi j'ai besoin ici, je bredouille des pots à confiture vides, je bégaie des hésitations brouillardeuses. Oui certes c'est vrai, mais au-delà, ce qui est nécessité représente avant tout ce qui permettrait de rendre heureux autrui, et du coup ça peut être tout et n'importe quoi ; en réalité la relation est avant tout d'avoir vidé mon existence de l'objet de mars à juin 2019, le but n'est pas d'entasser à nouveau. En quelques mots, rendre les autres heureux avec une spontanéité enfantine. Après en somme, je suis si content de voir une sitelle à l'envers sur un arbre, ou m'émerveiller devant un lever de soleil un peu audacieux, que m'importe le reste ? La société a voulu nous fabriquer comme un catalogue de supermarché, je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus aisément tolérer ça. L'entraide comme mode de fonctionnement, l'objet que s'il rend un cœur lumineux, parce qu'on est de cette marque là par ici. Puis parce qu'on va mourir un de ces jours et que le temps passe à toute allure : quand on repense aux moments précieux, c'étaient les entraides reçues, celles données. N'est-ce pas exact ? Prémonition que le monde d'après sera ça.
Comme le cite mon frérot, une brève de rue rigolote : il était visionnaire avant les autres.
Faut-il avoir mon âge pour se rendre compte que seule la femelle Colvert fait coin-coin, le mâle n'émettant qu'un sifflement ? Est-ce normal de percevoir un réel trou noir concernant cinq années d'enseignement de sciences physiques en secondaire, de calculs et de mécanique des sols à l'université ? Trou abyssal, il m'est impossible de dire ce qui fut enseigné. Ca parmi d'autres. L'on me rétorque : il s'agit d'acquérir une logique. N'empêche que je bute encore et toujours à faire mes macérats glycérinés, les savons que je fabrique sont mous dès les chaleurs, je peinais encore jusqu'à peu à démarrer un feu. Que dire ? Quelquefois le sentiment de parcelles d'enfance perdues, ou non c'est complexe, plutôt rangées dans de mauvais emplacements. Toujours cette question de lieu : être à sa place. Il faut se pardonner. On ne lutte pas contre ça à 13 ans. Il est déjà un bénéfice de ressentir en soi la bonne place maintenant - c'est comme si soudainement, le bazar s'apaisait. Alors on se marre quand un mec pas très net fait groink-groink dans le train, devant des pâtisseries pour le moins indécentes. On s'offre de petits bonheurs. Juste des petits, ça suffit bien.
En promenant, épuisé le soir, j'ai vu que le captage a pété
chez le vieux Cartier. L'eau dégouline sur la terrasse. Je n'étais
pas là ces derniers temps. Ca doit faire des semaines probablement, encore
que, qui pourrait le dire en vérité ? Je suis le gardien. Beheerder
que je dis aux gens d'en haut, Léo et Léa ; je ne connais pas
d'autre mot en réalité. Ca me fait marrer. Gardien comme ça,
autoproclamé, gardien des brebis, des chevreuils, du vent, de la flotte,
des chiens des autres, du courrier qui prend l'humidité, puis de rien-du-tout
la plupart du temps. Alors là, l'eau jaillit à grands flots, faut
bien que quelqu'un s'en occupe un minimum. On n'a pas l'eau courante. Toutes
nos eaux sont des captages qui passent dans les béalières (des
petits canaux), ou des sources. Le gel a dû faire son office. On me dit
que de toute façon, c'est chaque année.
Bon gré mal gré, je tire la flotte plus loin, sur les acols, là où ça ne dérange pas. Il vaut mieux ne pas couper son captage. C'est une foire d'empoigne à réamorcer. Alors voilà, ça s'en arrête là.
[J'ai envie d'être seule. Comme tous les soirs. Ne parler à personne. Lire, écouter la radio, prendre un bain. Fermer les volets. M'envelopper d'un kimono en soie rose. Juste être bien. Après la fermeture des grilles, le temps est à moi. J'en suis l'unique propriétaire. C'est un luxe d'être propriétaire de son temps. Je pense que c'est l'un des plus grands luxes qu'un être humain puisse s'offrir. Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs].
Ici le tumulte n'arrive pas.
La rue est la rue depuis toujours. Tastevins en somme ce sont deux voies : la route, si peu fréquentée que l'herbe en pousse au milieu, puis la rue, un étroit chemin en herbe et vaguement encaladé, bordé de murets. Depuis la déprise, ici, toujours est toujours, rien est rien, c'est comme ça, les maisons fermées. Les gens qui ne sont pas là : les gens qui ne sont jamais là. Depuis que je suis présent dans ce hameau, cinq mois désormais, de l'écrasante majorité des foyers, je n'ai vu personne.
Ici plus qu'un ailleurs, on vit sans passion. C'est lisse, plat, tranquille, tellement tranquille que c'en est un épitaphe sur un marbre poli. Il ne se passe rien, sauf un épisode cévenol déversant ses torrents d'aigreur parfois. Devant les flots de la rivière, l'on se prend à contempler la hêtraie de Chabreille. Qu'on y est bien. Là-bas, il n'y a personne, jamais jamais jamais. Sauf moi, dans les feuilles jusqu'aux genoux, glissant sur les faînes, s'écrasant la main sur une châtaigne. Une immensité de solitude accrochée sur une pente à quarante cinq degrés, un ruisseau dévalant de gros rochers éparpillés, sous des arbres effondrés quelquefois, un chevreuil qui aboie parfois, on s'en doute quelque part.
Ici, ici encore, la vie c'est comme la mort. On s'en fout du tumulte, qui n'arrive pas - ça fait bien longtemps d'ailleurs. Les routes sont trop longues et trop étroites. Il peut se passer n'importe quoi, on ne s'en rendra pas compte, même s'ils font un feu de joie de Cruas-Meysse ; tout juste on se retrouvera cramés, sans trop comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Nous sommes si proches de la mort que la vie nous en est indistincte. Et ce genre de maigre philosophie, ça nous permet d'écraser la mort d'un puissant mépris. Ca lui fait peur, qu'on se moque autant d'elle.
La semaine dernière, j'étais dans l'enfer. Avec mon frère nous arpentions les rayons du Leclerc de Barjouville. Autant le dire, une agonie, mais soit, j'avais réellement besoin d'une tondeuse pour me couper les cheveux. Tant qu'à être hors de ma brousse, autant en profiter pour faire les courses. C'était le lendemain matin du discours de Macron. Je ne vais pas épiloguer sur le contexte, un milliard de textes le font, trop peut-être. Les rayons étaient pris d'assaut.
Et quelle est la valeur refuge ?
Le sandwich en triangle emballé dans son truc en plastique.
Nous sommes en caisse, un magma de caddies débordants. C'est anarchique. Nous avons une tondeuse à cheveux et deux thés pour ma maman. Rien de plus. Une dame m'aboie dessus, haineuse : vous imaginez que vous allez passer devant ? La lave en fusion de gens grincheux rendait tout confus. Je ne lui offre aucune réponse, ni même un regard, puis m'en vais.
Les gens ont dévalisé les stocks de PQ, ils ont agressé le personnel, ils ont attaqué les réserves du magasin. A Dreux, ils ont dû fermer le mégabouffe (le Leclerc) à cause des violences.
[Plus je connais les hommes plus j'aime mon chien. Pierre Desproges].
Votre vie privée est notre priorité. Ce site enregistre des cookies, à défaut d'en cuisiner. Nous emmagasinons et traitons vos données à caractère personnel. Nous voulons votre estime, nous volons votre vivier de petits secrets, nous désirons vider votre frigo et votre compte en banque, et de toute façon nous le ferons quoi que vous en pensiez. Nous enregistrons l'heure où vous allez aux chiottes et traçons tous vos déplacements. En poursuivant la lecture, vous acceptez que nous vous vidions le cerveau. Vous serez notre esclave, votre asservissement sera de votre pleine volonté. En appuyant sur j'accepte, vous consentez à réaliser de votre vie un esclavage doucereux, dont vous porterez le fardeau chaque jour, tout en devant respect à la télévision, à la pub, au travail, à l'abjection.
J'ACCEPTE
Demi-tour. Route. Encore route, trop route ces derniers temps, Barjouville derrière, loin, le compteur kilométrique qui défile, heureux, Haute-Loire, vent, les arbres tous penchés dans le même sens. Un vent terrible sur les plateaux de Landos. Pause, frigorifiante bien sûr ; c'était bien, heureux comme une vache sortie de l'étable après l'hiver. Puis retrouver mes hautes vallées : Loubaresse, Borne, Montselgues. Comme un point de non-retour. Faites-donc vos courses de PQ. Loin, loin, loin, être loin de vous.
La vie en société, ce n'est pas gagné.
De cet instant, la seule question qui mérite d'être posée : n'était-ce pas un tant soit peu prévisible ? Ou même imprévisible, soit personne ne l'a vu arriver - pas comme ça - n'était-il pas possible de stocker juste un peu d'essentiel ? Vous trouvez ça honorable de gueuler comme des putois dans la file d'un supermarché à la con ?
Maintenon, alias Dead-Zone dans le langage partagé avec mon frère, la télé de papa et maman gueule. Affectueusement on ne leur en veut pas, ils n'entendent plus rien (et d'ailleurs ne s'entendent plus vivre) : bam, grince, crouik... De 110 décibels, une fuite, un dimanche matin très tôt, partir, je passe sans transition à 15 décibels. Le bruissement lointain de la rivière de Thines, les oiseaux qui se chamaillent ; ce que les mésanges peuvent à ce titre ne jamais lâcher l'affaire, elles harcèlent la sitelle, poursuivent les accenteurs, mais elles ne touchent pas au pinson (et pourquoi ?)
Ici la vie ne sert à rien. Pas de grand destin. Aujourd'hui repiqué 144 plants de laitues. Pourquoi autant ? Les grives pardi ! Et puis le reste on s'en fout. Seul, seul, bien, d'une solitude pâteuse, onctueuse, pour ainsi dire confortable. Je vais près du ruisseau si je veux. Je m'arrête dans la magnifique hêtraie dès que je souhaite. Et qu'espérer d'autre ? Rien mazette, surtout rien. Une vie qui ne sert à rien, ça enlève toute tension. On pense à ses salades, à ses céleris, aux voisins, aux oiseaux. D'une existence à gros gabarit, ça se dirige vers un plus grand chose, et honnêtement c'est sans regret. Enfin presque. Oui bien sûr pointent de puissants reliquats de nostalgie, vaporeux le plus souvent, toutefois reviennent les réalités : être un bousier, à tout le temps courir après de la merde (dont il faut ensuite fermement dire au patron que c'est la plus pure merveille) ; dans le silence curieux et retiré des tourbières de Chabreille, non aucune amertume.
Et pourtant, on ne peut pas dire que les lieux soient catégorisés comme accueillants. La toponymie explique bien des aspects, qu'en aucun cas il ne faut négliger. A la limite en exagérant un peu, on pourrait témoigner que ce serait une preuve d'immaturité de piétiner les noms des hameaux et des écarts tel un sanglier un peu moqueur. Certes le Clapeyrou ne nous dira rien (de surcroît que nous avons cinq orthographes pour à peu près tout et n'importe quoi, enfin soit, passons). Lorsque l'on quitte la piste, qui je le rappelle a été totalement retournée telle une crêpe suite à un épisode cévenol quelque peu taquin, on trouve le hameau de La Frette, ce qui en cévenol signifie le froid. Juste au-dessus se trouve Bel-Air, dont on ne fera guère un dessin. Au bout de ces deux chemins, les paysages se rejoignent en une seule maison nommée La Fouette. Doit-on encore préciser qu'il s'y trouve un peu de vent ?
Habiter sur le plateau, c'est une vocation. Plus encore vers Loubaresse, vers Borne, la beauté du regard des Michel, éleveurs sur ces hauteurs dénudées et sauvages. Très au loin et pourtant à portée de main, les terres enneigées du Finiels, du Cassini, les Monts Lozère.
Quel contraste quand l'une ou l'autre démarche administrative nous emmène dans les terres d'en bas, ce qu'en patois on appelle les Rayols. Aux Vans, en réalité c'est provençal. Lorsque l'on descend dans la vallée d'à côté, et c'est assez récurrent, dès Planzolles on trouve les vignes, à Faugères les oliviers d'Anaïs. Des fois, lorsque trop de froid nous transperce, on en viendrait quasiment à descendre pour descendre, sans autre but que de respirer ailleurs. Bien entendu, on ne peut pas se permettre de vivre comme ça.
Et d'être traversé, il est peu dire que ce fut le cas ces derniers jours. Au fil de la matinée, il s'est levé une burle de l'enfer. La burle, c'est le vent du nord et bref ici, le climat venteux est binaire : nord ou sud, basta-chocolat. Les vieux redoutent la burle, et tant ils peuvent se révéler assez moqueurs quant aux épisodes cévenols (hé tu verras bougre, c'est un petit celui-là, cette manie qu'ils ont de dire bougre à chacun-qui-connait-moins-qu'eux), autant la terreur quant à la burle est sauvagement ancrée en eux, un clou dans une planche.
C'est un vent furieux, cent kilomètres heure pour ses petites humeurs facétieuses, mêlé de pluie rageuse, et par dessus tout, une haine absolument glaciale. Travailler avec la burle comme collègue est abomiffreux. On en viendrait presque à apprécier l'Eissero, le très tempétueux vent du sud, à la limite comme d'un chef un peu atrabilaire, mais dont on s'habitue avec le temps.
C'est ainsi qu'au gré d'une journée épouvantable, j'ai essayé de travailler au potager, mais que de peine ! Apparemment en patois lotois (du Lot), on dit mascagner. C'est comment dire, s'acharner à travailler comme un idiot, improductif, et qu'on ferait mieux de rester au lit ! Ou, à défaut, avec une tasse de thé fumante. Le rêve ! Hé, vous croyez que je vous écris comment en ce moment ?! Mascagner, on ne dit pas ça ici, mais on devrait pourtant, car au vu du nombre de journées de vent, de pluie, de brouillard glauque, c'est un métier pour le moins répandu !
Mais en même temps, je ne sais pas vraiment si je souhaite évoquer autre chose qu'un gros-temps comme ça. Les gours de la rivière de Thines - ce dont tout le monde parle, l'eau limpide et fraîche durant les journées brûlantes de canicule - sera-ce un propos ? Je l'ignore. Ces dernières soirées d'hiver, j'ai lu une phrase touchante (Valérie Perrin, les oubliés du dimanche) : J'ai toujours été comme ça. Je rêve d'amour, mais dès qu'on me l'offre, ça m'horripile. Je deviens méchante et odieuse. Je-ne-me-rappelle-plus-comment est très tendre et je ne sais pas si c'est parce que la vie ne m'a pas fait de cadeaux, mais je crois que j'ai besoin d'un amoureux qui gratte comme du papier de verre dans les encoignures.
Sans que cela ne soit à propos - loin de moi l'idée de parler de rêve d'amour ; un cœur gelé - peut-être serait-ce là que réside le sentiment prédominant, tout en restant pour autant vaporeux et évanescent : l'été c'est agréable, mais on n'en a rien à dire. Ca ne gène pas. Il y a un temps pour tout. L'été a toujours été comme cela, un ouvrez les guillemets sur un temps avec les gens, avec le monde qu'on pourrait dire parfois. Ce n'est pas pour rien que deux demi-cinglés (on s'entend bien, on est givrés pareil) vont chercher les déserts minéraux - atrocement noirs - de l'Islande des terres, et reviennent avec des engelures au mois d'août. Qu'on se comprenne, on n'arrive pas à Tastavins par hasard. C'est l'une des rares vallées ardéchoise à être en impasse. Les autres sont traversées. Des gens, mais des gens qui ne sont pas là : ils passent, ils sont pour autre chose. Alors voilà, on est là, pour ça, pour là. Et quand on voit le regard rempli d'humanité de Jean Fournet, on en ressent une intense fierté. Et lorsque l'on entend les paroles de feu Noé Chat de Dépoudent [le gars avait l'air de toujours sourire, même dans la dureté de la vie] : la vallée, c'est la friche. Il n'y a plus personne. Plus personne qui a ces gestes là. Mais je crois que ça va revenir. Dans cent ans les gens reviendront à cette vie, a ces gestes. Ou peut-être plus vite que ça. J'en rêve parfois. Oui j'en rêve parfois...
Des vieux à qui on vendrait son âme, ne serait-ce que pour leur donner raison, leur offrir bonheur aussi - puissent mes gestes être à l'honneur de leurs vies et de leurs rêves, à ces anciens du pays. Mémoires de la Vallée, quand le vieux se met à pleurer, pour nous Montselgues c'était un refuge, qu'il sort avec peine. Que pourrions-nous dire d'autre ? Il n'est pas de parole plus précieuse. La vérité est là. La burle, l'Eissero, la Frette, c'est de la décoration. Certes elle va très bien pour écrire des textes agités d'un romantisme brut à la De Chateaubriand, mais ce n'est autre qu'un décor de théâtre. Il est de ces livres qu'on déteste, on a envie de les arrêter avant la fin, puis au gré de quatre relectures, quelquefois pire - mais rarement - ils se révèlent d'un brusque indispensable : les vieux bouquins tous fripés dont on ressent une légère honte en les prêtant, et pourtant. Le livre d'une vie, arriver ici, vouloir refermer la page, puis relire.
Lorsque j'ai été au bassin tout à l'heure, je n'ai ressenti aucune émotion. Cette maçonnerie granitique reçoit les eaux de la rivière de Thines, déviée dans un petit captage de 800 mètres de long : la béalière qu'on dit. Durant 113 jours, je me suis lavé dedans. Pour les plus mauvais moments, il a fallu casser la glace, ou, ce fut plus désagréable et compliqué, se laver sous la pluie à la première heure du matin. Désormais que j'ai des conditions moins dures, j'ai regardé l'eau - comme ça, simplement - me posant la question si je ressentais la moindre nostalgie, du soulagement, voire de la rancune peut-être. Mais non, rien en réalité.
Avant-hier, une salamandre était sur le rebord du bassin, me regardant d'un œil torve et froid. Tous ses têtards dans le bassin, qui ont compliqué ma vie durant des semaines, étaient en train de s'ébaudir. Ah, c'est toi qui a imposé toute cette pornographie à mes petits, me dit-elle !
Ici dans la Cévenne, on se fout de tout : des actualités surtout, des politiques par dessus tout, du travail, de la pression humaine (embouteillage, voire même politesse, ou non, disons plutôt des règles de bonne convenance). Mais on ne se fout pas de la météo ni des voisins. Tina disait : si tu veux bosser ici, il y a franchement moyen, et si tu préfères ne rien faire, c'est honnêtement possible aussi. En tout état de cause, il s'avère qu'on se moque de beaucoup de choses et au départ c'est déstabilisant. Cela explique que pour de nombreux sujets, qui au demeurant peuvent pourtant apparaitre comme important, on ne ressente rien. Mais rien. Par contre c'est vrai qu'on parle beaucoup du temps qu'il fait. Je crois qu'à force de solitude, d'isolement et de vastes domaines naturels vides de tout humain, on devient un peu des ovnis. On s'étonne soi-même : on se cherche devant les eaux du bassin. Alors, seule une phrase banale arrive à émerger des eaux claires et pures : ce qui doit être est.
Quand on descend chez les voisins, inévitablement on parle du passé, du temps où c'était vivant ici. C'était avant. Avant la déprise. On partage un café. Ca nous fait du bien, on vit comme ça, au fil de rien de spécial, puis la discussion dérive sur les voisins d'en face.
René, c'était un homme fort, allez, comment te dire, si je devais t'en donner une description, un orang-outan. Grand, oh le gaillard devait bien faire deux mètres, puis large d'épaules, comme ça (il mime du gigantesque). En plus il était gros. Un fameux bonhomme.
Avec un appétit ! Tu sais que le matin, parfois ça pouvait être un poulet rôti entier ! Et sinon, deux steaks et les frites, grasses à souhait bien sûr, on se comprend ! Nous étions voisins à Salindres, à la maison de mes parents. J'étais encore jeune. Si je ne m'abuse, il est de 34, Gilbert de 35. Je crois qu'ils sont partis ici, à Tastevins, lorsque j'avais 20 ans.
Nous étions en train de monter la charpente de la maison. Une des poutres
était terriblement lourde. On la manoeuvrait à l'échelle,
mais à trois, on n'y arrivait pas. Voyant René au loin, on l'appelle
: hé, René, tu pourrais nous aider à monter la poutre ?
Viens prendre un café, puis on fait ça.
- Oui bien sûr, je finis et j'arrive.
Les trois constructeurs s'en vont prendre un petit café bien agréable,
puis René arrive et prend le sien. On devise des cultures, ça
pousse vite en ce moment.
- Bon, et bien, il va quand même falloir s'y mettre, à la monter
cette fichue poutre.
Arrivant sur le chantier, la poutre était là-haut. Il n'avait rien dit et avait fait le travail durant la préparation du café. Tout seul sur une échelle complètement pourrie, il avait besogné. On n'arrivait pas à le croire.
Tu vois à l'époque, lorsqu'on faisait les blés, on remplissait
directement les sacs à la machine à enlever la balle. C'était
un peu dur car ça allait vite. Du coup, dès fois on ajustait a
posteriori ; des sacs trop pleins, on déversait dans de nouveaux sacs.
Et là, voilà soudainement un sac de 120 kilos, à charger
pour aller à la grange. A trois, on le dépose sur le dos du René,
sans prévenir.
Il se marre.
Ah les salauds qu'il fait, ah les bâtards !!
Le Bézigue, quand tu l'écoutes, tu auras toujours l'impression qu'il a travaillé toute sa vie, d'un labeur étouffant. Té, je peux te dire qu'il n'en foutait pas une, et que son frère René, c'était quelqu'un qui connaissait le travail. Il y a bien longtemps, en fin de journée, René débarque à la maison : hé, j'ai un peu froid, as-tu une veste ? Sans plus réfléchir, la veste passe de main en main. C'est le lendemain qu'on avait compris, il avait labouré toute la nuit.
Une fois comme ça, il était fou de rage. Quatre tonnes de melons étaient prêtes à la récolte. Ils étaient à quatre pour la besogne. C'était une de ces journées du mois d'août, avant l'orage, chaude, collante, moite. D'un sursaut, Le Bézigue dit : hé, moi je ne récolte pas en cette chaleur. Puis sans autre forme de procès, il part à la pêche. Le René était fou. Il lui a foutu une de ces avoinées à son retour ; c'était seulement le lendemain d'ailleurs ! Ils ont récolté toute la journée, jusqu'à minuit. Le lendemain à quatre heures du matin, il partait à Cavaillon pour vendre.
C'est un gars qui n'est jamais parti de sa terre. Si en réalité, il est parti une fois, le service militaire, mais, c'était bien tout. Un gars discret, solitaire, bien sur sa terre. D'une érudition, c'était spectaculaire. Ce mec là, il avait tout lu, il était impressionnant.
Le Bézigue, dès qu'il s'agissait de partir à la pêche ou à la chasse, alors là je peux te garantir que c'était un métier hein ! Sur un chantier, s'il manquait une vis, je peux te promettre qu'il allait la chercher immédiatement aux Vans, et il n'attendait pas de savoir s'il en fallait six. Une fois sur un chantier, il voit un lièvre passer. Il lâche tout et il est parti traquer durant quatre heures. Les gens de la famille, ça les rendait fous !
Par contre pour manger, ça il savait ce qu'il voulait, et il le faisait savoir : hé peuchère, la truite tu ne sais pas la cuire ! Dans sa vie quotidienne, il s'adressait aux gens avec aridité. Quand il parlait des femmes, les pintades qu'il disait.
Plus tard dans l'après-midi, lorsqu'en tant qu'invité, moi conteur de ce texte, j'évoque qu'en ce moment, il faut rouler doucement à hauteur de Peyre, on m'écoute avec attention. Ce genre d'information locale ne manque pas de nous intéresser. En effet, cela fait quelques semaines que des perdrix écervelées courent sur la route. Comme d'année en année, les genêts montent, les perdrix se retrouvent désormais aux plateaux. Dans la discussion fuse : oui c'est vrai, il faut faire attention aux pintades.
Ce n'était pas fait exprès. Bien évidemment tout le monde se marre !
Inévitablement nous parlons des béalières, dont cet éternel projet de remettre en route le béal traversant chez les filles. La dernière fois qu'il a été fait, c'était avec Maurice Clavel, donc ça fait 96. Oui ça doit faire ça. Si tu n'es pas là pour entretenir régulièrement, ça n'est pas la peine. La nuit les sangliers étaient venus et avaient tout éventré. Ca n'avait tenu que quelques jours. Au petit matin, les filles viennent gueuler : hé, l'eau se déverse chez nous ! Il fallait bien réparer, sans trainer.
C'est comme ça que survient une énième anecdote de béalière, un ami maçon venait travailler chez Bernard, lequel lui dit : quand tu pars avec ton fourgon, remets bien l'électrique.
Le lendemain matin, le potager est retourné, les sangliers étaient
passés dans la nuit.
- Hé, tu n'as pas remis l'électrique, vois comment tout est dévasté
!
- Mais si j'ai remis l'électrique, vois, c'est encore là !
- Mais enfin !
Après enquête, on trouve les traces et les coulées. Les marcassins étaient passés sous l'électrique, en rampant dans la béalière. Les adultes étaient restés à l'extérieur. Ah les filous, ah les gourmands !
Hé, je peux te dire, j'ai testé hein. J'ai mis une pomme 30 centimètres à l'intérieur de la clôture, et une à 30 centimètres à l'extérieur, puis j'ai surveillé à la jumelle. Celle de dehors a été prise, mais pas celle de dedans. Ils approchent le groin à 5 centimètres et ils sentent bien tout ça, tu sais c'est fin comme animal.
Un jour on était en chasse vers Peyre, mais plus du côté
de l'Echelette. Je ne sais pas si tu vois là, à gauche il y a
un très fameux ravin. Ho, on était comme ça, un samedi
matin, et il y avait un jeune, il n'avait pas d'expérience. On l'a posté
en vigie.
On rabat.
Puis j'entends un coup de feu.
Je l'ai eu, que le jeune s'exclame !
Oh la bête, elle devait bien faire dans ses 120 kilos. Pendant quatre
heures, on place les sangles, à cinq on tire dans la pente, comme des
fous, c'était éreintant. On arrive aux trois quarts, et voilà
que la sangle principale nous échappe. L'animal roule dans la pente,
et badabam, badabam.
Oh meeerde !
Purée, on avait commencé la chasse à 6 heures sur place, passé 20 heures, la bête était en haut, 20 heures je te dis !
Hé tu sais c'est quoi l'expérience ? Quand la bête passe dans un ravin comme ça, tu tournes la tête sur la droite hein.
Oh je n'ai rien vu !
Nathalie et José, bien que plus rarement au pays, ne manquent pas de rencontrer nos petites histoires astucieuses et pleines de malice. De leur discrétion, ils prennent la parole.
Nous étions au restaurant à Montselgues, un peu à gauche en bas, quand tu reviens de la piste du plateau. Chez la Francine. L'établissement était tenu par son mari, c'était là où se trouvait un insigne de tabac.
Un petit vieux rentre, avec un panier en osier bourré de légumes,
dont surtout des poireaux. Il les offre au patron, lequel répond : hé
je te dois combien ?
- Passe-moi trois paquets de tabac.
Pas des cigarettes, en fait du tabac à rouler. Il avait fait son troc,
il était content.
Nathalie et José s'adressent à lui : nous voudrions bien des légumes, pouvons-nous en acheter aussi ?
Oh, qu'il fait, en levant la main... Je ne peux pas. Je les ai pris dans le jardin de ma sœur, surtout ne lui dites pas !
Il partit comme il vint, espiègle, du haut de ses bons quatre vingt ans !
Remonter les pentes vers La Boissière, c'est toujours une nouvelle solitude.
Quelquefois, je vois cette existence comme celle d'une bouteille à la mer, qui se nourrit parfaitement seule dans son instant de dérive, et qui attend d'être découverte.
Ces textes à la noix, ceux qui ont mémoire ainsi que ceux qui parcourent savent que c'est aussi long que A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, autant à rebondissements pourris que Les feux de l'amour, voire même une flopée de comparaisons à superlatifs ; sauf que là, ce n'est pas drôle ou presque, enfin je ne sais plus à vrai dire. Synopsis du film tragico-comique version l'épisode-précédent : on fait acquisition d'une ferme en Ardèche-Sud au hameau de Thines, en collectif, projet qu'on traine depuis juillet 2019. Survient l'âpre bagarre administrative, puis voilà, le temps passe un peu, ça s'arrange enfin, la notaire fixe une date de signature, nous en presque-euphorie on va dire, et là PAAAF ! La maladie débarque. Tout est foutu par terre dans le cadre d'un délai non précisé : terra incognita aux relents de solitude des terres sans végétation des Kerguelen, un phénomène un peu nouveau pour nos contrées, la société est par terre. Au gré d'autres épreuves inutiles de conter ici, j'ai été jusqu'à proposer de bon cœur la renonciation (le sentiment, le feu, n'étant pas totalement éteint, même si ça s'arrange). Je n'ai plus osé rien écrire ou presque, trop malmené probablement, jusqu'à ce que nouvelle date soit proposée. Chose faite. 26 mai, si aucun grain de sable ne s'intercale dans les rouages. Pour l'instant ça se passe bien.
(Je suis gêné, pas à la hauteur, toujours ce vague sentiment de discrétion, de pudeur, de décrire un boxon indescriptible inutile pour autrui) ; c'est au-delà de ce ressenti un foutoir inextricable, mélangé (presque indicible) à un soutien inconditionnel d'une paire d'amis, c'est la vie, ce sont des onces de bonheur, ça mérite d'être partagé avec des mains ouvertes. Si on traverse ces épreuves, on traversera tout, c'est ce qu'on se dit en somme. Si nous, surpassons, alors nous pourrons aider autrui. Simple ? Oui, cela donne une forme de motivation. Témoigner combien on a pu en chier pour des sornettes juridico-adminsitrativo-notariales. La société gorgée d'ubuesque administratif ogresque n'est pas morte. Elle est prise de nausées, de vomissements mêlés de sang, mais elle rêve de recommencer comme avant. Tant qu'elle sera ainsi, ça persistera en diarrhée administrative ; même eux, acteurs de cela, s'y perdent et n'en veulent plus, c'est éventuellement bon signe après tout. Cette société honnie se voit rongée de l'intérieur, telle une termitière prête à s'écraser au sol.
Les saisons passant, le bancal est donc que je suis présent à la ferme depuis le 31 octobre, tout seul dans l'immédiat (le collectif rejoindra), sans domicile administratif, sans statut précis, comme ça, simplement là, grâce à un propriétaire-vendeur accommodant sur cet aspect. Je vis principalement dans Raymonde, ma belle roulotte, mais désormais je bénéficie d'une maison pour le travail. C'est un espace d'aide certain, ce qui octroie aussi une certaine forme de régularisation de la situation aux yeux de la société, enfin "leur" société. Cette présence, maladroite et inconfortable, a permis de développer le potager, sur plus ou moins 320 mètres carrés actuellement, et un nouveau verger de 45 arbres.
Chaque jour m'aide à rejoindre - approcher - les trois buts de ma vie : autonomie alimentaire, régénérer la nature, aider. Je soupçonnais devoir les adapter au fil du temps, mais non, ça prend bien tout ce qui fait battre le cœur. C'est une bonne définition du mot aimer. La nature, autrui, c'est si simple, sans un mot plus haut que l'autre.
Les bilans sont à chaque fois positifs, bien qu'à géométrie variable et quelquefois malmenés (disons que l'aide reçue parfois-souvent ne fait pas de mal).
Le potager est avancé et offre ses premiers résultats. Il est en certaines périodes miné par le campagnol des champs, alors si jamais dans les parages existe un médiateur parlant campagnol, pouvant leur proposer d'aller au Canada (la parcelle d'à côté), je veux bien. J'ai tenté bon nombre de méthodes d'éradication sauf la chimique (polluante, dévastatrice), et la litière pour chat usagée (je n'en dispose pas, Bouboule est libre). Si quelqu'un peut m'en envoyer cinq kilos par la poste, très très souillée si possible, je veux bien. Euh, en vrai ne le faites pas hein, je sais très bien ce dont vous êtes capables !!! Pour ceux et ceusses concernés, la destruction systématique des galeries provoque un ralentissement de l'infestation, mais il faut être au taquet.
Les récoltes sauvages sont abondantes. Les travaux de confection d'infusions en phytothérapie sont encourageantes. Au vu du danger inhérent à la pratique, largement relatée par Michel Pierre, je reste précautionneux et ne touche pas à ce qui possède de l'effet secondaire ou contre-indication à foison. Quant à la pratique de l'herboristerie, il m'est actuellement interdit de la vendre en France (pratique illégale de la médecine), mais pas de l'échanger ou de la faire partir dans un proche-étranger. Que cela soit dit : échanger ou donner, ça "leur" pose un grand problème. "Ils" ont même songé à taxer l'échange, tout en renonçant immédiatement tant c'était ubuesque. "Leur" poser des problèmes est un but, il faut que cela cesse : quelque part c'est un acte de résistance politique. Soit passons, ici n'est pas une terre de ce genre de discours, même si ce n'est foncièrement pas antagoniste.
Régénérer, c'est ce qui a été le moins entamé, pour cause je me trouve encore et toujours dans certaines spirales de survie douce ; on ne parlera pas malgré tout de survie-tout-court, c'est essentiellement le moral le problème, directement régi par le poids de la solitude, c'est très dur tout seul. La signature de l'acte devrait permettre un premier apaisement à ce sujet. Les premières nécessités sont de placer des nichoirs à insectes à foison. Ils sont trop menacés de par le monde, ici la nature est farouche et intouchée.
Quant à aider, à peu près 20% de mon temps y est consacré. C'est assez peu prévisible en général mais ça fait toujours sens.
Ce qui change aussi, c'est le rapport que l'on a au temps et à autrui.
Par rapport à la vie d'avant, l'existence d'ici permet la lenteur, la
gentillesse, l'action désintéressée, mais surtout la décélération
massive. Plus rien n'est cadencé voire même balisé d'horaires.
Certes les journées de travail sont très longues, mais en toute
vérité, le réveil-matin est l'oiseau. Le repère
temporel c'est le soleil. Si on n'a pas fini, alors demain il fera jour, pas
de chef furieux et injuste, même si pour autant, on aime par dessus-tout
le travail soigné et bien achevé.
Ce rapport au temps change la perception animale et végétale.
Je suis devenu très sensible au langage des animaux, leurs discours territoriaux,
les bagarres, les techniques de drague quelquefois bien foireuses. Le rythme
aussi, les allers et venues des grives mélodieuses dans les forêts,
comme des ondes immenses, sur des kilomètres de résonnances dans
les ravins solitaires, le chant martial et fougueux du rossignol ratatatatatatatatata,
qui se cache dans les aubépines. Je me mets à parler aux têtards
de salamandres dans le bassin, ils ont des plumeaux qui font comme des antennes
sur la tête ; parler aux plantes aussi n'a rien d'anormal. Tout ça
j'en parlais déjà, je radote come un petit vieux, mais honnêtement,
c'est prédominant.
La vie dans son petit quotidien banal, rural par dessus tout, est extrêmement
monotone. Planter-Cultiver-Récolter ou bien Promener-Récolter.
Guère d'alternative. Jour après jour, au gré des ratatatata
dans les fourrés, ou d'une pluie qui surprend au détour d'un chemin.
Monotone, oui, mais volontairement se mettre en surproduction. Pour donner.
Parce que c'est de l'amour d'autrui de donner. Puis monotone est tellement beau.
Se poser le cul sur un caillou et écouter le chant répétitif
du pinson : tututututu-toi-du-bien (en langage oiseau, fais-toi du bien, qu'il
veut dire) ; se foutre à poil et piquer une tête dans la rivière,
oh elle est encore froide !
La gestion du stress coronavirus a été assez particulière
ici. Six semaines ont passé sans faire la moindre course, aucune ombre
d'un flic, liberté totale dans les landes des bruyères et des
genets désormais tous jaunes, à l'infini sur le plateau de Montselgues
; certains envoyaient des sms depuis les villes : alors comment ça va
dans le petit paradis ? En fait, le tintamarre n'est pas arrivé jusqu'ici,
cette campagne reculée, âpre et austère, a gardé
sa résilience. Au moindre bruit de voiture, je pensais plonger dans les
genets, comme en temps de guerre, puis en fin de compte ce n'est pas arrivé.
Pas de voiture pour d'immenses temps de solitude totale. Pas un mal, pas un
bien. Gérer une ferme tout seul, c'est extrêmement dur, c'est ce
que je pourrais seulement en dire (nous achetons en collectif mais actuellement
je suis seul sur place, un choix, j'assume, enfin non, j'essaie, parlons plutôt
de ce type de vérité). Ce qui a changé, ce sont les pensées
pour les personnes enfermées en ville, tous ces pauvres gens qui ont
dû subir la claustration. Ca a dû être dur, le vide, la promiscuité,
le manque de perspective, le manque de date surtout, durant une longue période
d'inconnu inquiétant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un avant et
un après. Un après mêlé d'incertitudes [nous en parlions
dans notre collectif : l'incertitude, c'est ce qui va probablement le plus marquer
notre avenir commun, l'instabilité, l'adaptation]. Il va falloir de la
bienveillance par pelletées.
S'il est à comparer la vie rurale actuelle avec la vie d'avant, il n'y
a guère de photo à tirer. La vie en roulotte est extraordinaire.
Cette ambiance de bois, de simplicité, de légèreté
: la pluie qui crépite sur le zinc de la toiture, l'écureuil qui
bastonne son reflet sur la vitre, au loin le cri du chevreuil au Garidel. La
vie réduite à sa grande simplicité. Contre appartement
magnifique à Louvain-La-Neuve - urbaine utopique -, un bonheur sobre
sans remord. Et sans surprise, la vie rurale est le chantre d'une myriade de
difficultés. Aride, l'immense solitude avant tout, (juste pour l'aspect
comique, une personne âgée du coin me déclarait, passablement
éméchée : je me tire, je me barre de là, allez merde
bordel, trouver une meuf ici c'est la mort. Sic !), cela additionné à
l'absence d'accès pour ainsi dire complet à la culture. Les livres,
ça reste possible, et c'est bien. Le manque absolu de voyage aussi. Je
ne peux pas abandonner mes terres, ou tout du moins je ne le peux qu'au creux
de l'hiver. Mais pas de larme à l'oeil pensant à cela. Il suffit
d'écouter, tôt le matin, la fenêtre ouverte de Raymonde ma
roulotte, le chant des grives, et le bonheur jaillit. Le rougequeue est systématiquement
le premier en ce moment et son tout premier chant du matin est toujours foiré.
Si si c'est vrai (le manque de café de micro-chenille torréfiée
probablement). Comme si c'était un peu rauque, un peu éraillé,
c'est dur à décrire, il faut le vivre, l'entendre. Soit, en rétrospective,
aucun regret ; de nombreuses nostalgies par contre : une douce mélancolie
qui se nourrit de belles images du passé, de belles images du présent
tout autant. L'avenir on n'en sait rien, quelque part ce serait non loin de
s'en foutre. C'est bien maintenant, voilà.
Désormais je lis parfois des romans Harlequin, ce qui permet de décrire sans fard l'ampleur de la gravité de la situation !
Toutes ces plantes dans les mains, c'est un savoir que dorénavant je dois transmettre - à qui dans le besoin - c'est un dû, à la vie, à autrui. Nous sommes tellement chamboulés par le bordel administratif, nous-collectif, nous ne savons même plus définir comment nous allons accueillir ; [il se peut probablement que nous devions avant tout guérir de nos blessures, nous ne sommes pas indemnes] ; ressort malgré tout de chaque instant de nos paroles que l'accueil est inconditionnel, parce que la vie c'est comme ça, et au terme de toute cette âpreté, la vie sera une chance, alors il faudra la partager ; peut-être que la guérison, ce sera vous.
J'avais 6 ans probablement, il faut dire que revenant sur cet âge là, le flou est forcément indéniable, je rêvais déjà d'une vie comme ça : à défaut de ferme et l'âge voulant, c'était un château. Mais, honnêtement je le dis, un château de toute modestie, ni grand ni grandiloquent, mais surtout fort. En ce lieu de toute quiétude, j'accueillais des enfants dans le besoin, loin (déjà !) de toute pression parentale. Si jeune de la sorte, j'aurais dû rêver de balles rebondissantes et de mains collantes (les jouets à la mode de cette époque) or reclus dans les forêts solitaires, régulièrement et pour ainsi dire quotidiennement, j'étais déjà ailleurs.
Toute ma vie de travail salarié et de voyage forcené a été une réussite, en contrepartie c'était un écartement de l'âme de l'enfant. Chaque retour d'école, à pieds, était un test ; je me plaçais devant des défis, apercevoir les bécasses, quelquefois les perdrix bartavelle (il y en a plein ici, qui courent comme des dératées sur le routes), puis construire en imagination des structures dédiées à protéger l'humain, dont je n'étais pas maître - je ne suis pas un maître ; nous partagions. Six ans. Est-ce normal ? Déjà j'étais en proie au doute. Déjà le luttais contre le mal des hommes (j'ai été persécuté à l'école), recherchant avant tout le bien, quitte à ne pas y arriver, ce n'est pas grave, même pas le bien à vrai dire, c'est présomptueux, seule la bonté suffit. Peut-être aujourd'hui n'est qu'un signe d'un retour aux sources ; ça va loin, j'admets, et que cette date signera la permission de retrouver une âme d'enfant. Il n'est rien demandé d'autre. WE ARE IN UK. Jamais ça n'a semblé si loin, jamais ça n'a été si proche. Désormais je m'incline devant le Seigneur et pour la première fois, je rêve que cela se fasse - comme avant de s'endormir, comme après le bonne nuit de maman - car la ferme sera le refuge, ce dont le vieux de Montselgues, à quatre doigts, parlait. Gilbert Faure. Rien de plus précieux. Parce qu'un refuge, ça se partage.
On sait quand les journées commencent, il est pour ainsi dire impossible de dire quand elles se terminent ; le plus souvent, on arrête par la cause de l'épuisement, des journées de soixante heures seraient amplement faisables. Comment ça ? Ca n'existe pas ? Oh, oui en fait ! Cette nuit a éclaté un orage terrible et ce n'est plus désormais qu'au gré d'une journée de pluies diluviennes que j'écris. Le potager est couché sous les vents et les trombes d'eau, une nouvelle ravine s'est creusée dans les chicorées. Toujours pas pu descendre chez les voisins pour voir quelle pagaille est semée. Danielle vient d'expliquer que la transhumance est reportée, si ce n'est pas ce soir, ce sera demain. Sous la pluie dense, horizontale, du sud, balayée par les vents, les Toi-Du-Bien ne disent plus rien. Ca change, oh ça pour sûr !
Ce sont les pinsons, il y en a plein ici. Toute la journée et inlassablement, ils disent Tzizizizi-Tzézézé Tchéchéché-Toi-Du-Bien ?!! Avec les points d'exclamation comme ça dans leur déclamation. Bon évidemment comme c'est un peu laborieux à décrire, je les appelle simplement les Toi-Du-Bien. C'est un langage propre à ici, inventé, néologisme pratique. Aux Vans, ils disent juste Dzù-bièn. C'est peut-être parce que c'est un brin plus provençal, marqué dès lors par un patois méridional occitan plutôt que cévenol. Mais soit, je m'égare.
Ici, on est très sensible au langage des animaux. Inévitablement, les aboiements rauques des chevreuils sur les pentes de l'Everest de Thines, j'en ai certainement déjà parlé, mais aussi les cris inquiétants des sangliers le soir. On dirait des bagarres parfois. C'est leur vie, c'est ainsi et cela mérite le respect.
Le plus étonnant est d'entendre les vagues des oiseaux, qui comme par
flux et reflux, ondulent et se remplacent : en février les ondes lointaines
des grives dans les contrebas du Roussel. Par la suite, elles disparaissent
(pour quel mystère ?) et sont remplacées en avril par les chants
du rossignol. Ce dernier, Ratatatatatatata, est particulièrement actif
la nuit lorsqu'il s'agit de trouver une épouse (déplorant par
là même d'avoir placé ma Raymonde sous son "chez-lui",
un noyer comment dire quelque peu tapageur !, et désormais me payer les
noix sur les bacs en zinc de la toiture, booonk, ça fait sourire). Plus
tard encore, le ballet incessant du rouge-queue : Tou-di-Li-Li-Li ? cRRR cRRRR,
P'tit Louis !, bavardage qui de sa décharge électrique centrale
s'appelle évidemment le Petit Louis. Puis après en mai le bordel
désordonné des bébé-mésanges, ça piaille,
ça casse les pinouches aux parents, c'est que la santé est bonne.
Voilà. C'est tout. A présent les Toi-Du-Bien.
Si j'évoque autant ces histoires d'animaux, c'est parce que désormais
il y a cela. Il n'y a plus que ça, pour ainsi dire.
Cela fait quinze jours que je suis propriétaire. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot encore, insistant à outrance peut-être. Qu'est-ce qui a changé depuis ? De manière factuelle, le panneau propriété privée a été arraché. C'est bien là tout. Il méritera somme toute d'être emballé dans un paquet cadeau (ce sera un emballage de farine, je n'ai rien d'autre), puis d'être offert, par dérision, à mes cohabitants. De l'exaltation ? Surtout de l'apaisement d'avoir une vie normale. Je n'y vois, actuellement rien d'autre, ça et le chant des oiseaux.
Un sentiment encombrant aussi, celui d'avoir posé les valises. Moi qui n'ait jamais appartenu à un lieu, c'est très dur à gérer (cette éternelle tendance à rechigner à acheter, car c'est sacrifier tous les ailleurs possibles) : être désormais d'une terre. Cévenol. Par adoption. Lozérien aussi. Disons qu'ici c'est un peu la même chose. Oh ça faisait un sacré paquet d'années que j'en rêvais. Peut-on parler de ces instants depuis le causse Méjean en 2015 ? Oui éventuellement. Mais ce serait mentir sur la première incursion en 1993, j'étais môme. Un amour fou pour ces terres. Oscillant entre réussite et échec, aucun de ces deux termes n'apporte satisfaction, c'est à la fois une élection, un enracinement, un deuil. Peut-être le deuil de l'île de Ré, de l'arrière-pays Rétais dans le même ordre d'idée, puis tellement d'autres lieux à droite à gauche, des saisissants, des inconvénients aussi. Peu importe. Cela ne donnera que plus de valeur aux instants d'y retourner, il n'est formulé aucune interdiction.
Alors la valise posée, à côté de soi, on regarde les terres. Il y a du travail. Comme une responsabilité : exister en ces terres désormais. Le titre même de Dana Hilliot, son livre, ces mots : vivre ici. C'est curieux. Il n'existe plus aucune excuse (administrative, financière, etc), permettant de partir. La vie est ici. Belle d'ailleurs. Bercée du chant des oiseaux. Le mec perché sur le faîte du toit le dit très bien, et il ne s'en lasse pas : Toi-Du-Bien ! En mars, je le voyais sous le pommier formant mangeoire, grappillant les graines au sol (le pinson préfère trafiquer ses petites histoires au sol), dodelinant de la tête, et bredouillant des petites phrases sans sens. C'est au contact des adultes qu'il apprend à parler.
Hier soir, il avait prévenu, de son cri lancinant, quasiment douloureux : Dzui. Dzui. Dzui. Il dit ça avant la pluie, d'ailleurs sous forme de prémisse je nomme ça simplement : J'appelle la pluie ! Et ça n'a pas loupé. Ce matin ce sont des trombes diluviennes. Pourquoi dit-il cela ? Je ne le sais pas. On confondrait aisément avec l'accenteur mouchet, qui dit Tui, Tui, Tui. Mais, son cri est plus lent et surtout, légèrement vibrant. Dans le même ordre d'idée, le babil des fauvettes est incroyable. Il doit y avoir 5 à 7 notes par seconde !
La vie ici, c'est rien. Alors, il ne faut pas s'étonner que je parle d'animaux et de rien. A vivre ici, tu as doucement intérêt d'aimer les animaux, ils sont omniprésents, le mauvais temps, le vent et le Rien. Il n'y a rien. La nature. Stable. Farouche. Intouchée. Et un homme tout seul au milieu.
Poser la valise au cœur de tout ça n'est pas une angoisse, pas un regret, pas une espérance. Mon regard est très critique quant au passé, très critique quant au futur. Le présent est beau. L'absence d'exaltation permet de ne pas tomber de haut, de ne pas se noyer. Ce qui est est. Ce qui est doit être.
Lorsque je considère le passé, à Louvain-La-Neuve, ville étudiante, dynamique, culturelle, entraînante, belle, confortable, cette vie était attirante. Au tout départ, je m'étais mis à l'idée d'amitié : il faut tout recommencer chaque année, avec le bal des rotations, les étudiants changeant de lieux. Mais ce n'était autre qu'une illusion. Je n'ai jamais aussi facilement lié contact que là-bas, je ne l'ai jamais aussi aisément perdu. Le lendemain, tu étais oublié. Non pas que ça soit systématique, c'était à vrai dire culturellement le symptôme d'une certaine légèreté, la superficialité comme mode de vie. Et comme je me suis toujours refusé à picoler, je n'ai jamais été eux. Il y a toujours eu une distance. Ca a formé de la solitude. Au tout départ, je pensais en sortir cycliquement, mais ce n'était qu'un mirage. Louv' était merveilleuse, mais une solitude revêche, qui plus est pour moi qui affectionne la fidélité - peut-être est-ce ça de devenir vieux.
Ici, c'est différent. C'est même totalement différent. Ce qui fait du bien, c'est l'absence de jugement. Auparavant, on me considérait tout le temps (et je dis bien tout le temps) comme l'homme des bois. Combien ai-je entendu parler de Koh-Lanta - j'ai une vision extrêmement floue de ce qu'est cette daube - lorsqu'il s'agissait de faire un bivouac sympa en lisière des bois. Oh quelle horreur, il y a des serpents. Oh moi ça me ferait peur. Ah, tu imagines, si y'a un tueur qui débarque en pleine nuit ?
Un tueur, dans le fin-fond du causse Méjean ?! Autant rechercher un serpent rouge bariolé de bleu ! Cette distanciation à provoqué que je n'étais jamais eux. Non pas question de picole cette fois-ci, mais simplement que dans les discussions concernant The Voice ou bien les dernières conneries des mômes à l'athénée, j'étais largué.
Ici, personne ne te jugera si tu essaies de fabriquer ton vinaigre. Personne ne sera péremptoire devant ta production de farine de tilleul. Au contraire. Ca va intriguer. Quelque peu, on te demanderait comment tu fais, tu les verrais essayer aussi. Modestement. On est tous assez discrets ici. On sait que la nature est plus forte. Nous ne sommes - aucun de nous - des hommes des bois. Encore dépendants de technologies, qui peut se targuer d'en être indépendant ? Je crois que simplement, ce qui joue (et démystifie) notre ruralité, c'est que nous parcourons nécessairement beaucoup plus de distances pour obtenir un service. Il y a une désaffection totale du service public. Je n'entends personne s'en plaindre. On est loin, on assume. Le reste, on nous fout la paix, c'est bien là ce qu'on recherche. Puis on est tout seul. A l'avoir cherché un peu, tout de même.
On est isolés. Notre isolement est énorme. Ca provoque un sentiment de solitude. Je ressens une solitude décuplée. Alors, entre la solitude de Louvain-La-Neuve, seul au milieu des autres, et la solitude d'ici, au milieu des bois, je crois avoir choisi. C'est moins douloureux. Mais, inévitablement, ça provoque des glissements affectifs. On se trouve être plus sensible au destin des animaux [j'ai vidé le bassin d'un mètre cube pour extirper une armada de lombrics en train de se noyer, j'en tire régulièrement fourmis et chrysopes ; juste à temps, c'est ce qui compte, mais pour ce qui flotte c'est plus facile]. Je leur parle beaucoup. Puis, je me parle à moi-même, sans arrêt : hé couillon, tu imagines un instant que ça va fonctionner avec un bout de bois comme ça ?!
Cette absence de mépris quant à se démerder avec ce que l'on a provoque un moins vaste décalage. Pauvre. Pauvre je suis, mais pauvres peut-être devrais-je dire. Je crois que nous sommes. Peu importe, grand bien en fasse quasiment, c'est une rusticité salvatrice : trop d'omniprésence technologique étouffe. Si la sentimentalité est un flot débordant, comme la flotte dehors en ce moment, c'est que la vie est bien là. L'absence d'exaltation permet l'avancée solide, lente, très lente. Il n'est rien besoin d'autre.
Alors, je parle de moins en moins. Presque gêné de bavarder ici, autant de rien et pour rien. Parce qu'ici, le rien est entier. Que faudrait-il dire d'autre aujourd'hui que la rivière est grosse ? Que voulez-vous, c'est après tout ce dont on se satisfait. A des kilomètres des préoccupations urbaines, à des années-lumière des temples de la superficialité : Happn, Tinder : la moindre discussion débutant par un slt ou au mieux, un cc sa va, puis s'éteignant logiquement : on ne possède que si peu à cultiver en commun : ce n'est ni un mépris ni un jugement, c'est quasiment une déception ; ne pas être à la hauteur n'est pas le bon mot, il s'agit avant tout de ne pas être au bon endroit. Ca ne revêt que si peu d'importance. Ca ne dérange personne.
Les pluies redoublent d'intensité. On doit approcher les 200 millimètres en 24 heures désormais. Les vents sont à 120 km/heure. Le potager est anéanti. Ecrasé, brisé, enseveli. Bouboule est sur le lit, à l'abri de la tourmente. Elle me regarde inquiète, car "je n'ai pas le droit". Aujourd'hui je n'ai rien vu !
Plus que jamais, il se pose la question de comment vivre ici, je n'en ai toujours pas trouvé de réponse. C'est peut-être qu'il n'y en a pas, et que par dessus tout, il faut s'en foutre. A vrai dire, je n'en sais plus rien. A y réfléchir, auprès d'une infusion fumante de bruyère blanche, je ne vois qu'une case vide. Me reviennent seulement des paroles, d'un temps lointain : il est triste de jouer à cache-cache dans ce monde où l'on devrait se serrer les uns contre les autres. C'est Jean Cocteau qui écrivait cela.
Ne jamais oublier. Si l'autre bougre rappelle sans cesse que Toi-Du-Bien, ce n'est pas pour rien. Il dit, à sa manière : fais-toi du bien, c'est en tout cas comme ça que dans une version anthropisée, je l'interprète. Aujourd'hui, le regard sur le potager, je ne sais plus. Mais ça n'éteint pas la véracité de ses dires. Ca ne permet pas de nier cette parole simple, enfantine, qui n'est autre que le babil d'un pinson sur sa branche.
Une noble existence ressemble aux écrans de contrôle des camions sibériens : tous les voyants d'alerte sont au rouge mais la machine taille sa route.
Cette citation de Sylvain Tesson (légèrement adaptée car tronquée) pourrait sans détour aucun détailler l'ambiance de cette curieuse période. Ainsi sans ambiguïté, cette phrase explique ce qu'il se passe en ce moment et le manque de nouvelles inhérent - cela perdurera sans nul doute jusqu'en septembre. C'est chargé, c'est sinueux, c'est empli de vacillation.
L'acte de vente de la ferme ne marquait pas une victoire, c'était nettement plus un passage : une porte enfin ouverte vers un ailleurs. Après autant d'acharnement administratif, est-il injuste de décliner l'acte victorieux, la réussite, le podium ? Lucide. Oh certainement clairvoyant avant tout, ce n'était autre qu'un laissez-passer. Désormais, nous y sommes. Marqués par la joie, marqués par la peur.
A peine l'acte de vente passé, le potager a connu sa troisième destruction presque-totale depuis début mars. Tout d'abord le ravage absolu mené par les campagnols suite au dépaillage, ensuite un épisode orageux particulièrement radical en juin entrainant des phénomènes d'érosion écrasants, puis dans la foulée, la destruction des pousses par les noyers (lesquels produisent de la juglone, un herbicide). Cela a provoqué un énorme choc alimentaire, financier, organisationnel, moral. Si tout cela est désormais plus ou moins du passé, (c'est arrangé), les semis refaits, ces épreuves amènent à revêtir une profonde humilité. Devant la nature, nous devons nous incliner.
En plein cœur de cette accumulation d'épreuves, le captage a désamorcé. Ce genre de catastrophe arrive tous les quinze ans d'après le voisinage expérimenté en la matière. Plus d'eau en suffisance, le verger et les pousses potagères se sont trouvées en stress hydrique intense. Solitaire, isolé, fragile, j'ai craqué et me suis effondré. Jean a réparé l'ouvrage durant un jour et demi. Les dégâts étaient tels que je me forgeais tel qu'incapable de réparer ; comme anéanti, je ne trouvais plus force de résister à la violence. L'inquiétude est très loin d'être éteinte.
Ce sont nos solidarités. Sans la gentillesse ineffable de Jo et Bernard, Camille et Jean, je ne serais qu'un nain de jardin, immobile et triste, perdu sans expérience dans une jungle trop dense : la bamba que nous disons ici quand c'est la nature désordonnée, luxuriante, belle, authentique, rude, déchaînée, parfois voire souvent.
En toute clairvoyance, je ne sais plus ce qui me fait tenir ici.
Puis, peut-être est-ce un signe du destin, des nouvelles du monde arrivent ici. " Leur " monde. Mon regard se pose sur Petite Araignée Opiniâtre. Prendre le temps. Durant la nuit, à deux heures du matin, un lucane cerf-volant m'a débarqué en pleine tronche, paniqué, dans un bruit tonitruant. La fenêtre de Raymonde était ouverte. La vie à La Boissière, en somme, c'est cela. Loin des bruits alentours, sauf les avions militaires de Salon-de-Provence, la base 701, on leur tirerait bien dessus - soyons raisonnables, ce n'est pas permis, on attendra qu'ils n'aient plus d'essence, les choses se précisent.
Les bruits de " Leur " monde se fraient un passage assourdi ici. Il me revient ce matin même que Le Prince est encore plus abject. Comment cela est-il possible, l'imagination ne permet pas de se déposer dans ces confins ? Au gré d'un parcours traversant une frontière, j'ai perdu la sécurité sociale. La boulimie des réglementations rend la vie impossible. " Leur " monde est un inépuisable relent de vomi. Ici, ça n'arrive pas, ou à peine, c'est déjà trop.
Peut-être faut-il dire que je suis paysan-herboriste. Comme un mot en avait été frôlé il y a quelques mois, je suis paysan : vivant de la terre (ou en tout cas le désirant). Loin de l'archaïsme que l'idée véhicule, loin de toute imagerie écolo-bobo, avant tout je suis un simple. Je vis du simple. Des plantes. Celles alentours. Les plantes sont nourriture, aromatique, médecine, teinture, décoration. Elles sont même, pour le plaisir ultime, futile : collection. Faire une collection de menthe pour la beauté du geste, une collection de crassulacées pour l'esthétisme.
Imaginez un instant que je n'ai pas le droit d'écrire la vertu des plantes (il n'est pas écrit que je n'" aie " pas le droit, c'est la vérité). En plus, les plantes ont souvent de multiples vertus. En écrire une seule, même sur de la camomille matricaire, me fait hériter d'un procès. Vous imaginez, une telle érosion des savoirs ? Que j'enseigne est un crime.
Ici à Thines, en pleine transition, je me suis interrogé sur ma vie scolaire (et pourtant en lycée agricole) : revenant sur cette époque, j'étais incapable de donner la moindre bribe de ce que j'ai pu apprendre en physique-chimie, en biologie mathématiques, etc. Rien. Le néant. Est-ce normal ? On me dit que j'y ai appris une logique. Que cela peut-il me faire ? Je suis démuni devant le potager, déstabilisé devant les méthodes de conservation des aliments (lacto-fermentation, stérilisation, dessiccation, etc). Qu'y ai-je appris en réalité, qui soit utile à la fabrication de la vie et des savoirs ? J'ai perdu des années de mon existence, purement et simplement, à cause d'eux. J'écris à cause comme un accusatif. Aujourd'hui face au simple, je suis complètement perdu, j'échoue, sans en perdre la détermination pour autant.
" Leur " société me donne une incommensurable haine. Ce terreau fait naître en moi Amour et Paix. Au plus je serai solidaire, au plus je serai aimant, au plus je serai convaincu d'aller à l'encontre de toutes leurs logiques civilisationnelles, à la limite capitalistique (avoir 5000 amis sur facebook, un must ; ou je ne sais combien de followers sur instagram). Je ne suis pas optimiste, je dirais même que je suis très pessimiste quant à l'avenir de la société : la crise du confinement a démontré les comportements sociétaux, Pablo Servigne encense des paroles belles, mais c'est trop gentil, trop gentil tout ça. Cela sera proche des évocations de Vincent Mignerot. Alors, avant que tout cela n'éclate, aimer, et faire perdurer si possible, cultiver. Aimer le voisinage, soutenir, une solidarité foldingue, tout comme eux ne cessent de m'aider. Avant de crever, quelle que soit la date (et on s'en fout) : aimer, pour repousser la société individualiste.
Pas de télévision, pas de radio, pas de journal, pas d'infos sur internet, couper court aux discussions d'actualité politique (d'ailleurs, le rejet populaire de tout ça devient exponentiel). S'il y a bien une chose qui les tuera, c'est de les ignorer et de les affamer. Vivre sans argent marche. Mes minuscules expérimentations en ce sens en sont la preuve (et je n'en suis ni le seul ni le chantre). Ce ne sont pas des démarches généralisées, cela reste pour l'instant largement insuffisant ; une méthode voire un crédo : au plus j'y arrive, au plus je les rejette. S'il y a bien une chose qui me fait tenir ici, malgré les insondables épreuves, c'est ça. [Haïr ce qu'ils ont fabriqué, eux avec une intelligence remarquable, les nier jusque dans l'essence même de leur existence] - ne t'inquiète pas que, lorsque tout craquera (c'est en train de craquer), ce seront toujours les mêmes qui trinqueront, les plus pauvres ; ces saloperies de politiques seront loin et protégés. Ils sont le démon.
Lorsque je descends vaguement-régulièrement à New-York,
2300 habitants, Les Vans, j'y vais en coup de vent. De plus en plus rarement.
Sans goût. C'est déjà la ville. On dit Les Vanss comme on
dit Clanss pour Clans. En pays occitan on dit toutes les lettres. Parfois -
souvent même - j'entends les vents. Il s'agit d'un touriste peu au fait.
Est-il matière à juger ? Oh non certainement pas, ce d'autant
plus que bordélique à souhait, foisonnant, on dit Aubena ou Priva,
niant les S. Il est de notre devoir par contre, nous locataire de la terre
-humanité séculaire-, de dire les choses comme le pays l'a fabriqué.
Parce que, au-delà de tout particularisme, c'est une manière de
s'enraciner. Non pas que j'appartienne à cette terre, ce n'est et ne
sera jamais le cas. Comme le dit Francine, à Montselgues et née
à Lyon, je ne serai pas enterrée là, ils ne m'ont jamais
considérée comme étant des leurs, toujours une étrangère.
S'enraciner est peut-être le dernier geste dédié à
parer la folie des hommes : être là, aimer le simple, cultiver
le simple, partager le simple, faire vivre le pays de son essence vitale.
Que les politiques s'adaptent ou qu'ils crèvent. En attendant, plus la moindre considération ne leur est donnée. Ne plus voter en est le geste ultime. Aux abois, ils feront tout pour réglementer, pour confisquer, pour punir. Le championnat du monde de la restriction est en route. Rien n'est inéluctable. J'ai perdu la confiance en l'être humain. Pourtant ces derniers jours de forte souffrance face à un captage dévasté ont démontré que c'est faux, amplement faux.
Alors, je regarde face à moi l'Everest de Thines. Un xylocope violet fait un bruit terrible de bombardier (quel bel être vivant), Sauterelle-Mortelle agite ses antennes sur la table, les Toi-du-Bien font trembler la branche tant ils chantent fort. Une mini-fourmi chatouille le bras. La souffler plutôt que de la tuer. Plus que jamais je ne sais plus comment vivre, devant mon potager modeste et bancale. Faut-il arrêter, engager une autre voie ? Il n'est de réponse. Si ce n'est que les maîtres du chaos, les Princes de partout nocifs universellement-répandus, seront toujours les cibles. Nos proches, les voisins en ce moment seront aimés, sont aimés d'ailleurs. Je voulais remercier pour tant d'aide reçue, alors que je m'écroulais. Il me fut répondu : tu sais un jour on va vieillir. A peine métaphore, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Tous les voyants au rouge - que pourrait-on dire d'autre si ce n'est d'accepter avec lucidité ?, ça taille sa route. Pourtant et encore. C'est peut-être un mode de vie. En ce 19 juin, le captage avait de la sorte éclaté, rompu sous les racines d'un arbre effondré. La rosace entière et immense a dévalé la pente. En quatre mois de temps [mars-avril-mai-juin], cette situation était l'amorçage du quatrième apocalypse du potager, à savoir la destruction totale des cultures - cette fois-ci le verger y compris. Plus d'eau, plus de solution de secours - trop fragile, trop vite, je n'avais pas encore monté la ligne de secours. Déjà en situation de très grande précarité alimentaire, je me retrouvais à la porte : sortie d'urgence. atteler. partir. définitivement.
Il y a un an, pour ainsi dire jour pour jour, c'était le 15 août, j'arrivais ici la première fois, au gré d'une semaine pour évaluer le secteur. Thines, sous une pluie dense, lancinante, glaciale, interminable. Effondré d'épuisement, trempé, alors que je galérais comme un chacal de Roumanie, Jean mon futur presque-voisin, m'accueillait près du feu. Nous venions de nous connaître, entre les pruniers, à récolter ensemble dans une simplicité pure pleine de bienveillance. Sans lui, je tournais les pas, éructant toutes sortes d'insanités à l'encontre de ce lieu " trop dur ".
Devant mon captage éventré et impossible à réparer tout seul et "trop seul", je me suis effondré dans un torrent de larmes. L'accumulation d'épreuves a fait craquer. Il est normal (il est sain) de se taper des merdes. Dans une vie comme ça, c'est le lot quotidien. Mais, sans détour, pas des apocalypses à répétition. Malnutrition, épuisement de tout-seul, de dur, de mélancolie profondément entaillée dans les os.
Crevassé, j'ai été chez Jean, dans un état de détresse alarmant. Camille m'a donné à manger, m'a accueilli toute la semaine tant j'étais -foncièrement- loin. Le soir même, Jean m'a dit de prendre la lampe. En pleine nuit, au parcours d'un épuisement par taillades, j'ai suivi. Il a évalué les travaux. En deux jours et demi, le captage a été réparé. Il n'a pas lésiné sur la main d'œuvre, les jambes plongées dans la rivière en colère. Le potager, en stress hydrique intense, a pris cher mais n'a pas été anéanti.
Sans l'aide de ce voisin, c'en était probablement terminé. Au gré d'histoires un peu longues, disons en toute simplicité que c'est la troisième fois qu'il détourne mon regard de la fuite, partir d'ici, et qu'il porte mes pas quand je tombe.
Depuis lors, quatorze personnes sont venues à La Boissière. Ces gens ont généreusement donné de leur personne pour combler des lacunes, effacer des faiblesses, colmater des failles. Alors que la solitude m'ancrait dans un rythme lent, avec un geste soudain c'est le plus essentiel des disfonctionnements qui se voit jeté au fond d'un puits.
Qu'était-ce le projet sans leur aide (que ces personnes en soient conscientes ou non) ? C'est grâce à elles que la vie continue ici.
Dans le monde du travail salarié, la méritocratie est de faire des heures, dans le privé de faire du pognon, dans le public de ne pas se faire remarquer, d'être régulier, obéissant et de suivre la doxa (qu'elle soit absurde ou pas). Dans mon coin de campagne, la méritocratie est d'en chier. Les gens du hameau me trouvent méritant d'avoir pu développer un début d'autonomie dans un contexte en somme vachement perturbé, quelque part fortement handicapé. En regard sur ce récent passé, je ne sais pas ce que je mérite. Je crois seulement avoir reçu beaucoup d'aide.
J'ai voulu remercier pour le captage et je n'ai quasiment pas pu. J'ai voulu remercier pour l'aide apportée lors du second apocalypse et je n'ai pas pu (du tout). Il me fut dit, sous forme d'ellipse et de sous-entendu : tu sais un jour on va vieillir. A mots pudiques, cela disait simplement ces paroles, nous aurons besoin d'aide. C'est en fin de compte tellement vrai.
Ce n'est pas tombé dans l'œil d'un sourd. Enfin, on se comprend.
Selon les principes de Benvenuto Cellini, il faut être âgé de quarante ans au moins et avoir accompli quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir coucher sur le papier l'histoire de sa vie.
Autant dire que c'est s'assoir dessus que de conter le banal quasi-insipide d'ici. La générosité se fait aussi rare que la verdure dans l'océan de béton des villes. Considérons ces actes comme de l'exceptionnel ? Si loin de tout désormais, qui suis-je pour en arguer ? Peut-être que oui pourtant.
La Boissière plonge dans une manière de vivre à la fois apaisante et emplie de tensions. Etre ici a provoqué (pour moi) un nihilisme profond. Je me fous éperdument de tout, incapable de citer une bribe d'actualité, des banales notions de cinéma, voire même une quelconque discussion féconde sur plus-ou-moins n'importe quoi. Il me revient un truc stupide en tête, sur Rance Inter vers midi (le moment où le trajet vers chez mes parents commence à devenir long), les gens qui crient Banco Banco Banco, dans le jeu des mille francs. C'est tellement stupide, maladroit, mauvais, enfin... rance en quelque sorte. La ferme est à des années lumière de tout ça.
Ici, comme le dit Albane, on vit profondément en symbiose avec la nature. Cette nature foisonnante et débordante entre dans les maisons, qu'on le veuille ou pas. Les araignées dans les wc, les gendarmes dans les fentes des murs irréguliers, les coccinelles dans les armoires, le nid de guêpes au-dessus de l'entrée, les fondatrices frelons qui fricotent dans la sous-pente, les fourmis à fuite véloce dans la roulotte, etc. car j'en passe ; mais aussi l'eau de la pluie dans les lauzes de toiture, le chaud le froid au fil des saisons, là aussi inévitablement j'élude l'intarissable liste pseudo-biblique de tout ce qui établit logis sans vergogne. Ca peut s'avérer parfois surprenant au moment de la douche !
A La Boissière, l'on en vient à se foutre de tout, sauf des animaux, des plantes et du temps.
L'on vient à se foutre des e-mails, de ces textes ici (il faudrait peu pour que cela mène à débrancher la prise), de ce qui se passe là-bas dans les villes, de la politique, de toute forme de philosophie anthropique, des trucs et des machins et des bidules et des bazar-choses. Pour peu, pour très peu, l'on en vient à se foutre de la mort, de la vie, peu en importe tant que (je) respecte la nature, gêné d'être humain, gêné de peser malgré tout. Peser le moins possible comme un mantra. Je ne parle pas de collapsologie heureuse, je n'y crois pas, ce sera et c'est chaos, le covid a montré que les gens ne sont pas prêts. La voie choisie, humainement soutenable, est de vivre une communion heureuse avec la nature. C'est un souhait. C'est à ce titre un désir blessé, ou disons ampoulé, quand mon tuyau de captage en plastique méga-industriel de 800 mètres se voit ravagé. C'est à dire, sans autre forme de procès, qu'il s'agit de faire un peu ce que je peux.
Toutefois, hormis ces considérations pointilleuses, mes consommations ont toutes diminué. Ce qui s'avérait compliqué était le déplacement ; je suis désormais satisfait de retrouver Marguerite, ma voiture, pleine de toiles d'araignées après presque deux mois sans mouvement !
Et sans débrancher la prise, si je devais parler de ce qui m'importe, (je fais ? vraiment ? je fais, d'accord : go home, ma vie) : sous le chant des guêpiers, bril-bril-bril qu'ils disent, ils égrainent des notes fluettes, en vol dans le ciel pur, je donne des noms à tout. Régis le gerris flotte avec impertinence sur la Thines agitée de vaguelettes limpides. Question stupide (j'ai le droit à une par jour) : comment dorment les gerris, dans les flots mouvants de la rivière ? Atmosphère surchargée de chaleur, à la piscine, immergé dans l'eau incroyablement limpide, un recoin de rivière à deux mètres de profondeur, je leur parle. Ils s'approchent, curieux, Régis en tête. Dans le même temps, des mini-poissons viennent voir la main immergée : ainsi la légende était vraie, se disent-ils. Les humains existent ; oh qu'ils sont bizarres et idiots ! Vite, filons dans les flots !
Les fourmis à grosse tête ont fameusement creusé dans un tronc de merisier. J'ai remarqué que les gendarmes, par milliers ici, ont des caractères différents. Je leur présente un brin de paille. Certains s'enfuient à toutes six-pattes. D'autres, épris de curiosité, analysent longuement la paille : mais qu'est-ce ? D'autres encore, colériques, bagarrent le brin de leurs petites pattes impétueuses. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie, mais comment fut-il possible de mépriser tout cela des années durant ? Au titre d'un pardon un peu facile, peut-être était un peu pas fait exprès. C'est la société qui veut ça. A vrai dire, j'avoue, je n'en sais rien, mais je peux affirmer qu'il n'y a plus que cela qui m'importe : les insectes, le ciel ce soir et peut-être encore demain, comment conserver des courgettes, quand semer de la rhubarbe ? Le reste... Un regard sur le nid de guêpes maçonnes dans ma roulotte. Est-ce que ça dérange ? En réalité non. Souffler une fourmi qui chatouille le bras plutôt que de l'écraser.
C'est naïf.
Laissez-moi vivre ma culpabilité d'être humain. Outre mesure, je
ne demande plus rien d'autre. Même plus envie d'en parler, rassasié
de silence, entouré des nuées de téléphores. Ils
sont un peu bêtas ; ils hésitent un temps avant de décoller
maladroitement dans un bruissement d'ailes foireux. Ils sont attachants, des
brindilles volantes. Plus rien d'autre que cet isolement, ce n'est pas ce genre
de discussion qui va aider à former des relations sociales. Est-ce un
cheminement devenu sans concession ?
Sans concession j'admets désormais. Devant un e-mail appartenant aux nuées du passé, je ne regrette rien, je ne juge rien, je n'en veux à personne, mais. Il s'avère que, "mais", je ne sais plus quoi dire. Ca parle un langage non animal. Les gens doivent m'en vouloir. Handicap peut-être. Au gré d'un court trajet vers Aubenas pour déposer deux personnes à la gare des bus, je me retrouve à pester comme un putois dans un même-pas-sens-interdit. C'est la ville, et pourtant une petite ville. Leur béton, leur vie, leur mort insidieusement banale est devenue une existence étrangère. Nuisible, stressante, non désirable. A force, je ne sais plus. Mais je comprends ma solitude, quand bien même pesante en certains jours : je ne l'ai pas volée celle-là ! Pour me rassasier du manque, je me dis avec simplicité que c'est pour les autres, c'est curieux la vie-heureuse-à-deux ; peu de personnes voudrait exister en portant l'intégralité de ma radicalité en cette existence naturelle (les travaux durs, le froid en hiver, l'immense banal de la vie quotidienne (cultiver, récolter, conserver), l'absence de culturel, l'absence de nouvelles du monde, l'absence de loisirs, l'absence des gens la plupart du temps : solitude effrénée), j'imagine aussi tout ce que les gens plongés dans un monde urbain peuvent envier de mon existence. Se couper les cheveux tout seul, je ris ! Une demi-mesure est de partager un peu. Comment ? Je n'en sais plus rien. Ce n'est plus grave. Un pas a été franchi. Un pas de stabilité. Quatorze personnes ont œuvré et cela se voit, quoi qu'on en dise.
Le cheminement n'a rien d'exceptionnel, et loin de former un quelconque podium de pacotille permettant une biographie, quand bien même minime. Ecrire ici comme ailleurs n'a pas plus de sens que de se promener quelque part un jour de beau temps en automne, un jour de couleurs chatoyantes. Est-ce pessimiste ? Est-ce ne plus rien attendre de la vie ? Comme cela ne peut plus rien toucher désormais. Ce qui est bien est bien. C'est un présentéisme acharné. Un pacifisme forcené. Bien dans la peau, une eau trouble de mélancolie maladroite épurée par un oxygène quotidien, à vrai dire bien dans la nature, pas bien (du tout) avec la société ; et qu'est-ce que ça peut foutre ? Elle est loin. Très loin en somme. Un machaon est entré dans la roulotte, ivre de tours et détours ondulants, ça c'est beaucoup plus important. Cela n'efface en rien la peine de certains jours. D'un geste lent, écarter la pesanteur. Ca n'a presque pas de poids. Des nouvelles du monde où j'étais (avant, salarié) me sont parvenues. C'est exactement pareil. Ils n'ont pas dévié, peut-être même sont-ils encore pire. Ils ne se nourriront pas de ma souffrance : le plus abject des rejets et de considérer qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus. C'est Aurore le téléphore qui le dit. C'est la libellule à ailes rapides qui le redit. Il est bon de les écouter. Ils ont bien plus raison que la folie des hommes.
Il serait maladroit de dire que rien n'a changé. Qui plus est, jamais doubler le matériel important (irrigation, clôture, cave) n'effacera la fragilité humaine. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois qu'autant d'espoir - même ténu - est permis.
Au gré d'un mois d'août qui s'étire avec indolence - un petit tour au gour du Fournier pour nager dans la rivière, calmant toute forte chaleur en quelques instants - les récoltes s'accumulent à un rythme effréné. Après les disettes de l'hiver, cela rime avec du bonheur et des sentiments rassurants. Les journées passent invariablement à une vitesse folle. Cultiver récolter cuisiner. Il ne s'y trouve rien d'autre et autant dire que ça remplit l'esprit d'une sérénité curieuse, peut-être parce que nouvelle.
A chaque tournée quotidienne, c'est la même rengaine. Je prends une bassine, puis repars non pas bredouille, mais plutôt du fait qu'il en faut trois, quatre voire même cinq. Je suis littéralement émerveillé de la générosité de la terre (tout comme je le fus de celle de mes voisins) : c'est un regard d'enfant, porté sur le potager et les forêts, une immense gratitude - être reconnaissant. Oui bien sûr, c'est l'enfance de cette ferme. Dans quelques années, je serai peut-être blasé comme un adulte devenu triste ; c'est tellement normal de récolter au vu des efforts disséminés. Tout ce que je puis demander est de ne jamais perdre ce regard enfantin, simple et bienveillant, de remercier la terre et les arbres. Le monde du travail avait fait de moi une sorte de banale monstruosité, insensible et d'ailleurs quelque peu implacable. Aujourd'hui comme hier comme demain, mes mains épluchent inlassablement, perpétuellement conscient du don de vie que cela représente : ce n'est pas un labeur mais un bonheur.
A chaque fois le même émerveillement, troisième fournée de conserves de la journée, le téléphone n'est plus rempli que de photos de nourriture ! C'est si banal et pourtant le témoignage d'une admiration simple. Lorsque je pense au monde de dehors, cela me fait penser à la couverture de King Crimson : 21th century schizoid man. A cet instant précis de l'écriture, un pic noir lance son cri mélancolique ; hier soir encore, les chouettes hulotte bavardaient bruyamment dans les arbres. Que disaient-elles ? Je l'ignore, mais ça devait être important.
En moins d'un an, j'ai déjà gagné cinquante pour cent
d'autonomie alimentaire. L'année prochaine sous toute probabilité,
j'en serai aux trois quarts, bénéficiant de savoir-faire, sélectionnant
mes graines, améliorant le potager et le verger. La nature me permet
de quitter le monde, rejoindre un semblant d'autarcie, ne plus descendre à
New-York qu'épisodiquement, tous les deux mois. Le monde d'en bas me
parait désormais complètement cinglé. Lorsque j'allume
la radio, je me marre et fais des pronostics sur le temps que je vais tenir,
en somme, rarement plus de quelques dizaines de secondes. La nature offre un
apaisement curieux. Je deviens inintéressant, lent et pétri de
gestes répétitifs, quoique sûrs. Mon corps devient mousse,
lichen, humus, feuille. Tout m'indiffère, apaisé, éloigné,
et pourtant satisfait de cette terre dans laquelle désormais je plonge
mes racines. Lors de discussions banales, je ne sais plus quoi dire de banal,
puis tout d'un coup mon regard s'illumine, on parle des fourmis ou des genettes.
Lorsque je cueille les haricots, des montagnes à vrai dire, je suis entouré
d'une nuée de xylocopes violets qui bourdonnent bruyamment et maladroitement.
Le matin dans les fleurs de courges, j'ai l'impression qu'une ruche s'est effondrée
là-dedans, ce n'est pourtant qu'une ruée vers le nectar.
Les photos ne comptent même pas ce que j'offre à tour de bras à
mon voisinage : ce que les vieux m'enseignent, cet amour qu'ils me donnent,
cet amour que je veux leur rendre : ne pas s'étonner que le symbole de
La Boissière s'imprègne des oubliés du dimanche : prendre
soin des vieux a un sens immense ici : ils sont tellement oubliés ; nous
avons un langage brut, les vieux c'est rude de dire ça, pourtant c'est
rempli d'une affection débordante.
Ce que je préfère à La Boissière, c'est lorsque je débute l'arrosage dans le potager. Tous les grillons sautent, s'écartent de la douche en m'insultant de tous les noms. Ils disent Burlupupu ! Oui c'est un peu curieux ! Ca fait comme des petites ondes sautillantes, panique !
Ce que je détesterais le plus à La Boissière, ce serait un souper en tête à tête avec Pascal Obispo. A en dire toute la vérité, je crois que je préfèrerais encore lire l'intégrale de Danielle Steel ou Barbara Cartland. C'est dire !
Le soir souvent, je nage dans un épuisement physique important, mais qu'importe, j'ai gratitude d'avoir pu quitter mon emploi salarié. Je descends la rue, la sente étroite et pentue d'un mètre cinquante de large. Camille me lance : nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps ! Tout au plus quatre jours. On est très soudés. Au gré de repas conviviaux, nous partageons nos vies. Soudainement Jean m'évoque de vieux souvenirs qui lui sont chers.
A l'époque, nous n'avions qu'un seul âne, me dit-il. Lionel ne voulait faire aucune dépense superflue avec son animal (il voulait ne pas peser sur le budget familial) ; les clôtures étaient faites de bric et de broc. Au bout d'un temps, nous avions remarqué que l'âne déprimait, du fait d'être seul. Nous lui avons cherché un compagnon.
En cette période, un vétérinaire nous disait : je peux
vous offrir un bouc, je dois le piquer mais je n'en ai vraiment pas le souhait.
Ainsi donc arrivait le bouc au sein de notre habitat groupé.
- Et il lui faut quelque chose de particulier ?
- Ah... oui. Sa pâture était près d'un restaurant. Je dois
vous prévenir qu'un couple de personnes âgées lui donnait
des frites tous les mercredi midi.
- Des frites ?!
- Des frites !!
- Ah ça avec nous, il n'aura pas de frites !
Le bouc arriva sur place, sans autre forme de procès. Au bout de quelques jours, nous le remarquons épuisé, en train d'haleter. L'âne était tellement content, il n'arrêtait pas de le poursuivre. Nous lui avons donc construit une cabane. Cependant l'âne donnait de tels coups de tête, la cabane était renversée. Nous avons fixé l'édifice avec des fers à béton. Le bouc aime être en hauteur. Il grimpait sur le toit de la cabane et toisait l'âne.
Il faut savoir que l'herbe est toujours plus verte derrière. De la sorte et d'ailleurs où que ce soit, l'âne va chercher l'herbe au-delà de l'enclos. La clôture commençait à être fâcheusement abaissée. Le bouc, toujours dehors car il sautait, se plaçait sur la voie du tram. Un moment, les agents de la STIB (la compagnie des tramways à Bruxelles) mettaient en garde : il va falloir mettre ça en ordre monsieur ! Le bourgmestre lui-même dut piler en voiture. Nous avons reçu une sacrée lettre ! Ce fut mis en ordre rapidement.
Désormais nous avons trois ânes.
Un jour je reçois un appel, les trois sont dans les rues de Louvain-La-Neuve.
Je prends les longes et immédiatement la voiture. Je tombe sur un combi
de police, avec un gyrophare. De l'autre côté de la rue, la même
chose. Au plus on courait après les ânes, au plus ça les
amusait !
Une fois la situation revenue à la normale vient le temps des excuses
auprès de la police.
- Oh mais nous, ça nous a bien amusés ! Ca nous change !
Nous les transportons une fois par an avec un van jusqu'à Tastevins. Une fois c'est arrivé sur l'autoroute, tout le monde qui dépassait rigolait, nous avions bien compris. Les ânes ne sont pas longés dans l'habitacle. Ils s'étaient tous trois retournés dans la remorque, regardant les gens dans les voitures et dodelinant de la tête.
Après ses récits, Jean a les yeux qui se ferment, lui aussi épuisé. Puis dans un regain d'énergie, ses mains mécaniques épluchent des pommes. Sans le moindre mot désormais, il prépare la compote pour demain matin, genre de petit rituel important. Camille esquisse un sourire : la compote des Verstraeten ! C'est toute une histoire.
Comme en cette époque où Bernard possédait des canards, c'étaient des coureurs. A Salindres, s'il n'y avait aucune limace, autant dire que ce n'était pas triste avec les escargots. La fratrie de canards le suivait, plusieurs centaines de mètres durant, bien consciente de l'avenir proche, un régal d'escargots. Après le repas, le jabot gonflé à bloc, ils en auraient pour ainsi dire les yeux emplis de gratitude.
Au regard de ces historiettes, l'absurdité du monde d'en bas devient insipide et étrangère. Une personne me disait récemment que d'aller à son New-York à elle (Langeac, 3700 habitants), devenait une activité de plus en plus désagréable, dissemblable en ce que l'on aime. Devenons-nous si fous ou si spéciaux, devenons-nous si anormaux ou est-ce le monde qui devient déraillé ? Répondre serait un jugement. Se contenter de fuir sans bruit est le moindre des respects. Toutefois, des gens commencent à partir, preuve peut-être qu'il est temps, très grand temps, de s'occuper de nos vieux et de nos enfants.
Sagesse de pacotille, sans nul doute. A considérer la lente transformation,
inéluctable à force d'y prendre goût, il vaut mieux quelque
part ne plus en parler (mais sera-ce seulement possible ?) ; le seul devoir
qui me restera sera d'enseigner, à mon tour, tout ce que les vieux m'ont
transmis. Hormis d'être à leurs côtés, dans les beaux
jours comme les pires, ce sera le meilleur que la vie pourra donner.