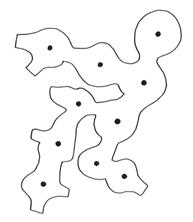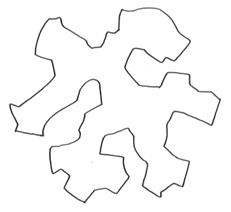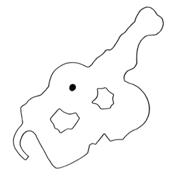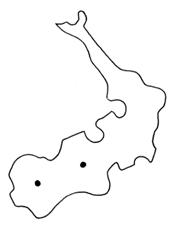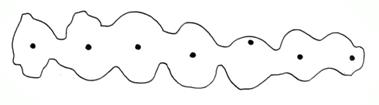Une synthèse historique et généalogique sur les souterrains du secteur de Lille
VINCENT TCHORSKI - CYRILLE
GLORIEUS - 2016
NICOLAS
DUDOT - PIERRE
MUGUET - NICOLAS
DUSEIGNE
Cet ouvrage est dédié à Bernard Bivert, initiateur de l’amour porté aux catiches et innovateur dans ce domaine.
Cet ouvrage est dédié à Étienne Kuffel, artiste du SDICS puis du SEISM, par lequel tant de recherches ont été faites. A tous les topographes et chercheurs, lesquels ont mené un travail opiniâtre, souvent artistes de l’ombre : Tison, Lefebvre, Rutki, Dupont, Vion, Bryla, Triadou, Vernez, Grzelczyk, Mattelin, Skowron, Lécutier, Héraut et tous les autres moins connus.
A toutes les Zoé Dumoulin, d’hier et de demain.
Toutes les topographies ont été établies par le SDICS de Douai.
Tous les documents d’archives possédant un aspect grisé proviennent des Archives Départementales du Nord, sauf quelques archives grisées provenant des Archives Départementales du Pas-de-Calais, dès lors ceci est précisé.
Tous
les documents d’archives possédant un aspect jauni proviennent des
précieuses recherches généalogiques de Laurent Balloy.
Nos remerciements vont :
Au
Centre de Recherches Historique Lezennois, lequel a publié un précieux ouvrage
sur Lezennes, et qui fait vivre la passion des catiches depuis des années.
A
la mairie de Lezennes et Monsieur le Maire Marc Godefroy.
Au
Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Lezennes.
A
la mairie d’Hellemmes et Monsieur le Maire Frédéric Marchand.
A
la mairie de Lesquin et Monsieur le Maire Dany Wattebled.
A
la mairie de Faches et Monsieur le Maire Nicolas Lebas. Au service urbanisme et
plus particulièrement Madame Anne-Laure Degans.
A
la mairie de Ronchin et Monsieur le Maire Patrick Geenens. Au service urbanisme
et plus particulièrement Madame Aurore Martin.
A
la mairie de Wattignies et à Madame Séverine Van Grimberghe.
A
la mairie de Seclin et Monsieur le Maire Bernard Debreu.
A
la mairie de Loos et Madame le Maire Anne Voituriez.
A
Madame Annie Gouy.
A
Manu Dusséaux et Michel Dubois pour leurs conseils.
A
Laurent Balloy, dont les investigations généalogiques de grande envergure ont
permis de fonder les recherches sur les barbeux et les champignonnistes
lezennois.
SOMMAIRE
Lezennes,
le chant des sirènes.
Lezennes-Hellemmes,
la chambre de Monsieur Puy.
Lezennes,
des héros discrets.
Hellemmes,
l’école Bonne-Nuit.
Annappes,
que reste-t-il de toi ?
Ronchin,
le Seigneur des Anneaux.
Lesquin,
hôtel-catiches.
Faches,
la fascinante.
Seclin,
un bout du monde.
Vendeville,
retour aux sources.
Templemars,
l’inaccessible.
Wattignies,
l’arbrisseau.
Loos,
la carrière farouche.
Lille,
les dernières catiches.
Les
catiches du Mélantois, une synthèse.

Les catiches de Lezennes, à peu près tout le monde en a entendu parler. Après, il est vrai que la connaissance un peu plus précise des lieux se fait plutôt rare.
Un ouvrage évoque largement cette question : Voyage au cœur de Lezennes, émanant du Cercle de Recherches Historiques Lezennois. Ce livre fait le point sur les aspects historiques, géographiques et culturels, il est disponible à la Civette mais reste tout de même assez difficile à dénicher – bien qu’étant indispensable.
Le présent document est un complément à ce livre. Non pas que l’ouvrage soit incomplet, mais plutôt du fait que le temps passe et désormais, de nouveaux volumes généalogiques sont disponibles. Cela permet de faire avancer le domaine de la recherche sur ces souterrains. Afin de faciliter la lecture, quelques bases sont rappelées : qu’est-ce qu’une catiche, qu’est-ce qu’un barbeux, etc.
La principale caractéristique de ce document est d’avoir établi un relevé des inscriptions et monté par la suite une recherche généalogique concernant ces personnes ou ces ensembles de personnes.
Cela permet de dégager de grands traits concernant les carriers, les champignonnistes, les barbeux et les réfugiés, qui sont les quatre acteurs de ce souterrain.
Ne se voulant pas exhaustif, les carrières de Lezennes étant une immensité chaotique, nous nous limiterons aux prospections actuelles, ce pouvant aller jusqu’à la refonte complète de ce document en cas de nouvelle découverte ; ce qui d’un certain côté est une vive espérance !
Les carrières de Lezennes sont sous Lezennes, ainsi pourrait commencer bêtement ce texte. Ce serait à la fois vrai et à la fois faux. En fait comme systématiquement sur le sujet de Lezennes, cela mérite précision.
Les carrières dites « de Lezennes » sont situées sous la ville de Lezennes, sous de nombreuses terres agricoles d’Hellemmes et sous les extrémités d’Annappes ; pour ces dernières, l’urbanisme galopant de V2 a plus ou moins tout exterminé par remblaiement. Il ne reste donc plus beaucoup de vides sous Villeneuve d’Ascq et lorsque c’est le cas, ce sont des terminaisons de petits réseaux qui ne furent pas comblés à 100% pour des raisons de viabilité : soit les souterrains sont stables, soit ils minent de la terre dédiée à l’agriculture.
Lezennes, c’est 70 hectares de terrains sous-minés. C’est une grande carrière, anarchique, morcelée à cause des remblaiements, souvent basse et pénible, quelquefois dangereuse et surtout une idée par-dessus les autres, compliquée à explorer, car on s’y perd promptement ! C’est un labyrinthe inextricable. Lezennes, c’est 92% des habitations unifamiliales sous-minées en tout ou partie, avant certaines vagues de remblaiements. On est donc dans une certaine forme de démesure.
Au sujet de ces carrières, il subsiste malgré les précisions régulières un certain nombre de fantasmes indéracinables : quelquefois on parle de l’étendue fabuleuse du souterrain, rejoignant Tournai (et si c’était le cas, on serait au courant) ; mais revient bien plus souvent dans les discussions l’extraordinaire trésor de Jean Sans Terre, un magot qui serait caché sous Lezennes. Il va falloir se lever tôt afin d’aller le trouver, car les secteurs XIIème siècle sont tellement remblayés de stériles que la plupart sont inaccessibles. Soit… On dit aussi qu’il s’agit là des plus grands souterrains de France. Il n’en est rien, presque malheureusement dirions-nous, car ça nous ferait plaisir.
Une chose qui attire l’œil lorsqu’une visite est organisée dans les souterrains, c’est la myriade de graffitis aux murs. On ne parle pas de ces hideuses peintures urbaines quand on parle de graffitis à Lezennes, mais bien des inscriptions anciennes qu’ont laissées ici ou là des utilisateurs des carrières. La plupart du temps c’est gravé, mais quelques inscriptions sont peintes, d’autres tracées au fusain, plus rarement à la sanguine. Ces inscriptions nous livrent un important témoignage – très laborieux, certes – mais précieux tout de même.
Premier coup de pioche
Les carrières de Lezennes représentent un vaste ensemble de galeries souterraines. Une question reste à poser : quand ces exploitations ont-elles pu donc débuter ? La réponse est très simple, nous n’en savons rien. Il existe des hypothèses de débuts embryonnaires en certaines époques gallo-romaines, mais cela reste hypothétique. Si des travaux ont existé en ces époques, ce qui est tout à fait possible vu les découvertes archéologiques régulières, ce furent des fosses menées à ciel ouvert, dans le but de marner les champs.
De la période médiévale à proprement parler, nous ne savons presque rien non plus. C’est déjà avantageux. Dans une écrasante majorité des cas de carrières souterraines, on ne sait ‘strictement’ rien – quand bien même ce sont des sites majeurs. Concernant Hordain et Avesnes-Le-Sec, nous gardons une trace d’une activité majeure, mais il ne reste plus de témoignage à ce sujet. A Lezennes, il existe deux traces.
En juin 1462, un ouvrier carrier extrait des galeries en vue de livrer de la pierre au Palais Rihour, lequel se trouve en construction. Il s’agit d’un certain Jean Du Bois. Il est payé 115 sous le cent de parpaing. Nous savons de ce contrat qu’il est carrier à Lezennes. Vu l’ampleur du palais, gageons qu’il n’était pas le seul exploitant, mais nous n’en savons pas plus. Les noms du type de ‘Jean Du Bois’, ‘Ignas du Bois’, etc. sont fréquents. Ce n’est donc pas un riche enseignement, si ce n’est que, comme les grands centres de la pierre du Valenciennois et du Cambrésis, Lezennes est aussi active à cette période là.
Il est tout simplement possible que Jean Du Bois soit un dirigeant, mais non un carrier. En effet, il existe un homonyme près de Lezennes à cette époque là : Jean Du Bois, chevalier, seigneur d'Ennequin, dont le fils, Charles Du Bois, seigneur d'Ennequin, comte de Chaumont et vicomte de Fruges, quitta le surnom de Du Bois pour reprendre celui de Fiennes. (Leuridan, 1843).
Une autre source d’information médiévale existe, dans le cartulaire de l'hôpital Notre-Dame de Seclin. Jehan De Bassi, chaufournier demeurant à Lezennes, livre en 1463 de la chaux à Cysoing. Il pourrait s’agir, là encore, d’une personne attachée à la noblesse de Chéreng, et nommée Jehan De Bachy. Le texte reste toutefois assez clair sur la formation technique de l’individu. Ainsi, il est préférable de rester précautionneux. Les Bachi, Bachy et autres variantes, furent une famille influente de carriers lezennois.
Plus tôt que ces dates mentionnées, à savoir 1462 et 1463, on se doute bien que l’activité extractive était menée avec une certaine ferveur. Manquent les preuves, mais les « habitudes » si l’on puit dire viendraient attester un début d’activité au XIIème siècle, c'est-à-dire la période de la construction de l’église Saint-Eloi de Lezennes (laquelle est toujours existante mais reste fortement remaniée). On sait parfaitement que les bâtiments étaient bâtis le plus souvent avec des matériaux strictement locaux. De ce fait, les chantiers d’extraction ont été menés, pour sûr, pas plus loin que quelques dizaines de mètres de l’église.
Cette affirmation est fortement consolidée par le fait que les galeries qui sont situées au sud-est de l’église sont anciennes, elles en ont un aspect indéniable. Dire que l’exploitation a commencé en cet endroit, aux alentours de 1150 est quelque peu aventureux. Il n’y a rien qui puisse fonder de telles affirmations. Pour autant, ce ne sont pas des hérésies. C’est tout à faitpensable. Ces débuts seraient antérieurs aux sites les plus anciens du Valenciennois, pour lesquels les suppositions convergent plutôt vers le XIVème siècle.
Traditionnellement, il est reconnu que les travaux les plus anciens ont été menés dans le centre- ville de Lezennes, avant de progresser aux abords du rond-point de la rue Chanzy. Disons plus précisément que les galeries situées sous la rue Chanzy ont un aspect très ancien, au même titre que les galeries proches de l’ancienne mairie. Après, le creusement aurait remonté vers la rue Jean-Baptiste Defaux, vers la plaine du Hellu, puis nettement plus tardivement, vers les territoires d’Annappes et d’Hellemmes. Précisons tout de même que le Hellu n’est nullement sous-miné, on change à cet endroit de structure géologique.
Au sujet de l’église de Lezennes et des abords immédiats, le sous-sol n’est pas creusé. Cela peut paraître étonnant de prime abord étant donné que le chantier de construction de l’église se trouve là. A ce sujet, Cyrille Glorieus émet l’hypothèse suivante : « Autour et sous l'église de Lezennes, il n'y a aucune galerie. Une raison possible serait que l'église avait son ancien cimetière directement accolé à son flanc, au même titre que l’antique église de Faches. Or, dans l’esprit des carriers Lezennois, miner les sous-sols sous lesquels reposent leurs ancêtres, dans une région populaire majoritairement catholique comme de nombreux endroits proches, cela aurait représenté un crime. Creuser et tomber sur des vieux ossements comme à Paris par exemple aurait été un manque de respect considérable. »
Sur la page suivante vous trouverez un plan incomplet des carrières de Lezennes. Ce plan provient de l’assemblage de trentaines de planches, d’où le fait que les tracés soient plus ou moins irréguliers. Notez cette terrible impression de lieu inextricable !
Le centre du village est le plus gros bloc d’exploitation qui ne discontinue pas. Ensuite, en se tournant plus au sud, on se dirige peu à peu vers la rue Chanzy, le rond-point Chanzy, puis le golf. Les exploitations se poursuivent encore largement sous le golf, au-delà des limites de notre plan. Ce sont, tout comme sous Leroy-Merlin, des constellations de petites exploitations. Vu les remaniements de terrains incessants depuis les années 70-80, la très grande majorité est remblayée. Si on se tourne vers le nord, on remarquera le début des carrières d’Hellemmes, où il existe au moins le même volume d’exploitation.
Les carrières d’Hellemmes, en effet, se poursuivent encore très largement plus au nord, jusqu’à la frontière avec Lille. Nous y reviendrons dans un chapitre dédié, même s’il convient de préciser ici que les galeries d’Hellemmes sont de creusement plus récent ; pour preuve : le maillage de galeries est légèrement moins anarchique que Lezennes.

Même si l’église reste un épicentre pour les exploitations, il est tout à fait envisageable - et nos visites dans les galeries le confirment – que les carriers, à l’époque médiévale, ne se contentaient pas de prospecter uniquement à proximité de l’église, et qu’ils auraient récupéré des matériaux partout où ils en avaient besoin, dans le cadre de constructions diverses et variées. Dans cet ordre d’idée, il y aurait eu une multitude de petits chantiers médiévaux, recoupés ensuite par des galeries plus modernes. N’avez-vous eu jamais l’impression de serpenter dans une galerie ancienne, qui n’a rien à faire là, puis de revenir assez soudainement dans un réseau qu’on qualifierait de normal ? (Disons plus conforme à la norme de l’ensemble).
Nous ne serions pas étonnés qu’il n’y ait pas eu qu’« un » Lezennes médiéval, mais qu’il y aurait eu, au contraire, de petits chantiers, solidement établis ou avortés. Les brumes du passé et le manque de ressources historiques ne nous permettent pas de nous prononcer davantage sans prendre de risques. Toutefois, à l’approche de la moitié du XVè siècle, il reste assez certain que le volume de creusement est déjà bien établi. Sous quelle forme, nul texte ne le précise ; serait-ce un gros volume partagé entre les carriers ou bien, comme à Hurtières (Savoie), une myriade de chantiers tous plus ou moins anarchiques ?
Bien des fantasmagories ont existé au sujet des carrières de Lezennes. C’est normal. Les souterrains font courir l’imaginaire. Affirmer que des chantiers ont été ouverts en plusieurs lieux est en quelque sorte une projection de l’imaginaire sur des galeries qui furent visités de manière factuelle. Une question se pose de manière préalable à toute hypothèse : existait-il des constructions immédiatement adjacentes aux galeries soupçonnées comme étant très anciennes ? Cela revient à se poser une seule question, le centre-ville d’Hellemmes est-il ancien ? Nous sommes là plutôt au XVème siècle. Certes c’est un peu éloigné des chemins Bobillot et Napoléon, et une carrière fut ouverte près de l’église Saint-Denis. Il est dur de trancher, c’est ni une affirmative parfaite ni un négatif strict. Disons tout simplement que c’est possible.

Galerie
ancienne dans le centre du village.
Les catiches, l'origine
D'où provient le mot catiche ? Le mot intrigue et la question a souvent été posée, et y répondre n'est pas forcément chose évidente car il n'existe pas d'affirmation stricte et incontestable. Si l’on s’en réfère à certains écrits dans lesquels il est affirmé que le terme catiche a pour origine la tanière de la loutre, appelée justement catiche, on pourrait y trouver là l’origine du terme. A vrai dire, pourquoi pas. La seule chose que nous pouvons préciser, c'est que nous ne trouvons pas spécifiquement d'autre origine étymologique, ce serait donc une affirmation plutôt juste que de voir dans l’antre de la loutre l’origine du terme de catiche.
Mais qu'ont à voir les loutres dans cette affaire ?
La plus ancienne définition que nous ayons pu trouver des catiches provient d'un dictionnaire de 1756 (Nouveau dictionnaire universel des arts et des sciences, françois, latin et anglois, Pézenas). Le terme catiche est défini de la sorte : Trou où se cachent les loutres, quand ils font chasses.
Certains y voient une analogie entre la forme du terrier de loutre, certes véritablement appelé catiche, et la forme des puits-catiches lezennois. Nous avons beau chercher, nous ne voyons pas en quoi il peut exister une quelconque analogie, même avec de l'imagination.
Plus tard, une littérature de 1929 n'ayant rien à voir (Revue universelle puis Journal universel de la campagne) définit la catiche de loutre de la sorte : « C'est là que la loutre établit sa « catiche », dont elle rend le séjour confortable en la garnissant d'un liteau d'herbes sèches et de mousse. Ces « catiches » possèdent des issues en sous-sol, par où l'animal peut décamper à la moindre alerte en plongeant sans être vu ni entendu. »
Or, on sait très bien que les carrières souterraines lezennoises ont servi de refuge aux populations lors des périodes troublées par les conflits, les pillages et les réquisitions, à tel point qu’il n’a pas fallu attendre 1914 afin d'obtenir des caches, voire même des mouvements massifs d'habitants. On possède en effet des preuves tangibles de refuge au XVIIème siècle, et il ne fait aucun doute que la cache en refuge était déjà active dans des périodes antérieures ; les souterrains du cambrésis en sont un témoignage probant parmi d'autres.
Doit-on voir une analogie entre la catiche de la loutre et la catiche de l’homme, l'endroit où respectivement l’animal se dérobe en cas d'alerte et l'endroit où l'humain se dérobe en cas de pillage ? Comme nous l’avons vu précédemment, les époques concernées voyaient déjà un large développement des carrières, avec une multiplicité de puits plus ou moins secrets, permettant de se mouvoir à l'abri des regards, s’abriter, voire même se cacher durant une certaine période.
Cette analogie nous parait ne pas relever de la fantasmagorie, bien que l'idée soit relativement nouvelle, en tout cas au moins dans son développement explicatif.
Les catiches, aujourd'hui
Le mot catiche, aujourd’hui, définit, au-delà de la tanière de la loutre, une notion très précise. Il s'agit, en effet, des puits en bouteilles qui ont été creusés dans le sous-sol du lillois. La méthode était relativement simple. Depuis la surface, les carriers creusaient un puits quasiment cylindrique, d'une profondeur de 7 à 12 mètres, qu’ils évasaient dans la couche de ressources recherchées, ce qui donne cette forme caractéristique de bouteille. De là partait un réseau de galeries sinueuses ou de secteurs à chambres et piliers.
Une fois que ce puits n'était plus utilisé, par exemple parce que le chantier d'extraction s'éloignait, les carriers rebouchaient le puits avec un encorbellement de pierres. Nous reviendrons au sujet de ces encorbellements, car cette technique mérite un coup de lampe torche.
La catiche n'est autre que le puits. Techniquement, cela ne définit aucune autre notion. Reste que deux approximations majeures se sont inscrites dans la connaissance populaire des carrières de Lezennes.
1) Premièrement, il est fréquemment pensé que les carrières de Lezennes sont du tout-catiches. Les puits sont accolés les uns aux autres dans un immense maillage de puits jointifs.
Cette situation existe, mais pas à Lezennes ; tout simplement : pas à Lezennes ! Dans les sites d'exploitation de Lezennes, Hellemmes et Annappes (devenu Villeneuve d'Ascq), on se situe dans des chantiers d'extraction médiévaux, ou bien du médiéval tardif (Renaissance). Il n'y eut pas d'extraction effectuée durant la révolution industrielle – ou bien, s’il y en eut, comme nous le verrons, ces chantiers restaient extrêmement mineurs.
De ce fait, les carrières de Lezennes sont bâties sur un schéma de galeries sinueuses (pour les plus anciennes de toutes) ou sur un modèle de chambres et piliers. Quelquefois, on peut remarquer un système en hagues et bourrages, mais cela reste assez anecdotique, car la plupart des nombreux déchets d'extraction étaient laissés sur place en tant que remblai de pied. Si certains champignonnistes ont parfois pu réorganiser certains secteurs de remblais de pied et de déchets de taille, ce n'était pas dans les habitudes des carriers qui, confrontés à un métier très difficile, et cherchaient légitimement à s'épargner cette fatigue supplémentaire.
Les situations de tout-catiches sont postérieures à l'exploitation de Lezennes. C'est une technique qui a été mise en place lors de l'essor des carrières, au XIXème siècle par exemple. Ces techniques se rencontrent à Faches-Thumesnil, 35 carrières (territoire qui comportait de même une exploitation médiévale extrêmement ancienne, rue Kléber), à Loos, à Wattignies, à Lille-Sud, à Ronchin. Toutes ces carrières sont récentes.
Il en ressort que les visiteurs de Lezennes sont parfois déçus. Ils s'attendent à du tout-catiches, et ce n'est simplement pas le cas. Introuvable. Ici, c'est l'anarchie le maître mot.
2) Deuxièmement, le terme de catiches a fini par se généraliser afin de dénommer l'ensemble des carrières de Lezennes. C'est ainsi, en effet, que l'on parle des catiches de Lezennes, tout comme l’on parle des catiches de Loos, des catiches de Lille, dans le but de nommer toute la carrière. Cela n'a rien de bien faux, c'est un nom populaire et répandu. Mais, si nous devons être puristes, la catiche désigne le puits en forme approximative de bouteille et non l’ensemble d’une carrière.
3) Dans le même ordre d'idée, le terme de « pierre de Lezennes » a fini par nommer toute pierre extraite dans le bassin lillois, au même titre qu'on parle de pierre d'Avesnes pour toute pierre extraite en Ostrevent. Des dénominations logiques, même si elles restent inscrites dans de l'approximation. Rien qu'à Lezennes par exemple, on a de l'exploitation de sénonien, de coniacien et de turonien (avec les tuns phosphatés). Pour qui veut en savoir un peu plus, les différentiations vont avoir de l'importance. Cela se voit d'ailleurs sous terre : la pierre de Lezennes Chanzy n'a pas la même couleur que celle d'Hellemmes Pavé du Moulin.
La catiche
Revenons à nos catiches. Qu'en est-il exactement ? Tout d'abord, il revêt une certaine importance de dire que la catiche lezennoise n'est pas la catiche de Wattignies.
En tout-catiches, le puits est plus large à sa base. Afin de donner un point de comparaison bien compréhensible, disons que la catiche lezennoise possède à peu près la forme d'une bouteille de vin. Le goulot est étroit et surtout, la forme du puits est quasiment tronconique.
En tout-catiches, l'on pourrait dire que la forme est celle d'une tourille. Le goulot est très étroit. Le puits va en s'élargissant graduellement, jusqu'à obtenir une base très large. Les catiches sont rendues jointives par une courte galerie, située à la base. De cet élargissement de la base naît le fameux plan si connu et si visuel, où l'on voit comme à Faches, un maillage de ronds qui s'accolent les uns aux autres.
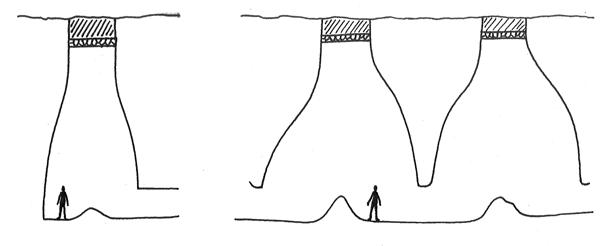
Autant un réseau médiéval comme à Lezennes qu'un réseau tout-catiches s'avèrent un labyrinthe inextricable. Il n'y a aucun repère, tout se ressemble, et la perte du visiteur arrive très rapidement.
Une fois la catiche arrivée en désuétude, elle est refermée par un encorbellement de pierres, sur le même principe que la construction d'une borie du Lubéron. Bien des approximations existent dans la littérature, affublant des réseaux « à catiches » des exploitations tout à fait conventionnelles. La catiche est quasiment exclusivement lilloise. On ne trouve pas d'exploitation de la sorte ailleurs. Un seul – précisons-le, un seul – réseau souterrain a un creusement plus ou moins analogue, il s'agit de la carrière souterraine de Doué La Fontaine, en Anjou.
L'encorbellement de pierres ne comporte aucun ciment. Les pierres sont placées en cercles concentriques, jusqu'à ce que la dernière pierre, au centre, vienne constituer une clé de voûte. Le croquis ci-dessous montre comment se referme une catiche.
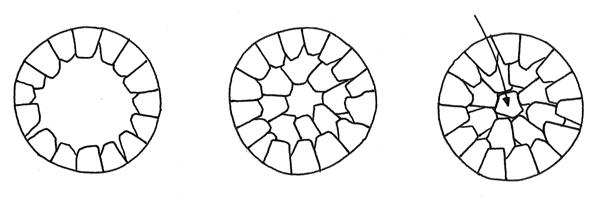
Les encorbellements ont généralement une dimension qui avoisine le mètre de diamètre. A Lezennes et à Hellemmes, il est possible de trouver des catiches nettement plus larges. Étant donné que la « bouteille de vin » est tronconique, il est possible quelquefois qu'il n'y ait pas de goulot de rétrécissement. Cela donne des catiches dont le diamètre du bouchon avoisine les trois à quatre mètres. Le travail d'encorbellement de pierres est alors plus que fameux ! Dans les exploitations plus récentes, la plupart des goulots sont de petite taille. Ils sont de l'ordre de 80 centimètres, bien que quelques rares aient même la dimension de 50 centimètres.
Les encorbellements sont recouverts de terre végétale, d'une épaisseur de 200 centimètres à 50 centimètres dans certains cas de carrières anciennes. Cela fait peu ! Dès lors, la terre était rendue à l'exploitation agricole ou jardinière, que des maisons ou même des immeubles ont pu recouvrir plus tard.
Nous pourrions nous questionner légitimement sur l’intérêt de réaliser une exploitation souterraine, ce qui est contraignant, alors que le volume de recouvrement est visiblement faible et qu’il aurait été aisé d'exploiter à ciel ouvert.
Plusieurs réponses existent :
- Tout d'abord, le ciel ouvert a existé, comme en témoignent Loos, Emmerin, Haubourdin. Bien que la finalité ait été légèrement différente, cela restait de l'exploitation extractive ;
- Ensuite, les exploitations en catiches permettaient de rendre la terre à la culture. Les terres lezennoises étaient (et restent) fertiles. Au contraire de la Pévèle, le Mélantois n'était pas recouvert de forêts, car le sol calcaire n'est pas très propice aux larges développements forestiers. Ainsi, comme nous le montre deux images de l'album de Croÿ, Lezennes était constituée à l'époque de larges territoires dédiés aux pâturages, que devaient côtoyer de nombreux terrains agricoles ;
- Un des intérêts réside aussi dans la discrétion d’une exploitation souterraine, ce qui fournissait moins de préoccupation quant aux modifications du paysage ; disons nos enquêtes publiques d'urbanisme actuelles, mais rapportées au contexte de l'époque ;
- Enfin, ce type d’exploitation demandait moins de travail d'extraction, et les anciens ont toujours été économes, cela se comprend.

Détail sur
l’encorbellement d’une catiche dans le lillois.
Les carriéreurs
En visitant les carrières de Lezennes-Hellemmes, confrontés à la vastitude des réseaux, nous pourrions légitimement estimer le nombre d’ouvriers à quelques milliers pour creuser un tel volume souterrain ! Cette impression est d’autant plus renforcée par l’anarchie la plus complète qui règne dans de très larges parts de carrière. Ce serait se fourvoyer.
En vérité, les carriers étaient peu nombreux sur une période donnée, mais l’exploitation a duré très longtemps.
Faisons l’impasse sur les travaux médiévaux du lointain moyen-âge pour s’intéresser pleinement aux périodes les plus productives. En effet, il n’est pas aventureux de dire qu’au XVème siècle, l’exploitation tourne à plein régime. Combien avons-nous d’exemple en d’autres lieux, d’ailleurs précités ? L’extraction continuera à un rythme inégal jusqu’au XVIIIème siècle, puis s’amorcera ensuite un sérieux déclin de l’activité extractive. Nombreux auteurs s’accordent à dire que l’exploitation s’est achevée en 1850, même s’il reste un élément anachronique, le cas Louis Levas, mais cela reste apparemment assez anecdotique. Disons à ce titre et afin de résumer que jusqu’en 1895, deux personnes sont visiblement encore exploitantes.
Cela nous donne donc le son de coups de pioches, à savoir plus de 400 ans d’industrie extractive à haut régime. Ce n’est pas rien, ce d’autant plus que l’on sait qu’il existe ça et là des queues de comètes.
De ces carriers, nous ne savons rien, ou en tout cas rien de véritablement complémentaire aux recherches du Cercle de Recherche Historique Lezennois. On ne trouve pas de signature de carrier dans les galeries, ou seulement très rarement alors que les témoignages d’autres personnes, mais surtout d’autres époques, sont innombrables. Deux hypothèses sont à formuler à ce sujet :
- Soit les carriers ne savaient pas écrire.
- Soit leurs témoignages sont trop ancien.
La première hypothèse est à rejeter. En effet, même si l’on ne sait pas écrire, ce qui était fréquent à l’époque, on trace. C’est ainsi que dans les cathédrales, par exemple, subsistent aujourd’hui des milliers de signes de tacherons. Ce sont des dessins, souvent symboliques et quelque peu mystérieux, qui rattachent un objet à un compagnon : une pierre, un élément de charpente, etc.
A Lezennes, on ne trouve aucune trace de ces marques de tacherons. Pourtant, l’affaire aurait été aisée : la roche est tendre et la surface ne manque pas. Il y a donc anguille sous roche.
Reste l’hypothèse de l’ancienneté des lieux. Une hypothèse à prendre en considération vu la tendresse et l’humidité de la roche qui se trouve altérée par ces conditions intrinsèques au milieu souterrain. De fait, très rares sont les inscriptions datant d’avant 1830. Il y en a, certes, mais elles ne sont pas légion.
De plus, si l’on considère l’état de l’inscription que Bernard Bivert caractérise comme étant « l’inscription gothique », on perçoit bien les ravages du temps sur ces témoignages. C’est à ce point altéré que c’est devenu pour ainsi dire illisible, même si, étonnamment, le lieu concerné n’est jamais touché par des battements de nappe.
Cette inscription, passant pour la plus ancienne de Lezennes, comporte le texte suivant : « Je pren congiez a la corir pour le grand peur que j’ay eu deden j’y ay cru d’en morir. » Cela se retraduit par : « Je prends congé de la carrière pour la grande peur que j’ai eue dedans, j’ai cru en mourir. » Cette inscription daterait du XVème ou XVIème siècle. C’est une inscription exceptionnelle.
Il n’est donc pas étonnant, si l’on s’en tient à cette hypothèse, de ne pas retrouver de traces des carriers. Déplorons simplement que ça ne nous arrange pas ! Mais la nature est ainsi faite, la carrière vit et meurt.
Les carriers sont souvent appelés les carriéreurs dans les documents anciens. Ce vocable touche surtout l’Ostrevent, mais on le retrouve aussi régulièrement sur le Lillois. Les variations orthographiques peuvent être carriereur (sans accent) et même carrieur. On ne retrouve jamais le mot carrier.
En certains recoins du Mélantois, on trouve des tireurs de blanc ; ce sont là aussi des gens qui nous intéressent. A citer aussi : les maîtres de chaux, mais ces derniers ne se rencontrent pas à Lezennes, non touchée par l’industrie chaufournière.
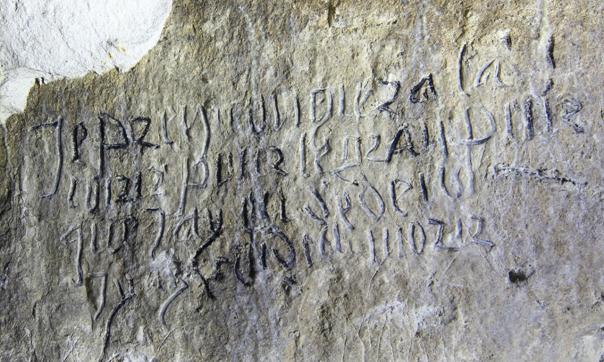
L’inscription
gothique telle qu’elle est en 2015.
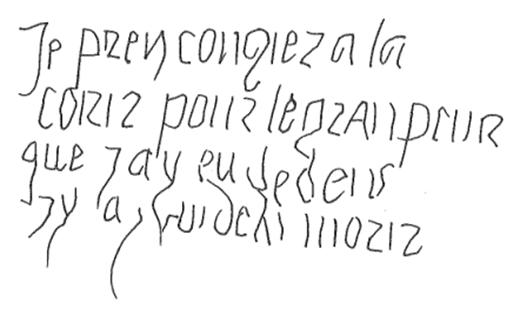
Un essai de retranscription.
Cette inscription a été passée au fusain dans un temps assez éloigné. C’est une mauvaise idée car ça l’altère ; ça dénature son authenticité. Il faut surtout ne pas y toucher ! Nous imaginons qu’elle provient d’un carrier embauché dans des travaux un peu scabreux, il aurait évité un éboulement. Cette inscription est tout bonnement exceptionnelle par le témoignage qu’elle représente.
La datation est très difficile. Ne faisant pas appel à l’onciale, le E est déjà gothique. Ce serait un tracé du XVIème siècle que cela ne serait pas étonnant.
A cela, il faut ajouter la découverte par Cyrille Glorieus d'une inscription jusqu'alors inconnue, dans le secteur médiéval. Il s'agit de Morel 1666. C'est une des plus anciennes inscriptions de la carrière de Lezennes.
Qui sont les carriéreurs ?
Nous reprenons la littérature les ayant identifiés, à savoir :
Bernard Bivert, les souterrains du Nord – Pas-de-Calais, première édition.
Voyage au cœur de Lezennes, CRHL.
En
provenance de Voyage au cœur de Lezennes, CRHL. Recensement de 1673. 29
ouvriers.
Brunin Pierre
Debachy Claude
Decottignies Anthoine
Defaulx Matthieu
Deflandres Jacques
Deflandres Jehan
Deflandres Pierre
Deflandres Guillaume
Defretin Franchois
Delannoy Mathieu
Delemarre Jehan
Delemarre Gabriel
Delemarre Pasquier
Descamps Louys
Dupont Anthoine
Dupont Michel
Everard Pierre
Everard Claude
Fayen Philippe
Fayen Anthoine
Fayen Robert
Lemahieu Jacques
Mauroy Jehan 1
Mauroy Jehan 2
Morel Anthoine
Serrurier Philippe
Waresquiel Arnould
Waresquiel Jacques
Willemot Franchois
Notons que ces relevés sont très largement confortés par les relevés de Bernard Bivert, qui ne comporte que des variations orthographiques des mêmes noms.
En 1876, 2 ouvriers : Deroo Pierre et un des Lefebvre.
En 1895, 2 ouvriers : Levas Louis et Roussel Auguste.
Tous ces noms ou presque sont très courants dans le Lezennes ancien. Même à ce jour, bien des patronymes se retrouvent dans les familles. Seuls quelques noms mènent à des impasses. Ces listes sont augmentées en seconde partie de cette recherche sur Lezennes et Hellemmes. Chacun des noms a été passé au peigne fin généalogique, ce qui a permis de localiser bien d’autres carriers actifs en ces périodes là.
Les utilisations ultérieures de la carrière vont affluer. Elles vont servir à deux activités bien distinctes : les cultures et les refuges.
Les cultures
A la fin de l’activité extractive, les carrières ne sont pas décédées pour autant. De nombreuses personnes vont prendre possession des lieux. Les utilisations en matière de culture vont être de trois types :
- La culture de barbe de capucins.
- La culture de champignons.
- La germination de l’orge.
Notons que le troisième point est rare et fut absent de Lezennes d’après l’état de nos connaissances, ce ne fut pratiqué (en principe) qu’à Faches.
La barbe de capucins
Cette plante fait partie de la famille des Asteraceae. C'est une chicorée, dont le nom scientifique est Cichorium intybus. Elle peut s'appeler Chicorée sauvage, Chicorée amère, Chicorée commune, ou encore Chicorée intybe. Le nom de la barbe de capucins est en réalité un surnom. Elle fut affublée de ce terme car les feuillages, assez fins et désordonnés, pouvaient ressembler à la barbe d'un moine capucin. C'est assez original. Cette espèce de chicorée est à ne pas confondre avec la Chicorée endive (Cichorium endivia), dont la production donne les chicorées frisées et les chicorées scaroles. La barbe de capucins est une plante de terrains incultes et de bords de routes. Au sein de sa culture en carrière, des conditions optimales sont mises en place afin de la forcer et renforcer certaines de ses caractéristiques.La plante produit des fleurs bleues en forme d'étoile. Un fait très particulier lorsqu'elle est cueillie, la fleur flétrit très rapidement. Cette caractéristique donne un joli surnom à cette plante : la fiancée du soleil. La barbe de capucin est réputée être connue depuis 1630. En cette année là, un certain Beausse Saint-Hilaire, originaire de Montreuil-Sous-Bois, plante des racines de chicorée dans sa cave, en absence de lumière. Il a la curieuse idée – loin d'être saugrenue – de mettre les racines en botte et de les placer sur un lit de fumier de cheval en fermentation. Les feuilles grandissent rapidement et ne développent aucune chlorophylle. Ces feuilles sont plus tendres et beaucoup moins amères que les feuilles vertes. Quelques semaines après, il se trouve bien étonné de la saveur des feuilles consommables. Cette expérience rencontre un certain succès et c'est de cette manière que se développe une véritable industrie, alimentant les marchés parisiens jusque dans les années 50.
Du côté de Lille, c'est en 1860 que l'idée fit son petit bonhomme de chemin. Un belge du nom de Jean-Baptiste Noël Dumoulin a eu l'idée d'utiliser les carrières dans le but de réaliser du forçage de pivots de chicorée. La barbe naissait ainsi à Lille.
Mais sa culture n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, il faut posséder des terres de surface afin de pouvoir semer des chicorées. Cette opération, réalisée dans les beaux jours de mai, offre les conditions adéquates afin de permettre à la plante de pousser jusqu’au début de l’automne, saison au cours de laquelle, en principe, les pivots sont déterrés. Une fois cette tâche accomplie, les pivots, préalablement sélectionnés et décortiqués de leurs feuilles vertes de manière à laisser un collet de feuille d’un centimètre, sont emmenés sous terre, dans les catiches de Lezennes. Les pivots sont préalablement sectionnés. Les feuilles vertes sont coupées, de manière à laisser un collet de feuille d'un centimètre uniquement. Seul le pivot est descendu sous terre.
Là, le terrain fort dur du remblai de pied est pioché par les barbeux. Ils repiquent en ligne les pivots, de manière à ce que ceux-ci puissent se développer à nouveau, mais totalement à l'abri de la lumière, et à une température constante de 12-13 degrés. Les collets sont recouverts de paille. Les racines vont alors développer à nouveau du feuillage. En absence de lumière, ces feuilles vont être blanches et or. Elles seront tendres et relativement peu amères. Après un mois de développement, les feuilles vont être soigneusement coupées par les barbeux. Elles seront regroupées par une ou deux livres, puis elles seront vendues sur les marchés.
Le travail de la jeune Zoé Dumoulin correspondait assez certainement à ce regroupement de belles feuilles d'or, en vue de les vendre ensuite sur les marchés. Il existe d'ailleurs une chanson (en chtimi) évoquant les belles barbeuses du marché. Pour des feuilles d'or, quelle belle analogie que celle de Zoé, la fiancée du soleil, menant curieusement une double vie à l'ombre des catiches.
Retournons aux salades et quittons ces évocations. A peine privées de leurs feuilles, les racines ne vont pas pour autant cesser leur activité, et le pivot va rejeter. Du coup, les feuilles vont être exploitées 8 à 10 fois, jusqu'à épuisement de la racine, ce qui en principe se situe en mars. Les plus beaux pivots, quant à eux, ne seront pas exploités. Ils seront en effet récupérés puis replantés en pleine terre. Le pivot va ainsi monter en graines, qui seront récupérées et ressemées, afin de redémarrer une nouvelle saison. Le temps que tout cela se fasse, le cycle de la barbe est bisannuel.
La culture de la barbe a cessé en 1957 à Lezennes. Les derniers cultivateurs utilisaient un puits au n°99 rue Chanzy, situé à l'avant de leur jardin. Il s'agissait d'Etienne Rocq et Simone Defaux.
Quelle fut l’ampleur de la culture de barbe dans les carrières de Lezennes – Hellemmes ? Il est difficile de répondre car les parcs à barbe ou à champignons ont des aspects assez indissociables, surtout dans l’état de ce qu’il reste de nos jours, c'est-à-dire des vestiges ténus. Une ou plusieurs familles se sont probablement lancées simultanément dans le commerce, car c’était assez lucratif, ce d’autant plus que cette culture a su traverser plusieurs périodes de troubles et palier ainsi à des périodes de disettes. Le début d’exploitation est plus ou moins situé en 1860 et la fin en 1957.
La création de la barbe à capucins dans le lillois est pourvue de nombreux éléments qui font penser qu’il s’agit avant tout d’une histoire Lezennoise. L’hypothèse numéro un, c’est que la technique de la culture de barbe en carrière aurait été inventée par Jean-Baptiste Noël Dumoulin (1827-1904), qu’on appelait avant tout Noël Dumoulin.
Qu’est-ce qui permet d’assurer que Dumoulin est derrière cette mise en place ? On sait que la barbe a été inventée par un Dumoulin originaire de Belgique aux alentours de 1860. Or, Jean Dumoulin provient de Belgique, Beclers plus précisément. On sait que lors de la naissance de sa première enfant, Marie, il était lezennois. L’acte de naissance de Marie le domicilie à Lezennes en 1860. Il était donc originaire de Belgique et présent à Lezennes au bon moment. Des actes administratifs, on sait qu’il était cultivateur, journalier, maraîcher. Est-ce que cela peut toucher la barbe, cultivée en surface avant d’être importée en carrière ? Nous le pensons. Les innombrables autres ne sont pas appelés cultivateur mais « laboureur ».
La deuxième hypothèse, c’est que les enfants Dumoulin auraient aidé à cultiver dans la carrière, toutes avant leur mariage. Il s’agit d’Augustine, Jeanne et Zoé. A chaque fois, la date de mariage marque en quelque sorte une étape de rupture, il n’y a plus de gravure aux murs après les mariages.
La troisième hypothèse, c’est que les innombrables gravures sont un marquage de territoire. On ne retrouve pas les graffitis de Zoé dans le fin-fond d’Hellemmes alors que dans le secteur de la Mer de Porcelaine, il y en a légion. Les graffitis permettent de nommer à qui appartiennent les cultures. Bien sûr c’est rudimentaire, mais serait-ce étonnant pour l’époque ? Des efforts faramineux ont été développés afin de retrouver des descendants des Dumoulin, mais la branche est éteinte à 99%. Les travaux ont été vains.
Si l’on considère la concentration des graffitis au sein de cette zone, il serait envisageable de dire que les personnes suivantes étaient de même des barbeux : Zoé Deldalle, Fernand Cuvelier, Marie-Louise Dumoulin (à courte durée), Léonie Blondeau, Fernand Dumoulin (à courte durée).
Le
père décédé en 1904, Zoé mariée en 1904, Jeanne mariée en 1903, Augustine
mariée en 1900, disons que le début du XXème siècle a dû marquer un sérieux
frein à cette culture en cet endroit, en tout cas au minimum de tout ce qui
émane des Dumoulin. Notons que les sœurs Dumoulin sont vivantes jusqu’à la
seconde guerre mondiale, et pourtant pas un graffiti n’est postérieur au début
1905. Nous ne localisons pas d’autre barbeux dans l’état actuel de nos
connaissances.
La culture de champignons
Les cultures du champignon de Paris ont été très largement répandues dans les carrières de Lezennes. Il est fort envisageable qu'elles aient dominé la culture de barbe de capucins, vu l'aspect presque banal de cette culture dans la France du XIXème siècle. Rares sont les carrières de grande envergure ayant échappé à la mise en champignonnière, de Lille à Marseille (Peypin). Ce fut même le cas en mine de zinc (Les Malines). En ce qui concerne Lezennes, le début d'activité pourrait se situer en 1824. Quelques activités ont peut-être débuté avant, mais nous n'en avons pas trace. Cette activité est donc précurseur de 40 ans à celle de la barbe.
Le processus est assez simple – ou disons plutôt banal – le procédé de Lezennes n'est différent en rien de celui de Paris ou de l'Aisne, à la précision près que, considérant l'époque, tout à été cultivé en meules et non en sacs ; mais cela ne constitue pas une information révolutionnaire. Le champignon cultivé était l'agaric, encore appelé champignon de couche.
La toute première étape consiste à préparer un bon compost. A Lezennes, il était établi à base de fumier de cheval essentiellement, provenant des armées basées à Lille, puis d'un mélange de paille. Le fumier est déposé dehors sur une aire, afin qu'il macère. Plus précisément, il entame à ce moment là une fermentation, qui va être propice au développement des mycéliums.
Ce développement de compost est saisonnier. En effet, la fermentation provient de l'activité de bactéries. De ce fait, il faut impérativement qu'il ne fasse pas trop froid. Autrement leur activité est ralentie voire même stoppée. Afin de favoriser les opérations de fermentation, le fumier est brassé deux fois à l'aide de fourches (ce pourquoi on retrouve assez régulièrement des fourches dans les carrières ayant servi de champignonnière). Ce brassage permet d'élever la température, engendrée par l'activité des bactéries. Les champignonnistes avaient soin de laisser monter la température à 60°C, de façon à stériliser le fumier, qui peu à peu donc se transforme en compost. Cette opération de montée en température s'appelle la pasteurisation.
A la fin de cette étape, le tas est descendu en carrière souterraine. Lors de cette opération, une organisation spatiale du compost est effectuée. La précieuse matière est disposée de manière à optimiser la culture. A Lezennes, ce fut exclusivement en meules. Ce sont des rangées de lignes de compost, d'une hauteur et d'une largeur d'environ 40 centimètres.
Une fois les meules constituées, le compost est ensemencé avec le mycélium. Cette opération bien particulière s'appelle le lardage. Nous n'avons aucune idée de comment ça se passait à Lezennes du fait de manque de documentation, le mycélium était reçu soit par briques soit par galettes. La précision nous manque. Quoi qu'il en soit, le mycélium était cassé en petits morceaux réguliers, puis enfoui 5 centimètres dans le compost, lequel est à température modérée à ce moment là (entre 20° et 25°, en fin de fermentation).
Au bout de quelques jours de développement, le compost se recouvre d'un voile blanc. Cela signifie que le mycélium se développe positivement. Les champis recouvraient alors la meule d'une fiche couche de pierre calcaire broyée. La matière ne manquait pas, ils se servaient directement dans le remblai de pied. Cette matière s'appelait le « cran » dans leur vocabulaire et l'opération s'appelle le gobetage. Cette opération est essentielle dans le but de maintenir le compost à un certain taux d'humidité.
Une trentaine de jours après ces opérations, la récolte peut commencer. Cette récolte, faite à la main, durera plus ou moins deux mois selon la vivacité du mycélium. Les champignons étaient disposés par les cultivateurs dans de gros paniers. Ensuite, ils étaient vendus sur les marchés. A savoir que les récoltes sont irrégulières. On les appelle des volées. Le mycélium s'épuisant, les récoltes sont de moins en moins fructueuses, jusqu'à la reprise de toutes les opérations (fumier, brassage, etc).
Le travail n'est pas achevé même si la vente débute. Une fois la récolte terminée, il faut encore stériliser le compost. Vu l'espace à Lezennes, il n'est pas rare que les meules étaient purement et simplement abandonnées. Une hygiène irréprochable doit être maintenue tout le long du processus de production. Autrement, c'est le développement de maladies cryptogamiques.
Les champignonnistes
Au même titre que la barbe de capucins, la culture de champignons a eu lieu dans les carrières de Lezennes – Hellemmes. Il n’est pas possible de déterminer si ce fut une culture massive ou sporadique. La situation laisse deviner que c’était d’assez grande ampleur, sans qu’il soit envisageable d’affirmer autre chose qu’une supposition. Au XIXème siècle, un nombre gigantesque de sites souterrains est investi à cette fin, dans tout le bassin de la craie : Le Nord, l’Aisne, l’Oise, la Somme, le bassin Parisien, l’Anjou. Lezennes n’y a pas échappé, on s’en doute.
Au même titre que la barbe, il est difficile de localiser les cultures dans les carrières de Lezennes. Les vestiges sont trop anciens, les meules sont aplaties. Une seule précision tout de même, vu l’époque concernée – à savoir un étalement plus ou moins comparable la barbe – il n’y eut aucune culture en sac, même en fin d’exploitation champignonnière.
Des champignonnistes, nous ne connaissons les exploitants que par leurs inscriptions. Cela donne un dénombrement faible, mais inédit.
La famille Hayez était champignonniste de père en fils. C’est une supposition qui est faite sur la base que le jeune Auguste Hayez (1895-1916) se déclare au mur comme étant contremaître, dans Hellemmes : Auguste Hayez, né à Annappes le 2 octobre 1895, âgé de 17 printemps le 9 janvier 1913, contremaître champignonniste. Les parents et grands-parents étaient chez Crombez à faches. Les inscriptions d’Auguste Hayez sont nombreuses.
Après, quatre ou cinq inscriptions émaillent les murs, principalement dans le tout-à-fait nord de l’exploitation. L’une de ces inscriptions, émanant du grand-père d’Auguste : César Hayez, est datée de 1824.
Une autre imposante série de signatures émane de Constant Cuvelier. Nous savons par la littérature (CRHL) qu’il était champignonniste. Ses marquages ne sont pas fantasques. Il s’agit de tracés relativement austères. Là encore, il est émis l’hypothèse que le cultivateur marquait au mur les meules lui appartenant.
La littérature nous relate les aventures d’un célèbre Monsieur Puy, maître-champignonniste en 1848, qui se perdit dans la carrière. Il est aussi relaté que le dernier cultivateur, Gaston Voght, cessa ses activités en 1957. Après cette date, qui représente la terminaison à Lezennes, la culture perdura dans le lillois. A simple précision, ajoutons qu’elle est à ce jour perdurée en un seul endroit dans le lillois, à Faches chez Bernard Crombez. La culture de la barbe est perdurée en un seul endroit de même : Loos au lieu-dit Bon Dieu Noir. A Faches sous le parc de la Croisette, la culture est stoppée en 2015.
Au sein des carrières de Lezennes, il est relevé une foule de noms de petits journaliers, de visiteurs, d’inconnus : Stanislas Ducattillon, Richard Buttin, Joséphine Buttin, Joseph Morel, François Morel, Henri Fertein, Louis Hespel, Léon Marchand, Louis Bléhaut, Léon Dubois, Alexis Lefebvre, Pierre Nisse, Albert Barbieux, Jean-Baptiste De Keuster, Rémy Delattre … Etaient-ils champignonnistes, ou de simples visiteurs ? Nul ne le sait. Ou plutôt, disons que les études et les textes manquent.
Vu le travail intense que demande la culture de champignons, les ouvriers devaient être nombreux. Reste que cela n’a pas forcément duré dans le temps. Il y a eu probablement (relativement) peu de cultivateurs, mais de nombreux manœuvres.
Les refuges
Les carrières de Lezennes ont servi de refuge quasiment dès leur création. Cette affirmation serait à consolider, mais dès les premières affres de l’histoire, on se rend compte que les humains se sont cachés dans les réseaux souterrains, ou bien ont dissimulé des biens.
Du côté de Lezennes, des récits épisodiques émaillent l’histoire dès le début du XVIème siècle. Néanmoins, ces petites histoires restent assez sommaires et ne nous décrivent pas des évènements massifs de mouvements de populations dans les souterrains. De plus, comme c’est le cas pour les carriers, les murs ne nous retranscrivent plus les récits des personnes isolées dans le noir du dessous-terre – c’est trop ancien.
Ce que la carrière possède encore à nous donner, ce sont les inscriptions des conscrits cherchant à échapper à leur obligation, les soldats napoléoniens se dissimulant dans le but d’échapper à l’enrôlement, beaucoup d’inscriptions de la guerre 14-18, et des réfugiés du conflit 39-45. Concernant ce dernier, cela date surtout de 1944.
Après, tout se mélange avec un magma d’inscriptions peu identifiées, qui comme dans tout l’ensemble et toutes époques confondues, englobe autant de travailleurs que de visiteurs.
De l’époque napoléonienne, on retient surtout la longue inscription : Vive Le Roi. Le 18 juin 1815. Agée de 33 ans – Agée de 22 ans – Agée de 29 ans – Agée de 25 ans – Jean-Baptiste Deflandre – Pierre-Joseph Perus – Ciril Beghin – François Steclebout. Avoir servi 8 ans – Avoir servi 6 mois – Avoir servi 2 mois – Avoir servi 3 mois. Cette inscription, tracée au crayon, est menacée par un rejet de WC, se déversant quasiment dessus.
Tous portent des noms typiques du lezennois. Signalons tout de même (et malheureusement !) qu’il est actuellement connu 16 Jean-Baptiste Deflandre à Lezennes. Si l’on se réfère à la date de naissance, il s’agit d’un 17ème Jean-Baptiste Deflandre, rien que ça ! Pierre, Joseph Perus (né en 1794) était charpentier. Ciril Beghin, (1786-1846), était charpentier. Jean, François Steclebout (1790-1828) était cultivateur. Notons qu’il est très fréquent pour l’époque d’être appelé par son deuxième prénom, à tel point que le premier en était quasiment oublié.
Plus près de nous, c’est lors de la guerre 14-18 que nombreuses inscriptions sont faites. Loin de se cantonner à cette seule activité, les réfugiés en viennent à habiter dans le souterrain. C’est ainsi que des lieux de culte sont montés. Ils existent encore de nos jours, bien qu’ils soient difficiles à authentifier. Ils ont peut-être été restaurés à plusieurs reprises.
Deux monuments subsistent de nos jours, rappelant les jours sombres de cette période de l’histoire.
Premièrement la « chapelle » Notre-Dame de Lourdes. Il s’agit d’un fond de galerie qui a été aménagé de manière à recevoir une statuette. A côté est gravé N.D. de Lourdes, P.P.N. Oct 1914. Puis, nettement sur la gauche, la longue liste des familles réfugiées : Lefebvre, Allart, Huyghe, Morel, Debuchy, Delerue, Demessine, Bernaert, Deffrannes, Dorchies, Meurisse, Faux, Moreau, Caby, Grimonprez, Deneulin, Pezin. L’abbé Guidé (sous réserves).
Le second monument est une très grande double-inscription réalisée par les Lefebvre. Elle est située sous la nouvelle mairie, qui à l’époque correspondait au vaste corps de ferme des Lefebvre. Le texte comporte les termes suivants : 1880, A. Lefebvre, Victor Lefebvre, Sophie Lefebvre, Alexis Lefebvre, Auguste Lefebvre, Eugénie Droulers, Marie Droulers, Edmond Droulers, Eugène Droulers, Gabrielle Droulers. 1914 Alexis Lefebvre, Marie-Louise, Suzanne, Jean, Pierre, Marguerite, Gérard, Auguste Lefebvre - Angèle Couplet, André, Antoinette, Etienne, Victor, Thérèse, Joseph, Sophie Lefebvre. Ce très grand panneau gravé est à notre connaissance unique dans un très large environnement.
Plus loin dans la carrière, on trouve encore : En 1914, année de la guerre, Pierre et Etienne Lefebvre vinrent explorer ces souterrains.
Comme aux désormais (devenues) habitudes, ces gravures sont suivies d’un nuage d’autres inscriptions, datées de plus ou moins 1914, et dont les signataires nous restent anonymes : Frappart Georges le 6 octobre 1914, Louis Choquel le 4 Xbre 1914, etc. Signalons qu’Auguste Hayez, champignonniste, est décédé au combat à Berny en Santerre en 1916.
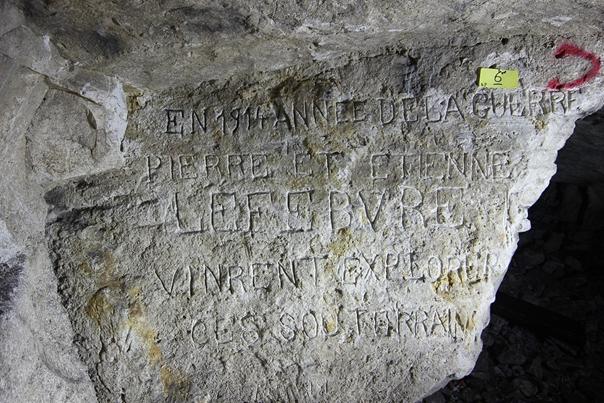
1939, l’histoire recommence. Les réfugiés affluent de nouveau dans les souterrains. Les accès privés vers les carrières se multiplient. Ces accès sont creusés depuis les caves et sont encore visibles aujourd’hui en bien des endroits. Cela rend la visite assez étonnante, car il n’est pas rare de découvrir ça et là des caves, la plupart du temps condamnées (elles ont été rendues borgnes par des murages).
La différence avec 1914, c’est qu’ici la résistance s’organise. Notamment, la SNCF fait bâtir un abri anti-aérien. Ce lieu est toujours visible aujourd’hui et se situe à quelques pas du technicentre SNCF d’Hellemmes. Il s’agit d’une galerie longue de 120 mètres, dont le ciel est consolidé de barres d’acier et de béton. Aujourd’hui, l’accès à l’abri est muré.
Quelques signatures ressortent, comme celle de Gaston Moulard, qui écrit : réfractaire du Service du Travail Obligatoire. On imagine tout à fait l’angoisse de se cacher là, au fin-fond du labyrinthe.
L’époque contemporaine
L’accès aux carrières est interdit par arrêté municipal depuis 1985. Cette décision a été prise considérant les incessants déclenchements de secours suite aux pertes de visiteurs. A chaque fois, cela demande un investissement colossal en sauveteurs vu le développement immense et anarchique des carrières.
Depuis 1985, l’histoire s’est à peu près arrêtée dans les carrières. Ce phénomène est compréhensible vu la complexité chaotique des carrières : le danger de perte et le danger d’effondrement localisé.
Dans le courant des années 90, une personne a particulièrement investi les lieux. Il s’agit de Jean-François Colsenet, plus connu sous le nom de Jeff Olsen. Cet artiste, habitant la rue Pasteur, a creusé un puits dans sa cave, ce permettant de rejoindre l’immense dédale de carrière. Il en résulte un certain nombre d’aménagements, quelquefois un peu vieillissants mais toujours présents : chapelles, fausses tombes, salle de cinéma, salle de culte, etc. Le tout, aussi original que joli, permet de donner une nouvelle vie au souterrain.
Notons aussi l’originale expérience de deux personnes restées 12 jours dans les carrières. Elles ont laissé l’inscription : ICI VÉCURENT DU 24/10 AU 6/11 1981 HERVÉ FORICHON ET CHRISTIAN PORTAL. Ils ont dénommé le lieu la Villa Ali-Baba.
Les carrières restent aujourd’hui sous la surveillance de la mairie de Lezennes (principalement), de la mairie d’Hellemmes, de la mairie de Villeneuve d’Ascq. Concernant le secteur situé administrativement parlant sur Hellemmes, la surveillance était effectuée par un ingénieur spécialement affecté à cette mission, de la Ville de Lille : Madame Géraldine Berrehouc. La surveillance des vides affectant un territoire public est sous la surveillance du SEISM, dirigé par Monsieur Etienne Kuffel, lequel dirigeait le SDICS à la suite de Monsieur Bernard Bivert. Les carrières sont visitables lors des journées du patrimoine. Elles sont placées sous le regard bienveillant d’Emmanuel Dusséaux et de Jeff Colsenet.
Introduction à l’étude généalogique.
Dans les carrières de Lezennes, des centaines de personnes ont inscrit dans la craie une trace de leur passage. Ce sont des gravures au couteau, des inscriptions au crayon, plus rarement à la sanguine, quelquefois des tracés à la peinture. Relever la totalité des inscriptions, cela signifie maîtriser le parcours dans toute la carrière. Honnêtement, bien peu de personnes en sont capables. Cet inventaire pourrait se révéler du coup assez laborieux.
Pour autant, le passage dans les galeries révèle une myriade d’inscriptions. Les relever au passage, sans volonté systématique, est assez facile. Au cours de quelques promenades, c’est ce qui fut fait. Il en ressort des données intéressantes. En premier lieu ce qui saute aux yeux, c’est qu’il apparaît une différentiation nette entre le panneau monumental des Lefebvre et les inscriptions innombrables des Dumoulin. Les Lefebvre semblent surtout avoir réalisé un panneau sous la ferme leur appartenant, réfugiés en 1914 comme bien d'autres.
Le présent travail est une collecte des informations généalogiques et un ordonnancement de celles-ci dans une volonté d’ouvrage d’identification. Le classement suit les quatre grandes catégories de personnes ayant fréquenté le dessous-terre lezennois, à savoir :
- Les carriers, créateurs de l’immensité souterraine
- Les barbeux
- Les champignonnistes
- Les réfugiés et les visiteurs.
Afin d’être honnête, il faudrait ajouter une cinquième catégorie : les inconnus.
Nous allons aborder chacune des catégories évoquées.
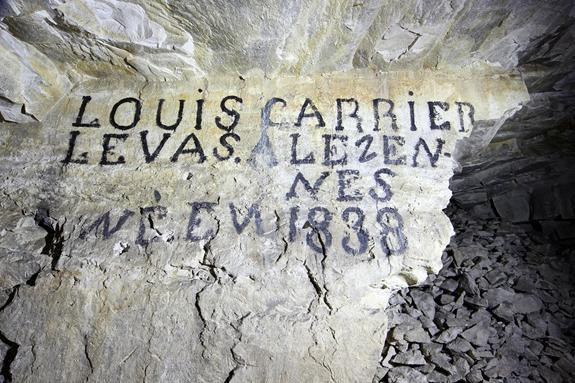
Les carriers
Leurs signatures sont totalement absentes des murs de la carrière, comme ce fut expliqué. La seule exception concerne des exploitants très tardifs : Louis Levas et Auguste Roussel.
Les Roussel :
Ils viennent en famille depuis la région du boulonnais. Nous relevons :
* Auguste Roussel, né Audembert 1820 canton Marquise Pas Calais 1887, (lu à Hellemmes). Audembert est identifiée. Il s’agit d’une petite commune située près de Wissant. Il s’installa à Lezennes assez tardivement.
* Zénon Roussel, né à Boulogne-Sur-Mer, 1867. Fils d’Auguste.
Le mystérieux cas de Louis Levas :
Il s'agit d'un carrier qui a signé en de multiples endroits proches de Lezennes ou « à » Lezennes.
Il signe à Lezennes : Louis Levas, carrier à Lezennes, 1882.
Il signe à Hellemmes : Louis Leva carrier à Lezennes.
Il signe à Lille Sud : Louis Levas, carrier à Lezennes, né en 1838.
Plus quelques inscriptions identiques à Hellemmes, agrémentées de LOVAT et variations.
Un problème se pose immédiatement, l'exploitation de Lezennes était terminée à cette date là (1882). Le déclin était amorcé depuis bien longtemps. Pourtant, il se déclare bien comme « carrieur », et non champignonniste. Bernard Bivert évoque une hypothèse : il s'agissait éventuellement d'un carrier pirate. Mais lui-même met l'affirmation en doute, ou plutôt disons en balance, on ne sait pas réellement quand a été stoppée définitivement l'exploitation de Lezennes. Certaines carrières sur Wattignies ont été tardives, alors pourquoi pas de même sur Lezennes ?
Au niveau généalogique, Louis Levas est un personnage discret. Il nait le 4 septembre 1838 à Lezennes. Son père Auguste Levas était carriéreur. Il décède le 21 février 1909 à Lezennes, à l’âge de 70 ans.
Si l’on poursuit le voyage vers l’ancienneté, nous relevons Pierre Deroo, en 1876. Il signe dans les carrières d’Hellemmes. Nous le relevons comme étant carrier. Il est né le 29 juin 1836 et décédé le 19 juin 1914.
Son père, Antoine Deroo, était carrier. Il est né le 6 juillet 1799 et décédé le 24 août 1874. Il n’est pas pour autant possible de dire que chez les Deroo, on est carrier de père en fils. Le métier ne s’est transmis qu’entre ces deux personnes. Nous relevons tout de même un « carrieur » du nom d’Adrien Deroo, né le 6 juillet 1799 et décédé le 24 août 1874, pour lequel nous ignorons tout, si ce n’est que son activité est relativement tardive et éventuellement liée à une tradition de champignonniste.
L’analyse du recensement de 1770
Le CRHL a dépouillé le recensement de 1770, lequel fait apparaître les noms de certains carriers, à savoir 38 ouvriers. Nous avons repris les fiches d’état civil de tous ces individus et à partir de là, dans le but de localiser d’autres carriers, nous avons dépouillé toutes les fiches des parents, grands-parents, frères et sœurs, fils et petits-fils, cousins, les oncles et tantes.
Ce fut riche d’enseignement car de nouveaux carriers ont été découverts. De ce fait, nous passons chaque individu en revue, avec le plus souvent des informations d’un ordre assez limité. Cela permet tout de même de progresser dans la connaissance de la carrière. A partir de là, nous dresserons un second tableau d’inventaire : le recensement de 1770 complété.
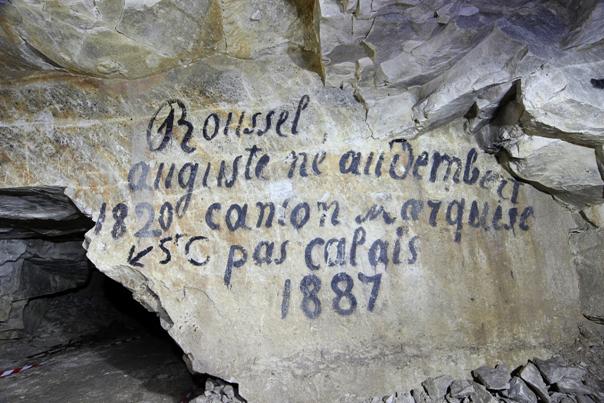
Les carriers et les familles de carriers :
Les Bachy, De Bachy, Debachy semblent tous êtres des Debachy. Les autres noms, jusqu'à Bassi, sont toutes des variations orthographiques. Ils ne se déclarent pas comme carriers mais comme débiteur de pierres (Jean, Baptiste Debachy & Armand, Louis, Joseph Debachy) et tailleur de pierres (Louis Debachy). Doit-on considérer qu’ils n’étaient pas carriers mais qu’ils effectuaient un second œuvre ?
Pontien Debachy, né en 1717 et décédé le 2 octobre 1794 se déclare quant à lui comme carriereur. Son fils, Simon Debachy, né le 11 février 1738 et décédé le 11 août 1786, de même.
Nous relevons un étrange « Pierre – Piotre Debachy », se déclarant comme carriereur. Il est né le 13 avril 1730 et décédé le 19 mars 1781. Le mot carriereur figure très précisément sur son acte de décès.
Au sujet des Levas, Lesvas, Leva, l’orthographe correcte semble être Levas. Louis Levas (disons Louis premier) est effectivement identifié comme carrier. Il est né le 12 mars 1762 et décédé le 9 mars 1834. Au sujet de Jacques Levas, il est mal identifié. Il pourrait être ce Jacques Levas né le 3 mars 1738 et décédé le 8 septembre 1771.
Nous complétons les données par l’existence d’un certain Auguste, Joseph Levas, fils de Louis Levas. Il est né le 15 juin 1795 et décédé le 13 juin 1873. Ce dernier se déclare comme carrieur. Il s’agit du père de Louis Levas second.
Damianus Morel était carrier. Il est né le 27 septembre 1736 et décédé le 6 septembre 1817. Il se déclare à l’administration comme étant carrier, mais assez étonnamment, il se déclare comme étant voiturier. Doit-on en conclure qu’il livrait les pierres ? Notons que le CRHL l’identifie comme étant Damien Morel, sans latinisation du nom.
Aux Morel, nous ajoutons la personnalité de Théodore Morel, hors du recensement de 1770. Ceci est compréhensible car il est contemporain des travaux tardifs, menés par Deroo et compagnons. Théodore Morel est né le 7 novembre 1820 et décédé le 2 octobre 1900. Son exploitation est donc inévitablement fort tardive.
Les Defaux représentent une assez grande dynastie de carriers. La tache n’est pas facile car nous en répertorions des centaines à Lezennes.
Eloi Defaux, né le 2 octobre 1731 et décédé le 3 octobre 1801.
Nous ajoutons à cette liste Michaelis Defaux, né le 26 février 1742 et décédé le 24 décembre 1809. Il se pourrait qu’il soit identique au Michel Defaux de l’inventaire.
Nous ajoutons à cette liste Alescius, Josephus Defaux, né le 31 mai 1733 et décédé le 22 juillet 1794. Son nom courant était probablement Joseph Defaux.
Nous ajoutons François, Antoine Defaux, né en 1746 et décédé le 23 décembre 1812.
Nous ajoutons Jean, Baptiste, Joseph Defaux, né en 1752 et décédé le 7 mai 1810.
Au sujet des Defaux, nous ajoutons de même Isidore Defaux, mais celui-ci est postérieur au recensement de 1770. Il est né le 28 février 1777 et décédé le 28 février 1847.
Gabriel Defretin, né le 14 juin 1743 et décédé le 26 août 1782, se déclare comme journalier, comme une foule d’autres ouvriers de l’époque. Il pourrait correspondre au recensement. Nous ajoutons aux Defretin les individus suivants :
- Jean-Baptiste Defretin, né le 1er juillet 1740 et décédé le 29 mars 1790.
- Son fils Jean, Baptiste, Joseph Defretin, né le 27 mars 1780 et décédé le 23 mai 1847. Il était marié à une Debachy.
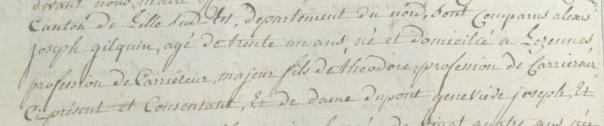
Jacques Dupont est bien identifié. Il est né le 17 septembre 1713 et décédé le 24 janvier 1772. Il se déclare comme carrieur à l’administration. Jean-Baptiste Dupont est quant à lui aussi identifié, mais il s’enregistre en tant que charpentier auprès de l’administration.
Vincent Fayen est le seul des Fayen à être correctement identifié comme carrier. Il est né le 17 février 1736 et décédé le 17 août 1794. A noter que l’un de ses fils (Vincent de même) exercera la profession de… mendiant !
Nous identifions encore un Fayen en tant que carrier, mais hésitons sur son nom. Il se nomme Franscisusi, Rémigus, Josephus Fayen, né le 26 avril 1740 et décédé le 29 août 1779. Doit-on considérer qu’il s’agit de François Fayen ? Joseph Fayen ?
Pierre-Joseph Mahieu est bien identifié, mais il se déclare en tant que cultivateur.
Antoine-Joseph Morel est bien identifié aussi, mais il déclare la même profession. Quant à Blaise Morel, il se déclare comme laboureur.
Quant à la dernière famille, les Deflandre, nous sommes là dans une liste épique et interminable. Il est difficile de bâtir des hypothèses sur les Deflandre. En effet, c'est un nom si répandu dans le Lezennes de l'époque que cela revient à comparer des pommes et des poires. En cette période là, le nom est aussi répandu que les Dupont et les Lefebvre. Signalons à toutes fins utiles que le nom Deflandre n'est plus répandu aujourd'hui, à tel point qu'il n'y en a plus dans Lezennes à ce jour, étonnant ! Tout du moins un aspect que nous pouvons préciser, c'est que dans les Deflandre correctement identifiés, il y a une prédominance du lien familial. Certains sont frères, ce que nous précisons les concernant.
Dans le même ordre d'idée, il est très difficile de monter des hypothèses sur les carriers dans l'ensemble. Cela se révèle tirer des plans sur la comète. En effet pour la plupart, nous ne connaissons que la date de naissance et de décès. Tout au plus, nous connaissons des mariages, lesquels sont souvent interconnectés, par exemple les Morel avec les Deflandre. Mais là encore, ces considérations sont à ramener aux Dupont Durand et autres noms répandus. Nous sommes manifestement trop dans le vague.
Ceux que nous localisons dans les archives sont les suivants :
Le plus ancien Deflandre que nous répertorions est Simon Deflandre, né le 4 novembre 1704 et décédé le 10 juin 1763. Se déclarant comme carriereur, il est marié avec une Fayen. Il est suivi de près par Joannes Deflandre, né le 9 juin 1711 et décédé le 16 août 1772. Il se déclare comme carrieur. Il est marié avec une Debachy.
Deflandre Anselme, né le 18 avril 1733 et décédé le 24 mai 1789. Notons qu'il se signale à l'administration comme laboureur.
Deflandre Pierre-Joseph, né le 5 septembre 1763.
Deflandre Antoine, fils d'Anselme. Né le 25 novembre 1765 et décédé le 20 février 1830.
Deflandre Simon (2), fils d'Anselme. Né le 26 octobre 1775 et décédé le 20 mai 1805.
Deflandre Pierre, fils d'Anselme. Né le 30 septembre 1778 et décédé le 28 novembre 1842.
Deflandre Jean, fils d'Anselme. Né en 1758 et décédé le 27 mai 1780.
Deflandre Jean-François, fils d'Anselme. Né le 2 août 1768.
Deflandre Lambert, né en 1743. Se déclare comme cariereur (sic).
Deflandre Jean-Baptiste. Né le 8 août 1744 et décédé le 28 octobre 1784, il se déclare comme carrieur (sic).
Deflandre François, Ernest, né le 22 novembre 1735 et décédé le 13 mars 1790, se déclare de même comme carrieur.
Deflandre Pierre, François, né en 1713 et décédé le 26 mars 1796, se déclare comme carriereur.
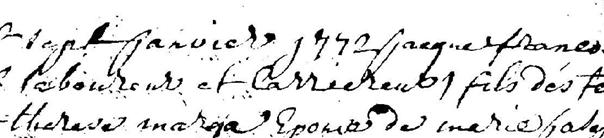
Théodore, Joseph Gilquin, né le 8 décembre 1750 et décédé le 22 avril 1822, se déclare comme « carrieur ». Il était marié à une Leva.
Charles, Louis, Joseph Gilquin, né le 13 septembre 1748 et décédé le 7 janvier 1817, se déclare comme « carrieur ». Il était aussi marié à une Leva.
Alexi, Fidel, Joseph Gilquin, né le 14 avril 1780 et décédé le 4 septembre 1853, se déclare comme « carrieur ». Notons que ça n’a pas du être une formidable étape dans sa vie, car plus tard, il se déclare comme mendiant.
Chose étonnante, un certain Théodore, Jean-Baptiste Gilquin, né le 13 juin 1833, se déclare comme carrieur. Il pourrait avoir été un compagnon des Deroo et Lefebvre, voire même de Levas et Roussel.
Quelques inconnus encore, dont les noms sont moins fréquents dans les familles lezennoises. Il y eut notamment des Dupont, ce qui vu la fréquence du nom ne nous arrange pas, encore que la situation locale concernant les Deflandre et les Debachy est bien pire… C’est ainsi que nous relevons Jacques, François Dupont, cité assez tôt dans les registres. En effet il est né le 17 septembre 1713 et décédé le 24 janvier 1772. De même, nous relevons un certain Josse Dupont, né le 7 avril 1750 et décédé le 8 mai 1801.
Inconnue, une personne du nom de Jean, Baptiste Crombez, se déclarant comme carriereur. Il est né le 13 février 1733 et décédé le 11 août 1798. L’orthographe réelle de son nom pourrait être Crombet, c’est en tout cas ce qui figure sur plusieurs actes.
Il nous reste encore trois personnages discrets à citer.
Jean, François Vanquaille, qui pourrait être né en 1744 à Sint-Niklaas en Belgique. Il est décédé me 18 mai 1813. Son métier de carriereur pourrait avoir été temporaire étant donné qu’il décède en tant qu’ouvrier couvreur.
Tout aussi mystérieux est le parcours de Philippe, Joseph Doignon, né à date inconnue, et décédé le 6 janvier 1791 à Lomme. Nous ne savons rien le concernant.
En dernier lieu, Hyacinthe, Joseph Pezin, né à Marchiennes le 14 mai 1791 et décédé le 16 décembre 1861. Il se déclare comme carriereur. Il est marié à une Defaux.

La reconstruction du recensement
Nous
faisons l’impasse du recensement de 1673 car nous n’avons pas accès à ces
archives. De ce fait, nous reconstruisons la liste en deux recensements, celui
de 1770 et dates proches, et celui des personnes qui ont été actives en toute
fin d’exploitation : 1840-1895.
Barratte Antoine
Cambray Jean
Colette Honoré
Crombet Benoît
Crombet Charles
Crombet Jean, Baptiste
Debachy Antoine-Joseph
Debachy Antoine
Debachy Pontien
Debachy Simon
Debachy Jean, Baptiste
Debachy Armand, Louis, Joseph
Debachy Pierre, Piotre
Defaux Eloi
Defaux Pierre
Defaux Alescius, Josephus
Defaux Jacques-François
Defaux François, Antoine
Defaux Jean, Baptiste, Joseph
Defaux Michel
Deflandre Anselme
Deflandre Antoine
Deflandre François, Ernest
Deflandre Guillaume
Deflandre Jean
Deflandre Jean-Baptiste
Deflandre Jean-François
Deflandre Joannes
Deflandre Lambert
Deflandre Pierre
Deflandre Pierre-Joseph
Deflandre Pierre, François
Deflandre Simon (1)
Deflandre Simon (2)
Defretin Gabriel
Defretin Jean, Baptiste, Joseph
Defretin Jean-Baptiste
Delemarre Louis
Delemarre Quintin
Delemarre Michel
Descamps Pierre-François
Doignon Philippe, Joseph
Dupont Jacques
Dupont Jean-Baptiste
Dupont Jacques, François
Dupont Josse
Fayen Charles
Fayen Vincent
Fayen François, Rémi
Gilquin Théodore, Joseph
Gilquin Charles, Louis, Joseph
Gilquin Alexi, Fidel, Joseph
Leperre Guillaume
Levas Jacques
Levas Louis
Levas Auguste, Joseph
Mahieu Pierre-Joseph
Morel Antoine-Joseph
Morel Blaise
Morel Damien
Piat Jean-Baptiste
Vanquaille Jean, François
1840
Defaux Isidore
Deroo Pierre
Gilquin Théodore, Jean-Baptiste
Morel Théodore
Pezin Hyacinthe, Joseph
1895
Levas Louis
Roussel
Auguste.
Cela porte les inventaires aux valeurs suivantes : 1770 le nombre de 62 ouvriers connus, 1840 le nombre de 5 ouvriers connus, 1895 stable, le nombre de seuls 2 ouvriers connus.
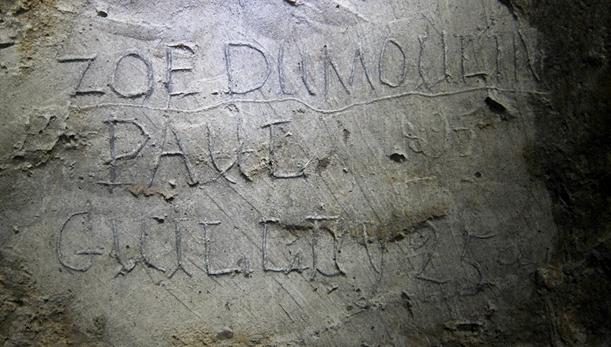
Les barbeux
Les relevés concernant les barbeux, c’est tout d’abord s’intéresser aux Dumoulin et aux personnes qui gravitent autour. Au sein de la carrière et principalement dans le secteur de la Mer de Porcelaine, il est relevé [tous les noms précédés d'un * correspondent à une inscription en carrière] les noms suivants :* Zoé Dumoulin, née Zoé Adolphine Dumoulin. Née le 9 avril 1884 à Lezennes et décédée le 20 juin 1946 à Lezennes. Mariée en 1905 avec * Fernand Cuvelier, (1886-1911). Fille de Jean Dumoulin (1827-1904) et Thérèse Ghueluy (1838-1914). La petite dernière, famille de 10 enfants.
Sa grande soeur :
* Jeanne Dumoulin, Née le 28 septembre 1881 à Lezennes et décédée le 23 avril 1948 à Loos. Mariée en 1903 avec Jules Marga, (1873-1926).Sa grande soeur :
* Augustine Dumoulin, âgée de 17 ans en 1894 d'après l'inscription. Née le 18 août 1877 et décédée le 13 novembre 1956. Mariée avec Louis Delobel.* Fernand Dumoulin, âgé de 12 ans en 1897, 17 ans en 1904, d'après les inscriptions.
Deux existent à cette date. Ne sont pas frères de Zoé. Fernand Dumoulin (1885-1943) marié avec Alice Vandendriessche. Fernand Dumoulin (1885-1943) marié avec Mathilde Baratte. Le monument aux morts dénombre un Fernand Dumoulin victime civile de bombardement. Notons que nous trouvons une paire d’inscriptions de Mathilde Baratte.* Henri Dumoulin. Son grand-père.
Né en 1809, décédé à date inconnue. Marié avec Adelaïde Lefebvre, née en 1813 et décédée à date inconnue.Il s’agit d’une grande famille, que les recherches généalogiques de Laurent Balloy reconstruisent de la sorte [par rapport à Zoé] :
Grand-père et grand-mère
Henri, Joseph DUMOULIN et Adélaïde LEFEBVREPère et mère
Jean-Baptiste, Noël DUMOULIN et Thérèse, Désirée GHUELUY Frères et sœurs, donc enfants de Noël Dumoulin Marie, Philomène DUMOULIN Edouard, Jean, Baptiste DUMOULIN, décédé en bas âge. Pierre, Joseph, Edouard DUMOULIN Adolphine, Fidéline DUMOULIN, décédée en bas âge. Marie, Louise DUMOULIN, décédée en bas âge. Paul, Arthur DUMOULIN, décédé en bas âge. Ferdinand, Henri DUMOULIN Augustine DUMOULIN Jeanne, Zoé DUMOULIN Zoé Adolphine DUMOULINIl s’agit d’une famille de 10 enfants, mais 4 sont décédés en bas âge. Entre l’aînée Marie (1860) et la cadette Zoé (1884), 24 ans séparent les enfants.
Les données relevant de l'analyse, qui sont moins factuelles.
Les trois sœurs Dumoulin inscrivent leurs noms dans les carrières de Lezennes : Zoé la plus jeune, Jeanne son aînée, Augustine l'aînée de Jeanne. On les retrouve avec fréquence, notamment Zoé et Augustine. Elles sont parfois accompagnées de Ferdinand Dumoulin, grand frère d'Augustine et d’Henri Dumoulin, le grand-père. Ces descentes peuvent aussi bien être conjointes que séparées. Les graffitis sont éparpillés.
De la fratrie des 10 enfants, ce sont les quatre seuls enfants à inscrire leur nom. Les aînés pourraient ne pas descendre en cette période. Zoé Dumoulin ajoute son nom postérieurement, à côté du nom de son grand-père. Une seule et rare inscription, mais d'un seul scripteur, reprend les termes : 1983. Léonie Blandeau (nom sous réserves car dur à lire), Henri Dumoulin, Zoé Dumoulin, Louise Dumoulin.
La première chose qui interpelle, c'est l'âge des personnes.
Zoé descend à 18 ans. Augustine descend à 15 ans, à 17 ans, à 29 ans. Ferdinand descend à 16 ans, à 17 ans, à 19 ans. Fernand descend à 12 ans. Ferdinand Dumoulin descend conjointement avec Fernand Cuvelier. La même année, ce dernier se marie avec Zoé, à l'âge de ses 18 ans. D'autres graffitis évoquent 13 ans, 15 ans, 16 ans (deux fois). Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Lezennes, on descend jeune.La seconde chose qui interpelle, c'est qu'aucun ne se déclare barbeux. Le domicile des parents possédait-il un puits ? Ils habitent rue Faidherbe, aux 47-48. Donc tout est possible.
Zoé était domiciliée à la même adresse. Jeanne était domiciliée 1bis rue Victor Hugo. Cela se trouve aussi dans des zones de carrières, mais signalons tout de même qu'aucun Dumoulin, sauf Augustine, ne grave dans la pierre après mariage.

Peu avant son décès, Jeanne va déménager vers le 12 ter rue Chanzy.
La troisième chose qui interpelle, c'est qu'il s'agit d'une grande famille. Les Dumoulin sont liés aux Lefebvre, aux Cuvelier, aux Ghilluy, à Ducattillon, aux Deldalle. Certes les liens sont parfois quelque peu éloignés, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une grande famille. Les documents ci-dessous présentent (1) l'acte de naissance, (2) l'acte de mariage, (3) l'acte de décès s'il est disponible. Ces documents proviennent des recherches de Laurent Balloy.
Jean-Baptiste Dumoulin
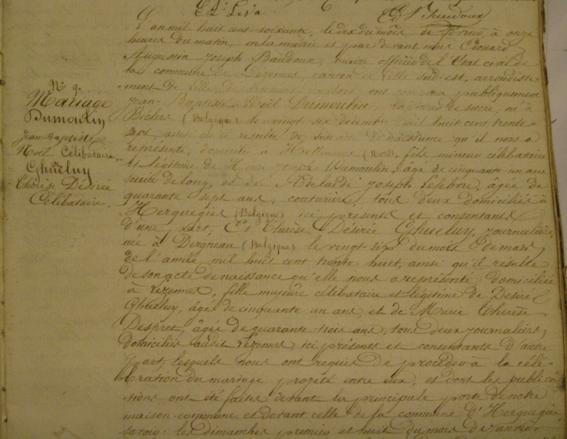
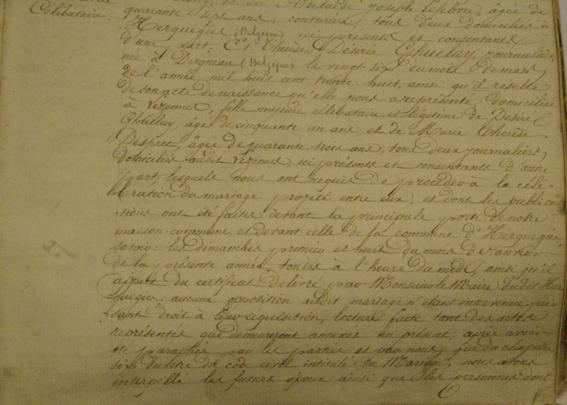
Son acte de mariage.
Augustine Dumoulin
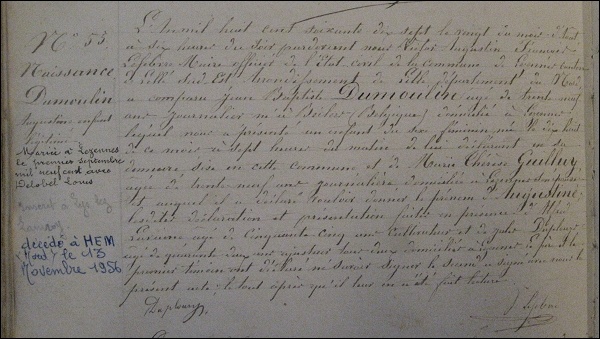
Son acte de naissance.
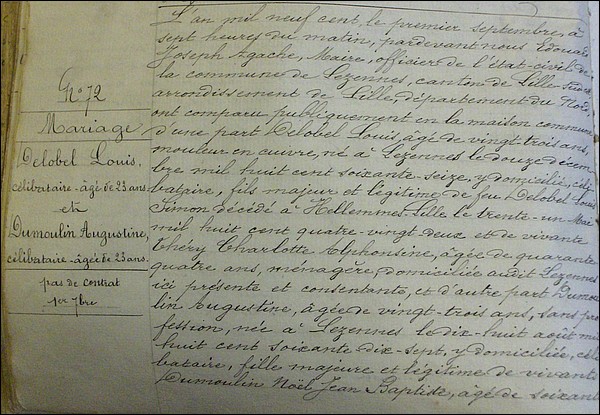
Son acte de
mariage.
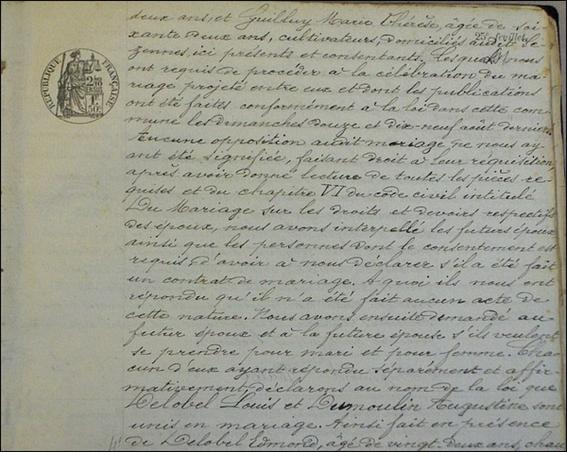
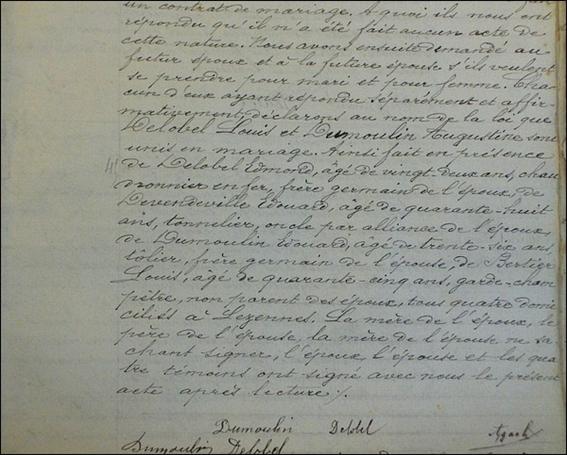
Jeanne Dumoulin
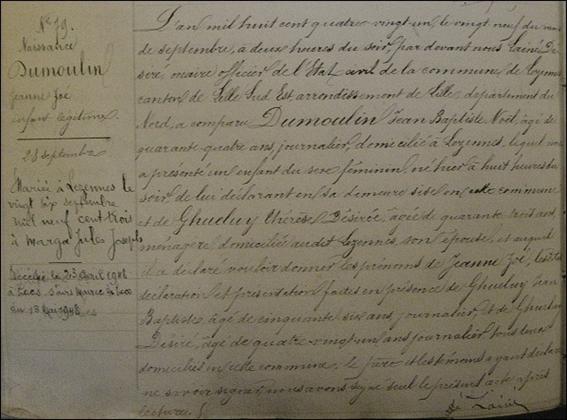
Son acte de naissance.
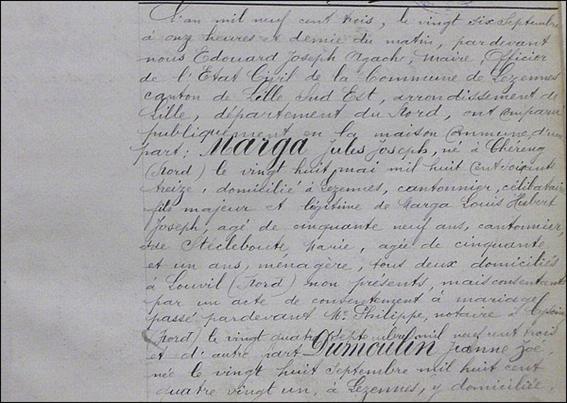
Son acte de mariage.
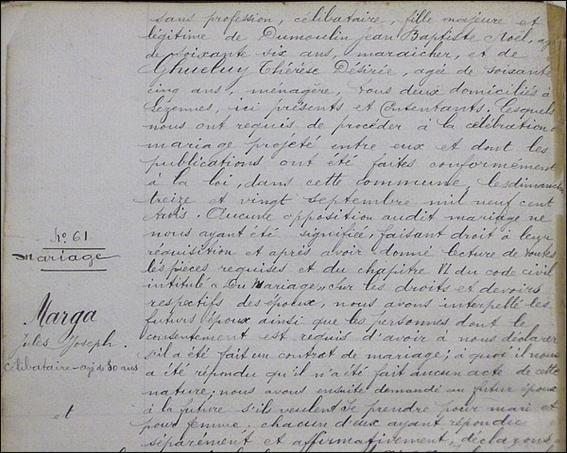
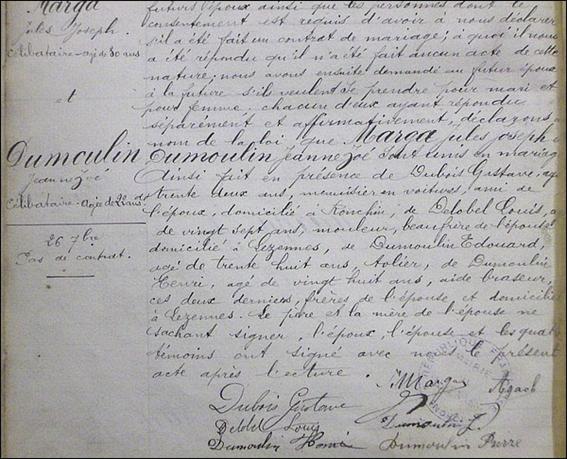
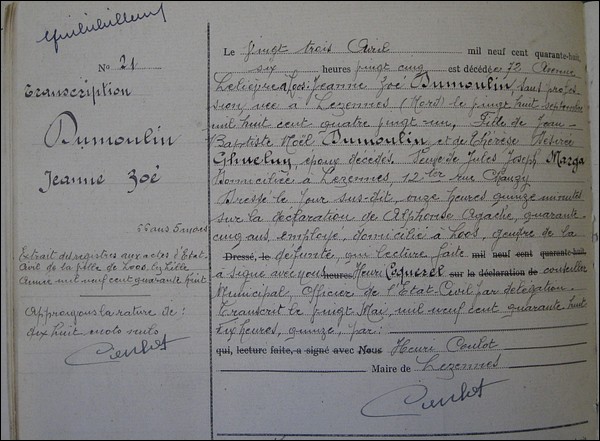
Son acte de décès.
Zoé Dumoulin
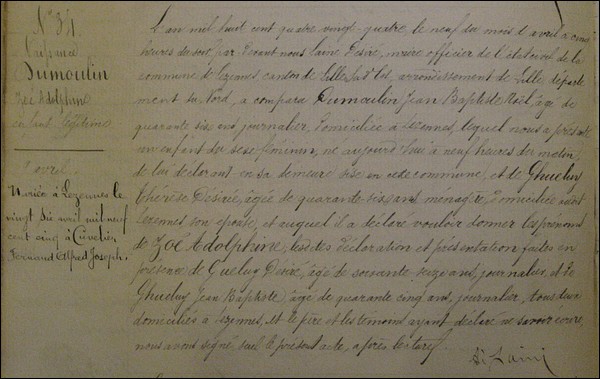
Son acte de naissance.
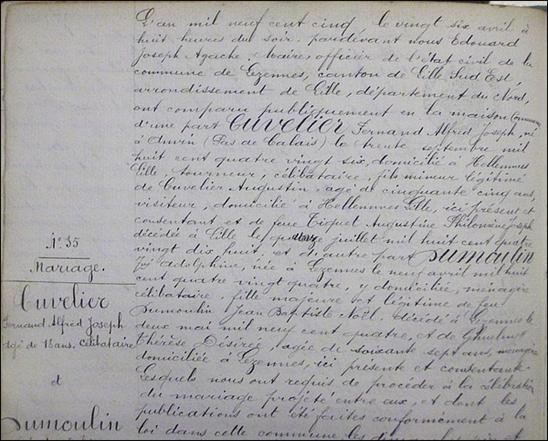
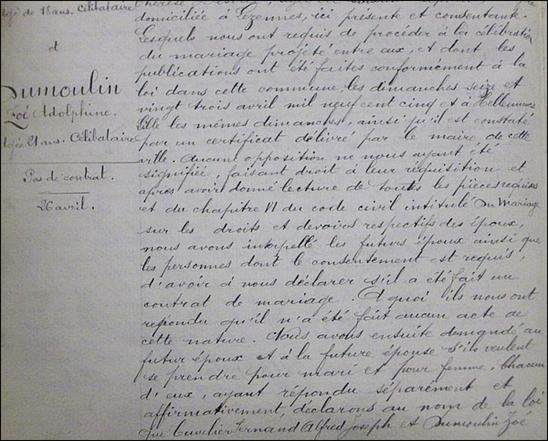
Son acte de mariage.
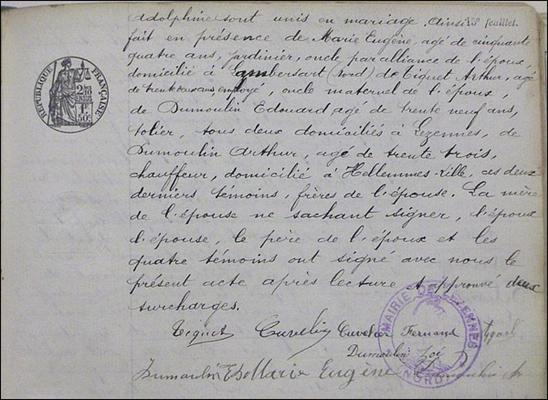
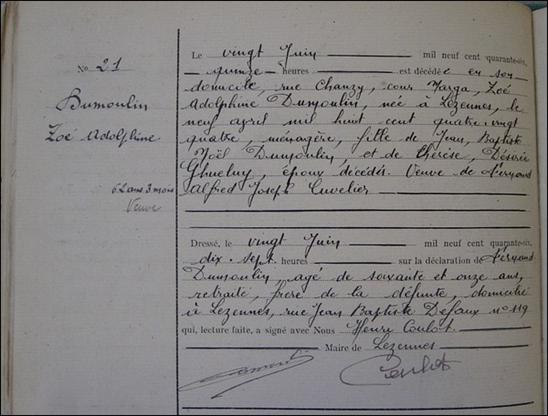
Son acte de décès.
Les recherches au sujet des Dumoulin
Au sein de la fratrie, il apparaît une différenciation assez nette entre les plus jeunes et les plus âgés. Disons plus factuellement que l’on ne retrouve pas les prénoms des âgés dans la carrière, même à des dates antérieures. Sur les 10 enfants, l’aînée Marie est née en 1860, la plus jeune Zoé est née en 1884. Il est clair que cela fait une grande différence.
Il est d’une évidente clarté que, dans un petit village comme Lezennes à l’époque, tout le monde se connaît, tout le monde est lié. Il ne faut pas donc considérer ça comme une évidente victoire que les Dumoulin soient alliés aux Lefebvre, que Ducattillon était de famille, etc. Au sujet d’Auguste Hayez, nulle trace ne le relie aux Dumoulin. Il est pourtant envisageable qu’ils se connaissent. Légèrement plus jeune, ils devaient simplement se connaître de vue, enfin cela n’est que supputation.
Ce qui ressort clairement des inscriptions, c’est que les trois filles Dumoulin sont très actives : Augustine, Jeanne et Zoé. On retrouve aussi, dans le sillon de Zoé, de nombreuses traces de son mari, Fernand Cuvelier, décédé fort jeune.
La plus active est Zoé. Au sujet de Zoé, elle se marie à 21 ans avec Fernand Cuvelier. Leur union sera brève, car Fernand décède 6 ans après. Il naît de leur union Noël Cuvelier et Arthur Cuvelier. Fernand décède en 1911 à l’âge de 25 ans, Noël en 1921 à l’âge de 16 ans, Arthur en 1927 à l’âge de 18 ans. Zoé reste seule, derrière la mort de toute sa famille. Il est dur de se dire que dans les inscriptions de Lezennes, elle était en ces années là joie et insouciance ; plus tard le destin ne l’épargnerait pas. Nous garderons d’elle cette image de légèreté. Elle habitait une petite maison deux façades, qui existe toujours, au 48 rue Faidherbe. Il est à penser qu’après tous ces décès, elle déménage. En effet, la maison de son mariage n’est plus citée dans son acte de décès. Elle décède « à son domicile » et en fait, la citation met clairement en exergue que c’est chez Jeanne, sa grande sœur. Elle décède à 62 ans, un an après la guerre.La plus discrète est Jeanne.
Au sujet de Jeanne, il faut préciser que les inscriptions de son prénom sont rares. Après, peut-être signait-elle simplement Dumoulin, sans prénom. Nous n’en savons rien. Elle est 3 ans plus âgée que Zoé. Elle se marie à 22 ans avec Jules Marga. Les deux sont enterrés au cimetière de Lezennes dans un caveau commun. Elle a pour enfants Marie et Jeanne, lesquelles décèdent aux âges canoniques respectifs de 90 et 88 ans. De Jules Marga, nous ne trouvons aucune inscription. Jeanne et sa famille logeaient rue Victor Hugo 1bis, un lieu que l’on retrouve parfois nommé Cour Marga. Jeanne décède à 66 ans à Loos. Elle était domiciliée rue Chanzy 12 ter.Les dates les plus précoces proviennent d’Augustine.
Pas étonnant car elle est l’aînée de la bande des trois. Elle est 6 ans plus âgée que Jeanne, 9 ans plus âgée que Zoé. Elle se marie à 23 ans avec Louis Delobel, dont nous ne retrouvons aucune trace en carrière. Elle donne naissance à Raymonde Delobel (1901-1986). Nous ne savons pas où la famille était domiciliée. La date de décès de son mari est inconnue. Tout au plus savons nous pour l’instant qu’elle décède en 1956 à Hem. Il semblerait qu’elle ait quitté Lezennes plus ou moins précocement. Au sujet d’Augustine finalement, nous ne savons pas grand-chose.Existe-t-il des chances de retrouver des descendants ? La réponse est non, malheureusement. Noël et Arthur Cuvelier décèdent très jeunes et sans succession. Marie et Jeanne Marga n’ont pas d’enfants. Raymonde Delobel n’a pas d’enfants. Cela limite beaucoup toutes les chances de bonne suite. Les autres branches nous rejettent immédiatement trop loin.
A l’époque Berthe Dumoulin (mariée Douvin) évoquait son grand-père Jean-Baptiste Dumoulin, mais Berthe est décédée en 1993.
Une famille de barbeux ?
Le mystère des Dumoulin restera complet comme on s’en doute, si ce n’est tout de même qu’une citation de Bernard Bivert vient apporter un grand trouble dans les éléments de recherches historiques. Selon les étudiants de MST Envar, « la graine de chicorée sauvage ou barbe de capucin aurait été apportée à Lezennes par un certain Monsieur Dumoulin, originaire deBelgique » qui fut le précurseur de cette activité culturale vers les années 1860. (Bivert, Sdics, 1988). La mairie de Lezennes confirme cette affirmation, sans la compléter.
Les parents d’Augustine, Jeanne et Zoé sont Thérèse et Jean-Baptiste Dumoulin.
Une chose indéniable que l’on peut dire, c’est que de par la branche maternelle et paternelle, les Dumoulin sont belges. Thérèse née Ghueluy et mariée Dumoulin, était originaire de Dergneau. Il s’agit d’un hameau de Frasnes-lez-Anvaing. Elle était mariée à Jean-Baptiste, Noël Dumoulin, que nous résumons à Jean-Baptiste Dumoulin. Au sujet de Jean-Baptiste, ce dernier est natif de Béclers, en Belgique de même. Il s’agit d’un hameau de Tournai. Nous avons donc indéniablement affaire à des belges installés à Lezennes.
1860
est une date d’activité qui correspond à une présence des parents sur Lezennes.
Marie, fille ainée, est née en 1860, à Lezennes. Le père, Jean-Baptiste, se
déclare à cette date à l’administration comme raffineur de sucre, journalier et
cultivateur. Faut-il entendre dans
« cultivateur » le fait de développer intensément de la barbe à capucins ?
C’est à la fois possible et difficile. Rien n’atteste à 100% cette version des
faits.
Les graffitis des Dumoulin sont concentrés au sein des souterrains de Lezennes. On les retrouve essentiellement dans le secteur de la Mer de Porcelaine. Était-ce le lieu de culture ? Tout cela soumet un certain nombre de questions où l’on a envie de répondre : oui, les Dumoulin étaient des barbeux. Ils étaient les inventeurs de la technique. En réalité, une réponse positive expliquerait beaucoup de choses, dont la concentration de signatures. Nous avons toujours pensé qu’il y avait une explication factuelle, mais laquelle ? Il nous parait nécessaire d’appliquer un certain principe de précaution. Dumoulin, ce n’est pas un nom rare. De ce fait, considérons le fait que les Dumoulin était barbeux comme une hypothèse non négligeable, mais restant toutefois à confirmer. A savoir que la barbe de capucin était, cela nous est signalé, aussi dénommée sous le joli nom de la « capucine des catiches ».
Les documents ci-dessous présentent la tombe qui fut retrouvée au cimetière de Lezennes : La tombe de Jeanne Dumoulin et de Jules Marga.


La seule descendante de la famille est la petite fille de Jeanne Dumoulin, mariée Marga et (donc) Jeanne Marga. Sa fille Marie-Thérèse Marga a eu une fille Cécile, Marguerite, Colette Agache. Cette dernière mariée Avec Maurice Tournel s’appelle (donc) Cécile Tournel. Elle habite à Vendin Lès Béthune. Elle n’a pas souhaité donner une suite favorable à notre appel téléphonique.
Autour des Dumoulin gravitent apparemment quelques personnes, si l’on en juge de la concentration de graffitis. Il s’agit des personnes listées ci-dessous :
* Zoé Deldalle, 1904. Née le 16 septembre 1886 à Lezennes. Décédée le 16 mars 1912 à Lezennes à l’âge de 25 ans. Mariée avec Georges Lagneau en 1908.
* Stanislas Ducattillon, né en 1860 à Péronne et décédé le 8 avril 1918 à Lille. Journalier.
Il se peut que ce soient des ouvriers barbeux.
Les champignonnistes
Ils nous sont extrêmement peu connus. Nous en identifions formellement deux, de par leurs inscriptions : Constant Cuvelier et Auguste Hayez.
* Constant Cuvelier. Il s’agit de Constantin, né à Meurchin, nous y reviendrons. Nous savons par inscription qu'il est champignonniste en 1847.
* Auguste Hayez, né en 1895 à Annappes, le 2 octobre 1895. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Lezennes (1914-1918) Décédé à Berny sur Santerre (80) le 14 octobre 1916. 2eme classe - 404e RI.
* César Hayez, né le 2 octobre 1874 à Cysoing et décédé le 16 février 1951 à Annappes.
* Un second César Hayez est le père d’Auguste Hayez. Il signe dans la carrière en 1824.On retrouve de nombreuses inscriptions Auguste Hayez dans de larges parts de la carrière. Il n’est pas lié à la famille des Dumoulin. Il est 9 ans plus jeune que la plus petite des Dumoulin, Zoé. Il grave toujours seul. Il naît à Annappes en 1895 et décède au combat en 1916, à l’âge de 21 ans. Une tombe Hayez est retrouvée au cimetière. Elle comporte le nom de deux Cesar Hayez (source de confusions), dont l’un est le père d’Auguste. Le nom d’Auguste n’est pas gravé sur la tombe, ce qui signifie malheureusement que l’infortuné est inhumé dans un cimetière de guerre, ou pire encore, disparu dans les terres du combat, en Santerre. Son nom figure sur le monument aux morts de Lezennes.
Un graffiti à Hellemmes nous apprend que le jeune Auguste Hayez est contremaître champignonniste. Il signe : Auguste Hayez, né à Annappes le 2 octobre 1895, âgé de 17 printemps le 9 janvier 1913, contremaître champignonniste. Dans la carrière d'Hellemmes Puy, on retrouve de nombreuses signatures César Hayez. Le pronostic est que la famille était champi de père en fils.


Trois champignonnistes complémentaires semblent être à relever : Désiré Morel, Louis Delecour, et François Delecour. Nous ne possédons pas de précisions à leur sujet.
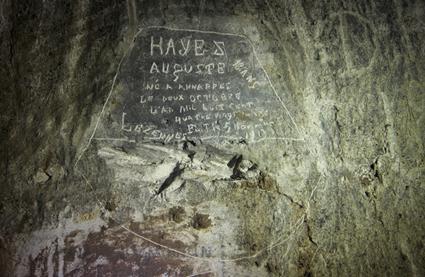
Les réfugiés et les inconnus
Les noms que nous relevons aux murs sont les suivants :* L. Picavez. Nous est inconnu. Ne semble pas être lié à l'allée Picavez de Lezennes.
* Richard Butin, âgé de 18 ans en 1904 d'après l'inscription. Le vrai nom est Richard Buttin, né le 17 juillet 1886 à Prémesques.
* Joséphine Butin. Nous est inconnue.
* Léon Marchand de Gondecourt, 1882, terrassier, d'après l'inscription. Léon, Valentin Marchand, né en 1851 à Gondecourt et décédé en 1913. Fils de François Marchand et Victoire Marchand née Fauquenois.
* Pierre Nisse, parfait inconnu.
* Louis Bléhaut, dont l’inscription nous dit : Louis Bléhaut, Laboureur, par Preux au Bois sur Landrecies, Nord, 1895. Il s'agit probablement du hameau La Rue du Bois, située sur la commune de Maroilles, et située à proximité de Landrecies. Il s’agit en tout cas de Louis Bléhaut, fils de Louis Bléhaut ! Le père est décédé le 20 mars 1887 à Preux au Bois. Du fils, nous savons qu’il est né en 1873. Il avait donc 22 ans lors de l’inscription.
* Noël et Emile Roelants le 12 septembre 1900
* Georges Frappart le 6 octobre 1914.
* Louis Choquel le 4 Xbre 1914.
* Robert Delattre en 1940.
Les Lefebvre, un véritable arbre généalogique en carrière.1880, dans l'ordre de la gravure.
A Lefebvre - Il s'agit d'Augustin Lefebvre, décédé le 27 mai 1818 à Ronchin, et marié avec Marie Brulois. Victor Lefebvre, son petit-fils, 1832-1898. Sophie Lefebvre, sa petite-fille, 1858-1919. Alexis Lefebvre, son fils, 1799-1876. Auguste Lefebvre, son petit-fils, 1864-1943. Marié avec Angèle Couplet. Enfants d'Eugénie Lefebvre, 1837, fille d'Alexis Lefebvre, 1799-1876. Eugénie Droulers, 1864-?. Marie Droulers, 1855-? Edmond Droulers, 1857-1924. Eugène Droulers, ?-?. Gabrielle Droulers, 1864-?.1914
Alexis Lefebvre, son petit-fils, 1861-?. Marié à Augustine Couplet, 1865-1939. Marie-Louise, sa fille, 1890-1918. Suzanne, sa fille, 1892-1975. Jean, son fils, 1896-1918. Pierre, son fils, 1898-1966. Marguerite, sa fille, 1900-1908. Gérard, son fils, 1906-1921. Auguste Lefebvre - Angèle Couplet > Reprise des deux précités (voir 1880). André, son fils, 1864-1975. Antoinette, sa fille, 1898-1976. Etienne, son fils, 1900-1998. Victor, son fils, 1902-1922. Thérèse, sa fille, 1906-1973. Joseph, son fils, 1909-1997. Signé Sophie Lefebvre (1858-1921).Autant les Deflandre sont une famille influente – presque écrasante – dans le Lezennes de la fin du XVIIIème siècle, autant la fin du XIXème siècle voit une présence influente des Lefebvre. Ils habitent en cette période là dans un lieu qui s’appelle la Ferme Lefebvre. A ce jour et moyennant des rénovations colossales, il s’agit de la nouvelle mairie. Les lieux sont encore appelés la Ferme Lefebvre parfois, ce qui témoigne bien de l’ancrage de cette toponymie. Les catiches situées sous la mairie sont obturées avec des dalles autoportantes.
Sous la nouvelle mairie se trouve un important monument, bien que le terme soit inadéquat. Il s’agit d’un vaste panneau gravé des noms de la famille Lefebvre. Cette famille s’était ménagé un accès à la carrière et gardait le lieu comme un refuge précieux face aux invasions ennemies (1870-1880).
En face se trouve un second panneau (1914) reprenant une série de noms cités supra, et peint à la peinture noire.
A
quelques pas de là, à l’arrière de la nouvelle mairie, plus précisément à
l’allée des blancs caillos, se trouve la chapelle de Sainte-Rita. Elle
mentionne une liste de réfugiés durant la guerre 14-18. Il s’agit des familles
: Lefebvre, Allart, Huyghe, Morel, Debuchy, Delerue, Demessine, Bernaert,
Deffrannes, Dorchies, Meurisse, Faux, Moreau, Caby, Grimonprez, Deneulin,
Pezin.
L’abbé Guidé (sous réserves).
Ces familles sont des noms connus dans Lezennes. Le manque de détail ne permet par contre pas de les identifier formellement. Plus loin dans la carrière, exactement le même cas de figure avec les familles Leturcq, Musy, Splingard.

Le tombeau de la famille Lefebvre, dans le cimetière de Lezennes.
Plus loin dans la carrière, des promeneurs cette fois-ci. A proximité de l’escalier de la rue Victor Hugo se trouve cette amusante inscription : Hoyaux Arthur, à l’âge de 3 ans, 1911. Il n’y a pas à dire, à Lezennes on descend sous terre jeune ! Il est né le 9 décembre 1908 à Lezennes et il habitait à cette époque rue Jean-Baptiste Defaux n°74. Ce n’est pas sous l’escalier ou à proximité. Ils ont donc bien promené sous terre.
Des signatures non datées : Henri Leroux et Cyprien Wilbeaux.
Cyprien Wilbeaux est né le 22 décembre 1890 à Gruson et décédé le 17 septembre 1914 à Pontavert. Il est décédé à 23 ans et pourrait avoir suivi un parcours comparable à Auguste Hayez, dès lors quasiment un compagnon d’infortune. Même topo concernant Henri Leroux. Né le 26 juillet 1892 à Lezennes et décédé le 6 septembre 1914 à Soizy aux Bois, à l’âge de 22 ans. Vu son métier d’ajusteur, il est à supposer qu’il était employé aux ateliers d’Hellemmes. Il y a donc quatre types d’inscriptions :* Les carriers, quasiment toutes disparues, ou seules les plus anciennes subsistent.
* Les barbeux, dont une famille supposée est influente.
* Les champignonnistes, probablement nombreux, mais assez discrets sur les murs, ou bien encore mal identifiés, ce qui reste possible.
* Les réfugiés et les visiteurs. Quand bien même leur écriture murale est récente dans l’histoire de la carrière, ce sont les groupes les plus mal identifiés. Peut-être cela s’accentue du fait que la mobilité géographique s’accélère.
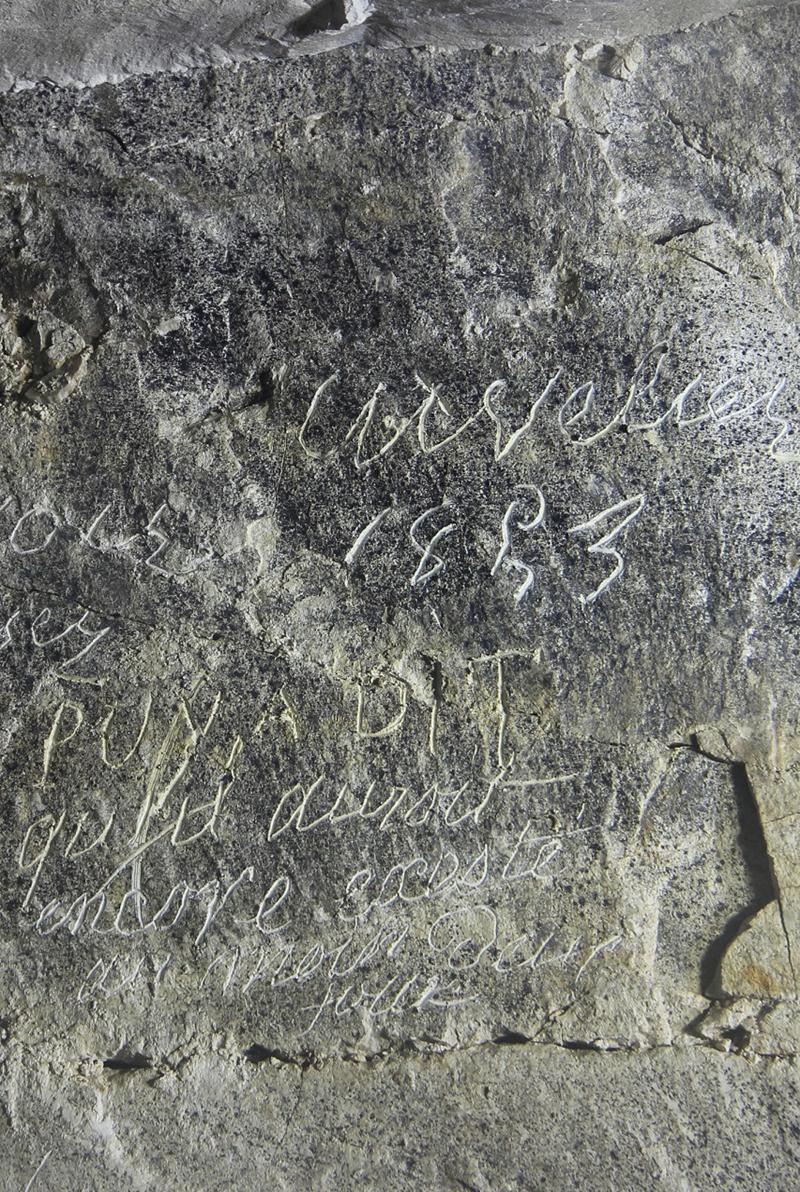
Lezennes-Hellemmes, la chambre de Monsieur Puy
Nous réalisons un complément généalogique au sujet des inscriptions existantes dans les souterrains de Lezennes et d’Hellemmes. Les pages précédentes sont le fruit des premières recherches que nous avons réalisées dans Lezennes. A cela doit s’ajouter deux découvertes, liées à des secteurs qui restent difficiles d’accès.
Le présent chapitre fait le point sur les inscriptions répertoriées en décembre 2015. Cette série d’investigation clôture « en principe » la collecte, à savoir que normalement, nous avons répertorié toutes les inscriptions. Il est évident qu’une exhaustivité est extrêmement difficile à prétendre – est-ce seulement possible ? Ainsi, nous donnons les précautions d’usage, précisant que bien des surprises peuvent encore se révéler à l’avenir.
Le documentaire se subdivise en deux grandes sections :
*
Les relevés complémentaires dans Hellemmes, la chambre de Monsieur Puy.
* Les relevés complémentaires dans Lezennes, secteur Trompe de Fallope.
Les chiffres (12 ou autre) entre parenthèses précèdent des noms de personnes importantes.

La chambre de Monsieur Puy
Hellemmes, la chambre de Monsieur Puy
Monsieur Puy était peut-être un champignonniste à Lezennes ; aussi il pouvait être un grand propriétaire. En tout état de cause, nous savons surtout qu’il s’agissait d’un restaurateur lillois. Monsieur Puy tenait son restaurant rue Anatole France à Lille nommé « Au Rocher de Cancale », célèbre pour ses fruits de mer. Il avait également une résidence à Lezennes.
Il s’est perdu dans le réseau souterrain le 10 janvier 1848. Il est resté 74 heures immobilisé dans le noir. Nous ne connaissons pas le détail quant à ce comptage d’heures, cela nous est simplement relaté sur les murs de la carrière. Charles Dickens a relaté le récit de la perte de ce pauvre homme, retrouvé après 3 jours de recherches. Au vu des plans que nous connaissons, nous constatons que Monsieur Puy a fait un très long parcours sous terre.
La chambre de Monsieur Puy est une dénomination que nous avons donnée aux lieux. Il s’agit d’une galerie dans laquelle l’infortuné s’est assis lorsque sa lumière s’est éteinte. Les parois des galeries possèdent une myriade d’écritures de nature très diverse. Nous en donnons l’inventaire suivant, tout d’abord les récits de retrouvailles, ensuite les signataires divers et variés.
Le témoignage des champignonnistes
PUY A ÉTÉE PERDU JEANVIER ET A ÉTÉE RETROUVER LE 13 DU MEME MOIS 1848. ADRIEN DEROO RETROUVER PAR PIERRE DEROO.
DEROO PUY A DIT QU’IL AURAIT ÉTÉ 2 JOUR.
AVOIR PASSEZ ICI 1848 CONSTANT CUVELIER ET EUGENE MONTALANT POUR CHRCEZ APRES M. PUY.
PUY A DIT QU’IL AURAIT ENCORE EXISTÉ AU MOINS DEUX JOUR.
PUY A PASSÉ 74 HEURS ICI PERDU TROUVÉ PAR DELEMAR 1848.
Ces inscriptions proviennent d’une confrérie de champignonnistes et de carriers partis à la recherche de l’infortuné. Nous pouvons attester que les intéressés signant sur les parois nous sont tous connus. Ils sont champignonnistes pour le plus grand essentiel. Signalons que nous ne relevons pas de signatures de barbeux, actifs à la même époque. Cela signifie-t-il que seuls les champignonnistes étaient partis en campagne ? Nous ne pouvons pas l’affirmer. Nous nous bornerons au simple constat que les champignonnistes d’époque furent investis.
Un récit d’époque retrace la mésaventure de la sorte : C'est dans ces vastes souterrains, qui n'ont pas moins de deux kilomètres carrés de développement et qui s'étendent sans discontinuité entre les villages de Lezennes et d'Hellemmes, qu'un restaurateur de Lille, le sieur Puy, s'est égaré en janvier 1848 et n'a été retrouvé que soixante douze heures après sa disparition. Cet homme fait un grand commerce de champignons qu'il cultive dans la partie des carrières la plus rapprochée du village de Lezennes. Il eut un jour l'imprudence de s'éloigner des galeries où il avait l'habitude de circuler, pour chercher de nouveaux emplacements propres à recevoir sa culture. Mais il fut bientôt désorienté, et après avoir marché longtemps il fut obligé de s'arrêter, faute de lumière. Nous fûmes chargé par le préfet d'alors, M. Desmouseaux de Givré, de diriger les recherches auxquelles on se livrait pour tâcher de découvrir le sieur Puy. On mit à notre disposition 115 hommes de la garnison, qui furent échelonnés suivant trois directions principales et qui munis chacun d'une lumière formaient autant de réverbères vivants éclairant les galeries jusqu'à une certaine distance et servant de repères aux diverses brigades de carriers et d'hommes de bonne volonté qui s'y rattachaient au moyen de ficelles. Nous n'oserions prétendre que ces dispositions déterminèrent la découverte du sieur Puy; mais elles eurent certainement pour effet de faciliter les explorations. Depuis cet événement, qui a mis en émoi toute la population, le sieur Puy à établi lui même une clôture pour isoler ses couches de champignons des espaces inconnus qui les environnent. On n'exécute d'ailleurs aucun travail d'exploitation dans ces carrières, qui sont abandonnées depuis longtemps et dont l'origine remonte à plusieurs siècles. Leur entrée devrait être fermée au moyen d'une porte dont la clef resterait entre les mains du maire de la commune, afin que personne ne pût y pénétrer sans que l'autorité n'en fut avertie.
Les inscriptions datent l’évènement : 10 janvier 1848 au 13 janvier 1848. Plus haut, Puy a signé au crayon. Nous ne savons pas si c’est postérieur à l’évènement.
Les individus signataires sont :
- Pierre Deroo.
- Adrien Deroo.
- Constant Cuvelier.
- Eugène Montalant.
- Delemar.
(1) Deroo Adrien. Il nous est connu par son acte de mariage, le 16 octobre 1826 à Lezennes, avec Dhennin Marie. Fils de Deroo François, carriéreur de profession, Adrien se déclare de même carriéreur. Lors de son mariage, il a 27 ans ; c’est écrit dans l’acte. Il est né le 18 du mois de Messidor, an septième de la république. La transcription est difficile à réaliser. Cela donne en principe le 6 juillet 1799. De par son mariage, il est affilié aux Morel et aux Delemar. Lors des évènements de Monsieur Puy, il avait ainsi 49 ans. C’est donc un homme d’expérience.
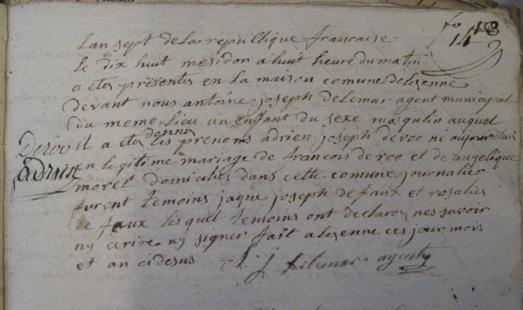
L’acte de naissance d’Adrien Deroo.
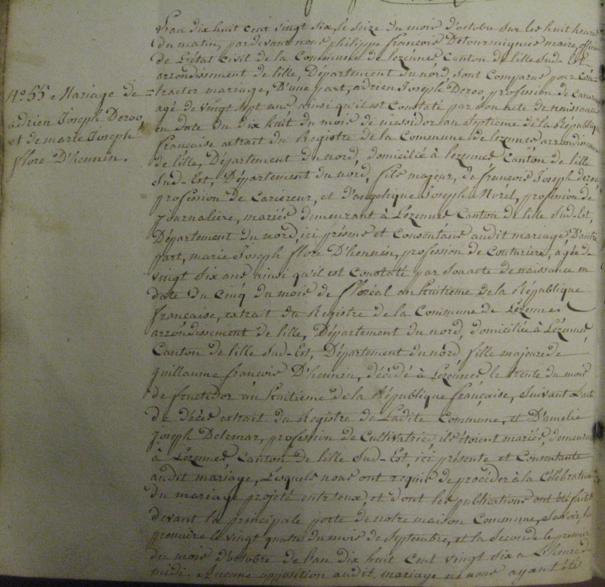
L’acte de mariage d’Adrien Deroo.
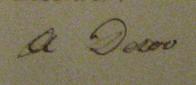
La signature d’Adrien Deroo.
(2) Deroo Pierre. Fils d’Adrien Deroo et de Flore Dhennin, né le 29 juin 1836 à Lezennes. Son réel prénom est Jean Louis Pierre Deroo. A l’acte de naissance était présent Auguste Joseph Levas, carriéreur de profession et âgé de 41 ans. Lors des évènements de Monsieur Puy, l’intéressé a 12 ans ! Autant dire qu’il était un promeneur.
Il est décédé le 19 juin 1914 à Lezennes et résidait à la rue Emile Zola.
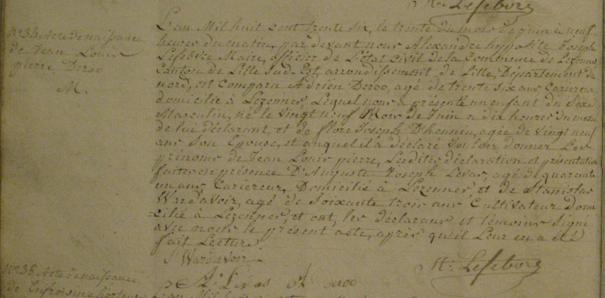
L’acte de naissance de Pierre Deroo.
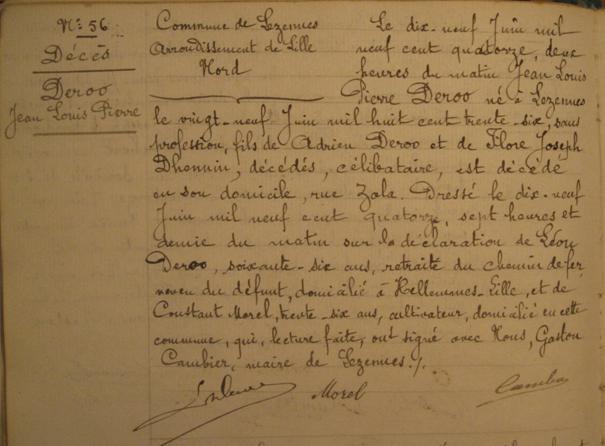
L’acte de décès de Pierre Deroo.
(3) Cuvelier Constant.
Il nait à Meurchin dans le Pas-de-Calais, c’est une grosse bourgade semi-industrielle au nord de Lens. Sa date de naissance est le 9 mars 1822. Il est le fils de Louis, Joseph Cuvelier et Hiacinthe Hocq. Il réside à Meurchin jusqu’à la date de son mariage. Il s’appelle en réalité Constantin, mais il signe systématiquement Constant.
A Lezennes le 16 avril 1849, il se marie avec Marie, Louise, Floride Dupont. Il s’empresse de déclarer une enfant hors-mariage, née plus ou moins un an avant. Le mariage s’est-il effectué sous une certaine pression ?
Il est champignonniste dans les carrières de Lezennes et Hellemmes. Il décède le 1er octobre 1866 à Meurchin, à l’âge de 44 ans.
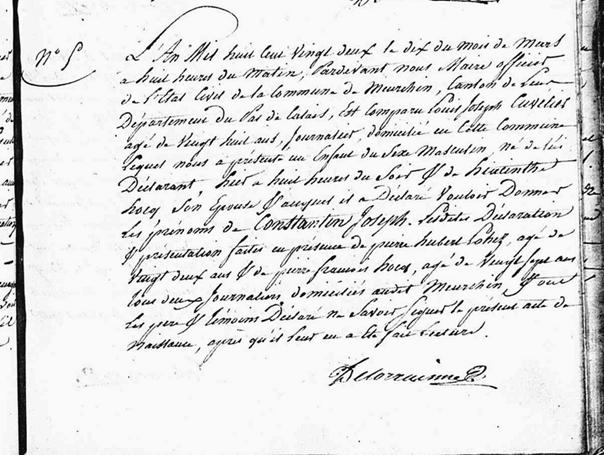
L’acte de naissance de Constantin Cuvelier (archives départementales du Pas-de-Calais).
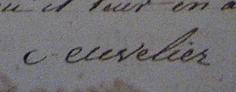 La signature supposée de Constant Cuvelier.
La signature supposée de Constant Cuvelier.
Celle-ci provient d’un acte où il est présent en tant que témoin, pour autant que nous n’ayons pas affaire à un homonyme, ce qui n’est pas chose acquise d’avance.
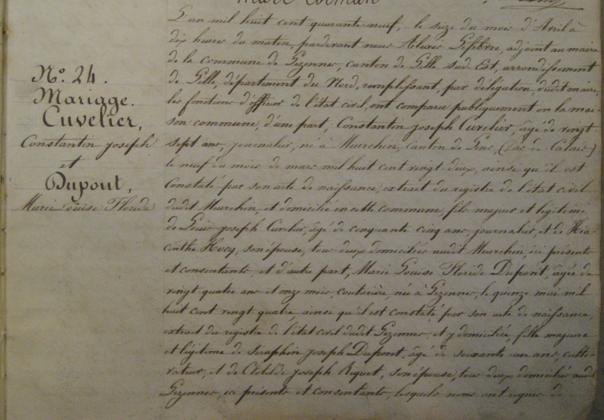
Son acte de mariage.
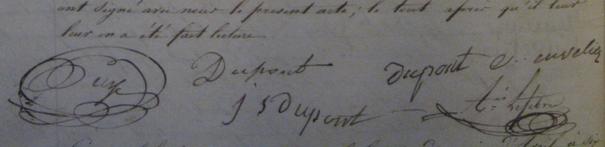
La fin de l’acte de mariage. On y voit avec perfection la signature de Monsieur Puy à gauche, renseigné comme restaurateur à Lille dans l’acte, et la signature de Cuvelier à droite.
Lors de la recherche de Monsieur Puy, Constant Cuvelier avait 26 ans.
(4) Montalant Eugène. Cette personne nous est relativement mal connue. De par l’acte de naissance de sa fille, nous savons qu’il s’appelle Alexandre Eugène Montalant. Lors de la naissance actée le 2 janvier 1849, il a 24 ans. Son nom est orthographié Montalon et son enfant s’appelle Marie Joseph Montalon. L’acte est réalisé en présence de Constantin Cuvelier, déclaré comme journalier. Dans un acte de 1849 au nom de Constentin Cuvelier (avec un E), l’individu est encore décrit comme journalier. De ce fait, nous ne pouvons échafauder aucune hypothèse. Cela signifie que lors de la recherche de Monsieur Puy, l’intéressé avait 23 ans.
(5) Delemar. Il se déclare comme étant la personne ayant trouvé Monsieur Puy. Sans prénom, nous ne pouvons pas préciser son identité. En effet, il existe plus de 100 actes à ce nom à Lezennes.
Monsieur Puy
La réponse tombe en tant qu’addendum, car oui Monsieur Puy a été retrouvé, après de très longues recherches pour nous aussi, sauf que nos recherches furent généalogiques et non à la lumière d’un flambeau ! Puy a étée retrouver par Cyrille Glorieus !
L’individu se nomme Etienne Puy.
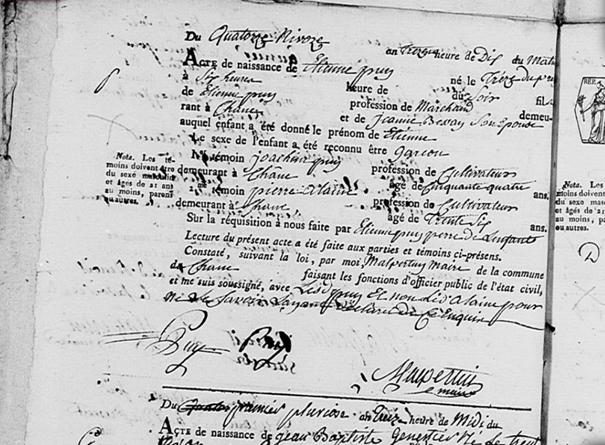
L’acte de naissance de Monsieur Puy.
Il est né le 14 nivose de l’an XIII de la République, soit le 4 janvier 1805. Il est né à Chânes en Saône-et-Loire, petit village du Mâconnais. Il est le fils d’Etienne Puy Senior et Jeanne Bessay. Vu le même nom, notre intéressé est Etienne Puy Junior. En 1836, lors du premier recensement de la population de Chânes, les intéressés sont déjà partis à Lille.
Il décède célibataire le 2 août 1864 à l’âge de 59 ans et demi. Son décès est constaté à la ville de Lille. Il résidait alors rue Saint-Nicolas n°26, un bel hôtel particulier dans le centre de Lille.
Cyrille Glorieus précise : Comme indiqué sur cet acte, Etienne Puy était propriétaire, 59 ans à son décès (donc 43 ans lors de sa mésaventure de 1848 à Lezennes). Son père Etienne, rentier, est aussi décédé à Lille le 28 mai 1843, et sa mère, « Dame » Jeanne Dessay, encore en vie (84 ans ! un bel âge pour l'époque). Sur tout le 19° siècle, Lille n'enregistre que 2 hommes au nom de « Puy » en décès : Etienne père en 1843, donc avant la Mésaventure de 1848 et à éliminer, et Etienne fils, qui semble correspondre à notre individu.
De plus, l'Etat-civil de l'époque retranscrit bien la mentalité de l'époque : les termes propriétaire, Dame, et même la formulation « où le père est décédé » (qui est plutôt exceptionnelle dans la tenue des registres, comparé à l'Etat-civil des classes ouvrières et moyennes où la formulation n'autorise pas ce genre d'écart), dénotent une volonté manifeste de l'Officier d'évoquer le défunt en terme élogieux, à l'image de sa « grandeur » de son vivant.
Or le récit à Lezennes se borne à ne le désigner que sous ce nom de « Monsieur Puy » ; j'en déduis que pour les Lezennois, ce propriétaire lillois représentait la belle bourgeoisie fortunée, et que la disparition d'un grand Monsieur de Lille dans les carrières allaient faire scandale en ville, en plus de l'inquiétude que son égarement avait causé. C'est pourquoi il n'a jamais été nommé par son prénom, en raison du respect que les gens observaient quant à un homme de « caste supérieure ».
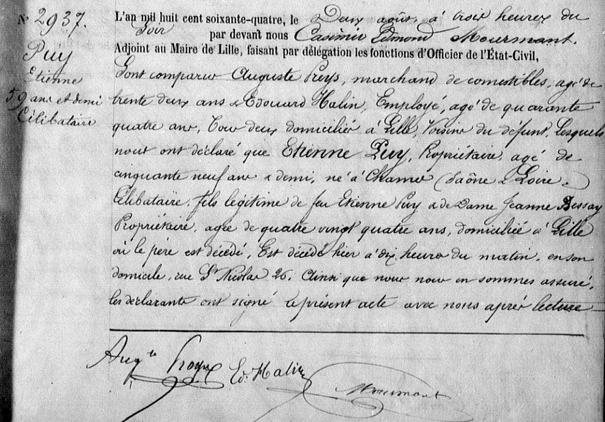
L’acte de décès de Monsieur Puy.
Puy aurait été domicilié à Lezennes à l'actuel 11 rue Ferrer, une sorte de grande maison en forme de ferme.
A ces inscriptions, de manière complémentaire nous relevons des personnages plus discrets, qui signent de même en 1848. Etaient-ils aussi à la recherche de Monsieur Puy ?
(6) (7) Josse Morel et Alfraide Lavoine 1848 et plus loin : Josse Morelle 1848.
Au sujet de Morel Josse, il existe un homonyme antérieur, donc les recherches sont à effectuer avec précautions. Il est né le 19 novembre 1800 à Lezennes, fils de Louis Morel. Il s’est marié le 23 janvier 1826 avec Louise Dujardin. Était en présence Adrien Deroo, cousin de l’époux. Cette information nous est intéressante car on comprend d’autant mieux sa présence dans les carrières. Lors de l’évènement de Monsieur Puy, l’intéressé avait 48 ans. Il est décédé le 10 janvier 1856 à l’âge de 55 ans.
Au sujet de Lavoine Alfred, nous avons peu d’information. Par l’acte de naissance de son enfant le 19 juin 1845, nous apprenons que l’intéressé s’appelle Louis Alfred Lavoine, âgé de 25 ans et exerçant la profession de journalier. Il serait donc né en 1820 et lors des évènements de Monsieur Puy, aurait 28 ans. L’épouse est Ursule Joseph Gilquin.
Précisons que l’intéressé ne sait pas signer son acte. Il est dès lors curieux qu’il signe sur les murs d’Hellemmes. Supposons que l’inscription a été réalisée par Josse Morel.
En tout état de cause, nous ne connaissons pas le détail quant à sa présence dans le souterrain, aucun membre de sa famille n’étant affilié à des champignonnistes ou des carriers. De ce fait, nous nous bornerons à le considérer comme un inconnu.
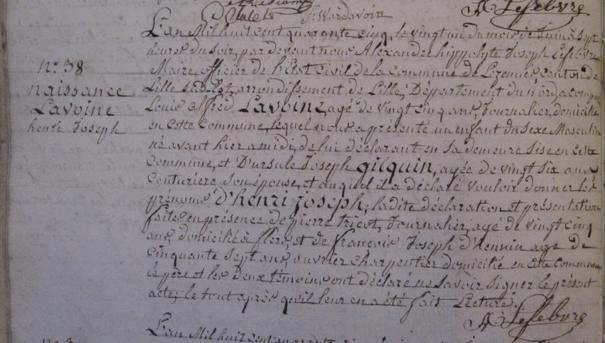
Un acte de naissance impliquant Alfred Lavoine.
(8) Caby Constant 1848. Il s’agit d’un non carrier que nous connaissons relativement bien, de par son mariage, ci-nommé Auguste Constant Caby, le 16 août 1853, avec Angélique Pérus. Il est né le 30 janvier 1825 à Templemars et décédé le 26 avril 1896 à Lezennes. Il se déclare comme charpentier. Lors des évènements de Monsieur Puy, l’intéressé avait 23 ans. Nous ne connaissons pas son implication dans le milieu carrier.
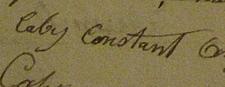
La signature de Constant Caby.
Nous ne localisons actuellement pas d’autres personnes parties à la recherche de Monsieur Puy.
Après, le recueil de toutes les inscriptions, d’une manière linéaire de gauche vers la droite, donne le relevé suivant :
BAILLEUL 20 8bre 1910 cheminot
Pauline Delebois & Jules 1908
Charles Loer
Poirier René au 161è de Ligne St Michel Souvenir des grèves 1910
Benoît BARBIEUX & Pierre DORDIN
A. MANTEAU
ROUILLON
HAYEZ Auguste né le 2 octobre 1891
Mme Dubus 1924 & Ed. Voet
H Deffrenne 9-2-1924
Lucienne
Auguste Manteau
CORNETTE
VANDENDOORNE CAMILLE 24 MAI 1914
Adèle Delobel 1924
PAREZ Roubaix
ALBERT CUVELIER
MIDAVAINE PAUL
Dubois Léon 12 avril 1894
Dubus 1924-10-2
Deffrenne 1924 Voet Paul 1924
MOREL Constant 1894
Hayez César 1894
HENNION 1926
HENNION Henri 1926
Jules GUIENNE 4-3-1926
Emilie PRUVOST 1911 a Hyppolite Achille Pruvost Jeanne Pruvost 1911
Alexie Ghilquin
Estelle Willem 9 février 1908
VATTIER
Hayez Cesar
P. Leroy
VASSEUR Dubus
Antoine Florentin Dubus
Cagnon Auguste 1906 Pas de Calais
Souvenir des grèves de 1910. E. Vasseur Adjudant 161.
GUSTAVE BATAILLE
ADÉLINE – POZEZ 1900
Lucien Berthelot 1953
BOORTE 1905
Jeanne PICAVET 1912
Les noms des fous sont partout
En une seule inscription :
Clémence Marescaux 1912
Zoé Marescaux 1912
Ennetières en Weppes
Marie Pruvost 1912
Julie Marescaux 1912
Ennetières en Weppes
Louise Marescaux 1912
En une seule inscription :
Ed Dubus
Mario 1924 Hellemmes
Souvenir du 10-2-1924
Edouard Dubus
VOET Paul 10-2-1924
Jeanne VOET 1924
VOET Edmond
Auguste MANTEAU
H . Deffrenne 1924
Nous allons regrouper et analyser ces inscriptions.
* 1891
(9) HAYEZ Auguste né le 2 octobre 1891 et non daté : (10) Hayez Cesar.
Il s’agit des champignonnistes du nom d’Hayez que nous connaissons bien, voir à ce titre le document concernant l’analyse de Lezennes.
* 1894
(11) Dubois Léon 12 avril 1894. Nous ignorons tout du personnage, lequel n’est pas un lezennois.
(12) MOREL Constant 1894.
Il s’agit possiblement de Constant Morel, né à Lezennes le 7 août 1878. L’intéressé aurait eu à la date de l’inscription l’âge de 16 ans. Nous penchons pour la bonne identification étant donné que le témoin de la naissance est François Deflandre et que celui-ci signe par ailleurs dans la carrière. Aucun membre de sa famille n’est connu comme étant carrier ou champi.
* 1905
BOORTE 1905 – Il y a une grande quantité de « Boorte » à Lezennes. Nous n’en savons pas plus, malheureusement.
* 1908
Pauline Delebois & Jules 1908 – Ils nous sont inconnus.
Estelle Willem 9 février 1908 – Il pourrait s’agir d’une personne originaire de Roubaix et née le 5 avril 1854. Nommée Estelle Julie Willem. Fille de Debeunne Victoire (quelquefois Debuenne), nationalité belge, domiciliée au n°43 rue du Chemin de Fer. Nous ne savons rien de plus à son sujet.
* Les grèves de 1910
BAILLEUL 20 8bre 1910 cheminot
Poirier René au 161è de Ligne St Michel Souvenir des grèves 1910
Souvenir des grèves de 1910. E. Vasseur Adjudant 161.
Il s’agit visiblement du 161e Régiment d'Infanterie de ligne. Il y a probablement eu un souci de lecture car a priori les troupes étaient situées à Saint-Mihiel. L’erreur est vite faite. Il s’agit éventuellement d’une référence à la grève des cheminots, brisée par Aristide Briand en mobilisant les grévistes. Nous aurions là des inscriptions SNCF, comme bien d’autres à ce titre.
Nous n’identifions pas les individus.
* 1911
Emilie PRUVOST 1911 Hyppolite Achille Pruvost Jeanne Pruvost 1911.
La seule chose que nous savons est qu’ils sont proches des Deroo (mais lesquels ?) et roubaisiens.
Les visiteurs de 1912
Clémence Marescaux 1912 Zoé Marescaux 1912 Ennetières en Weppes Marie Pruvost 1912 Julie Marescaux 1912 Ennetières en Weppes Louise Marescaux 1912 Jeanne PICAVET 1912
Les individus se déclarent provenir d’Ennetières-en-Weppes. Nous avons donc affaire à des voyageurs. Des Marescaux, nous recherchons Clémence, Zoé, Julie et Louise, ainsi que Marie Pruvost. Nous faisons un lien avec les noms précédents. Beaucoup d’indices laissent à penser que ces personnes sont originaires de Roubaix. Il en est de même pour Picavet Jeanne-Marie-Héloïse, née en 1870.
* 1914
VANDENDOORNE CAMILLE 24 MAI 1914.
Né le 18 février 1888 à Bachy. Probablement un promeneur. Le 24 est un dimanche. La guerre n’était pas encore déclarée, il ne s’agit donc pas d’un réfractaire.
* Les visiteurs de 1924
Mme
Dubus 1924 & Ed. Voet / H Deffrenne 9-2-1924 / Adèle Delobel 1924 /
Ed Dubus / Mario 1924 Hellemmes / Souvenir du 10-2-1924 / Edouard Dubus
/ VOET Paul 10-2-
1924 / Jeanne VOET 1924 / VOET Edmond / Auguste MANTEAU / H . Deffrenne
1924 / Deffrenne 1924 Voet Paul 1924 / Dubus 1924-10-2 / VASSEUR Dubus
/ Antoine Florentin Dubus / A. MANTEAU - Auguste Manteau.
Vaste inscription aux noms répétitifs. Le 10 février 1924 est un dimanche. Il s’agit à nouveau de personnes originaires de Roubaix et des promeneurs suspectés.
Delobel Adèle : Roubaix, mariée en 1910.
Voet Jeanne : Roubaix, mariée en 1915.
Dubus Edouard : Roubaix, marié en 1921.
Deffrenne Henri, Roubaix, marié en 1909.
Au final, on se rend compte que de nombreuses personnes viennent de Roubaix et semblent être liées aux ateliers SNCF.
* Les visiteurs de 1926
HENNION 1926 / HENNION Henri 1926 / Jules GUIENNE 4-3-1926.
A nouveau une provenance de Roubaix. Hennion Henri, né le 27 mai 1867, marié à Roubaix avec Roussel Flore le 6 août 1894, décédé le 11 septembre 1941. Il était chef ourdisseur. Ce métier a à voir avec les métiers à tisser.
Guienne Jules nous est inconnu.
* 1953
Lucien Berthelot 1953 – Un homonyme célèbre existe. Nous ne trouvons pas de trace d’individu du nom à Lezennes, Hellemmes et Roubaix.
* Non daté
Benoît BARBIEUX & Pierre DORDIN – Ils nous sont inconnus.
ALBERT CUVELIER – Il nous est inconnu.
MIDAVAINE PAUL – Il nous est inconnu.
GUSTAVE BATAILLE – Il nous est connu de par son acte de naissance, à Lezennes, le 1er octobre 1889. Décédé à Lezennes le 12 avril 1963.
Alexie Ghilquin
Dont la bonne orthographe est Alexis Gilquin, lezennois. Il s’agit d’un ouvrier carrier que nous identifions de par son mariage avec Charlotte Joseph Defaux le 3 juin 1850. Né le 6 novembre 1826 et décédé le 2 septembre 1857 à l’âge de 30 ans.
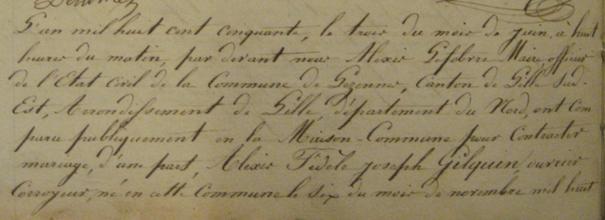
L’acte de mariage est ci-dessus, dans lequel il est identifié comme carroyeur.
A noter que lors de son mariage, l’intéressé ne sait pas signer. Aurait-il été
impliqué dans la recherche de Monsieur Puy, pour sa bonne connaissance de la
carrière ?
Une chose qui saute aux yeux, c’est qu’il y a beaucoup de passage entre 1900 et 1914. Après, une seconde pointe arrive en 1924 et 1926. Nous ne savons pas ce qui justifie ces passages. Les personnes sont en large part originaires de Roubaix. Nous supposons que la présence des ateliers SNCF n’est pas étrangère à cela.
Hellemmes, le Pavé du Moulin
Il y fut trouvé une petite pierre gravée du nom de DELOBEL Jea(…) Par chance, l’individu a été retrouvé de manière assez précise.
(13) Delobel Jean 1 – Né le 23 pluviose an XI et décédé le 24 mars 1872. Il se marie avec Marie Anne Joseph Constant le 23 novembre 1830.
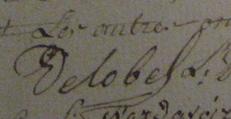
La signature de Jean Delobel.
Notons surtout que l’un des témoins du mariage est Jean Louis Levas, carrier à Lezennes que nous connaissons très bien de par sa propension à signer en grand tous les trois murs ! Signalons encore qu’il était voisin de Louis Levas. Il eut un fils : Delobel Jean II, décédé en bas-âge à 3 semaines.
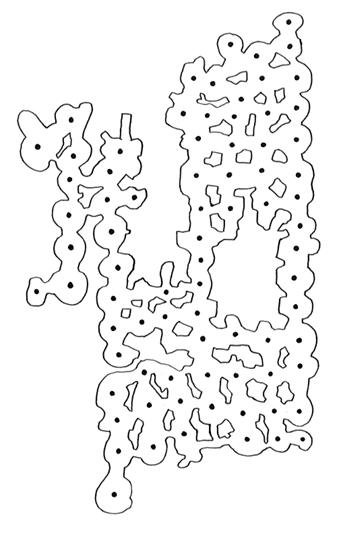
La carrière du Pavé Du Moulin
Lezennes, le secteur de la Trompe de Fallope
C’est un secteur difficile d’accès que nous avons réussi à rejoindre de manière tardive. C’est l’extrémité ouest des carrières de Lezennes. La Trompe de Fallope, galerie en tant que telle, a été creusée durant la seconde guerre mondiale ; l'étrange creusement du boyau s'explique par le fait qu'il y avait de la contrebande à l'époque, et l’on voulait relier des bâtiments de la rue Jean Jaurès directement aux carrières, ces dernières n'allant pas assez loin à l’ouest. Cette liaison fût rapidement établie, le boyau creusé légèrement sous le plancher de carrière, ce qui explique la présence d'un petit escalier en début du couloir côté Est. En analysant le plan, on s'aperçoit en effet que tout le secteur a été aménagé afin d’accueillir favorablement des réfugiés : parois bien droites et nettes.
La maison rouge-ocre aux encadrements verts du numéro 111 rue Jean Baptiste Defaux avait une descente aux carrières, aujourd'hui condamnée. Elle donnait sur le secteur Bout du Monde (sur le chemin vers la Trompe) – en bas, elle donne sur une belle allée d'anciennes cultures de champignons – et appartenait à M. Monnet, résistant durant la dernière guerre. Sa fille habite toujours Lezennes, mais plus cette maison.
Le recueil de toutes les inscriptions donne le relevé suivant :
BERTHE 1892
MARCEL ET GUSTAVE VAUBAN 1898
PAUL BRIENNE 1893
DESIRE LIAGRE 1883
BRIENNE CELINA 1882 ST MAURICE LEZENNES NORD 1895
Dennetiere Josephine 19 ans 190(…)
Mathilde
ARNOULD Juliette
VANDERSTEEN LAN 1900
Dessaint Jules 18 ans 1902
MEURICE 1892
WASSE 1930 BRIET
ANDRE 1943 XASTELIN
YVETTE
HENRI
CORALIE MATON
FORTRIE Louis 1827
PAUL DEFLANDRE 1899
VANTOMME 1874
LILY HENRY 8 FEVRIER 1914
Alexis Dubrulle 1900
ARNOULD 1899 (ou 1893)
SERGERAERT HENRI LAN 1895
Lefebvre Emile a était au (…) avec Florine Defaux 1890
LOVAT 1870
Doutrelong
Aimée Sauvage née le 26 octobre 1891
Hoyaux Arthur 1928
Derache Edouard 1896
SAUVAGE
1918 1er J
Nous allons reprendre chacune des inscriptions en effectuant un tri.
(14) 1847 LEVAS LOUIS Carrier Lezennes 1895.
Les recherches au sujet de cet important carrier ont été augmentées par Cyrille Glorieus.
Louis Levas est un personnage qui est longtemps resté totalement introuvable, du fait de la fréquence de son prénom. Nous pouvons aujourd’hui préciser qu’il s’agit de Jean Louis Joseph Levas (à ne pas confondre avec le prénom Jean-Louis, l’intéressé utilise bien ici son second prénom).
Il est né le 4 septembre 1838 à Lezennes, fils d’Auguste Joseph Levas (déclaré comme carriéreur) et de Séraphine Joseph Fayens. Un témoin en présence est Jacques Joseph Dufsart, âgé de 22 ans et déclaré comme caroyeur. Nous supposons simplement que c’est une trace d’une ancienne écriture et qu’il s’agit de Jacques Dussart (le nom est fréquent à Lezennes).
Il est décédé le 21 février 1909 à Lezennes, à l’âge de 70 ans et célibataire.
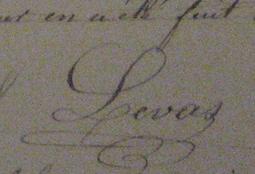
La signature de Louis Levas en 1872.
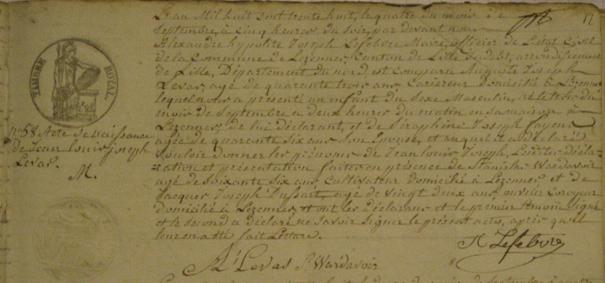
L’acte de naissance de Louis Levas.
Le père de Jean Louis Joseph Levas : Auguste Levas, était également carriéreur à Lezennes. Nous avons donc affaire à une lignée de carriers.
Vu la date très tardive des travaux de Louis Levas, nous émettons deux hypothèses, basées sur des appréciations entièrement personnelles.
- Soit il signait en tant que carrier honoraire, mais l’exploitation était cessée depuis longtemps.
- Soit il exploitait avec Roussel de faibles volumes, et il agissait en tant que petit indépendant, fournisseur de pierre auprès des particuliers. Rien ne s’oppose à cette particularité là.
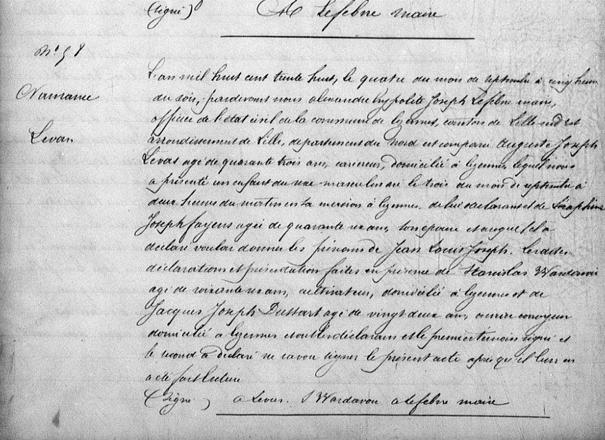
Une autre page d’acte concernant la naissance de Louis Levas.
A la fin de sa vie, il restait chez sa nièce Victorine Morel qui tenait un café rue Gambetta. Notons que (21) Victorine Morel nous est très bien connue comme étant barbeuse auprès des Dumoulin. Cependant, la Victorine Morel citée ici habitait au 155 rue Gambetta, née en 1865. Il s’agit d’un dangereux homonyme. (A noter, il y a encore un deuxième homonyme, piège !)
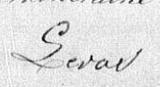
La signature de Louis Levas en 1859.
* LOVAT 1870
Nous pensons qu’il s’agit d’une variante orthographique du nom des Levas.
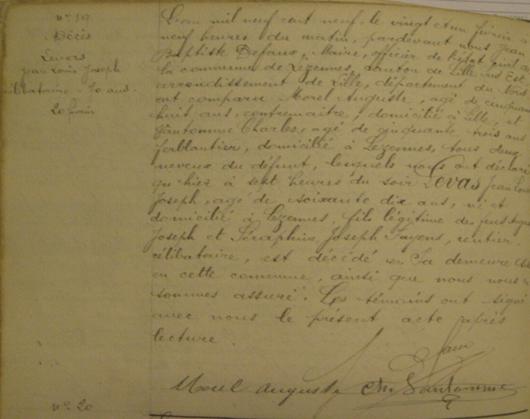
L’acte de décès de Louis Levas.
(15) Auguste Roussel
Il s’agit d’un compagnon carriéreur de Louis Levas, lequel se déclare provenir d’Audembert dans le Pas-de Calais. Il est resté longtemps totalement inconnu. Il a été retrouvé par Cyrille Glorieus.
Auguste Roussel, de son vrai nom Pierre François Augustin Roussel, est né dans le petit village d'Audembert, près de Wissant, sur la Côte d'Opale, le 15 avril 1820, fils de (Jean) Pierre et de Marie Séraphine Evrard.
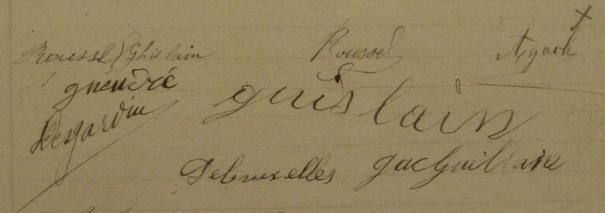
Au milieu en haut, la signature d’Auguste Roussel.
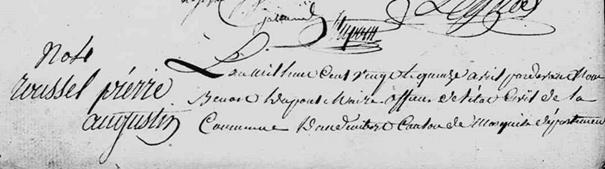
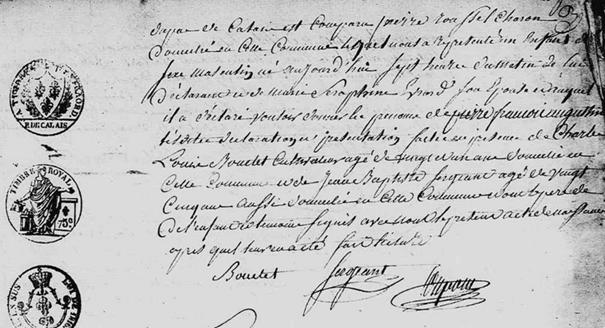
L’acte de naissance d’Auguste Roussel.
Charron, il se marie à Herbinghen le 7 novembre 1854 avec Marie Louise Joseph Julie Gueudre, dite « Julie ». A noter que la mère de Julie Gueudre est une Roussel (même famille ?)
Sans rentrer dans le détail des enfants, ils ont eu :
- Zénon Eustache Auguste, né à Licques le 3 février 1868
- Aimée Louise Alice, née à Licques le 13 décembre 1869
Zénon Roussel s'est marié à Lezennes le 14 octobre 1893 avec Elise Joseph Guislain. Ci-dessous, deux extraits de l’acte de mariage.
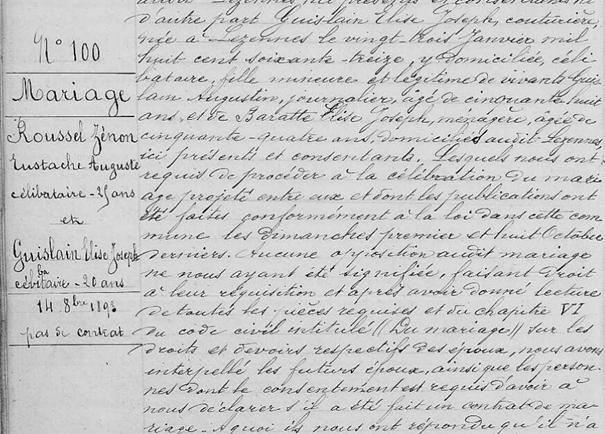
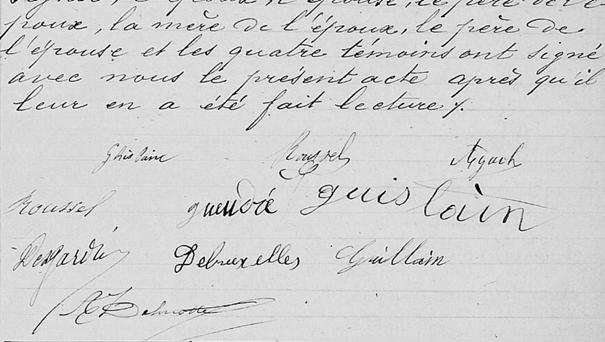
Dans les signatures, on reconnaît bien les tracés de leurs graffitis en carrières. La date de décès d’Auguste Roussel est pour le moment inconnue.
* FORTRIE Louis 1827
Nous trouvons des homonymes postérieurs à Lezennes, mais pas d’individu pouvant signer à cette date là. Le personnage nous restera donc inconnu.
* VANTOMME 1874
Il pourrait s’agir de Charles Vantomme, Lezennois, ferblantier, né le 21 janvier 1855. Il aurait alors 19 ans. Décédé le 3 août 1932.
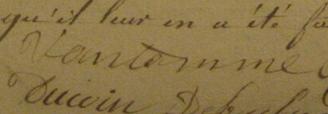
La signature de Charles Vantomme.
* DESIRE LIAGRE 1883
Bien que la date paraisse tardive, il pourrait s’agir d’un Faches-Thumesnilois connu par son acte de mariage le 10 juillet 1847. Serait né en 1824 et aurait 59 ans lors de l’inscription. Peintre en bâtiment, il n’a aucun rapport avec les carrières. Nous mettons en doute la bonne identification, bien qu’il soit le seul du nom et que les Liagre sont effectivement originaires de Faches.
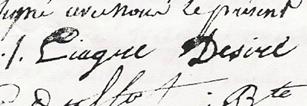
La signature de Désiré Liagre.
* Lefebvre Emile a était au (…) avec Florine Defaux 1890
Florine Defaux est née le 4 mars 1878 à Lezennes. Elle se marie le 2 janvier 1904 avec Benjamin Sarazin. Sa date de décès nous est inconnue. Lors de l’inscription, elle a 12 ans.
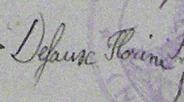
La signature de Florine Defaux.
Emile Lefebvre est probablement l’individu nommé Emile Lefebvre né Warambourg, le 22 juin 1877. Marié avec Léonie Pauline Delsambre le 25 septembre 1926. Décédé à Saint-André le 13 juillet 1949. Lors de l’inscription, il a 13 ans. Nous avons donc affaire à deux très jeunes individus. Décidément, on descendait jeune à Lezennes !
* Aimée Sauvage née le 26 octobre 1891
Cette inscription est fortement surprenante, car l’intéressée est effectivement lezennoise, mais elle est née le 26 octobre 1912. Il s’agit d’Aimée Augustine Sauvage, fille de Désiré Sauvage, originaire de Basècles en Belgique et de Hoyaux Léocadie. Mariée à Lezennes le 11 juin 1932 avec Gustave Mercier. Remariée deux fois et divorcée deux fois. Décédée à Sens le 4 janvier 2001.
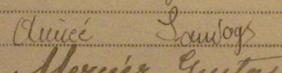
La signature d’Aimée Sauvage.
* MEURICE 1892 – Il nous est inconnu.
* PAUL BRIENNE 1893
Il s’agit de Paul Henri Brienne né à Lezennes le 26 janvier 1884, fils d’Henri Joseph Brienne, mouleur. Lors de l’inscription, il avait 9 ans ! Marié à Lille avec Marie Antoinette Debroing.
* BRIENNE CELINA 1882 ST MAURICE LEZENNES NORD 1895
Il s’agit de Célina Louise Brienne, fille d’Henri Joseph Brienne, mouleur et donc, sœur de Paul Brienne. De par son acte de mariage, nous savons qu’elle est née à Lille le 14 juillet 1882 (d’où nous l’analysons, l’inscription « 1882 Saint-Maurice » car il s’agit de son année de naissance et d’un quartier de Lille). Lezennes est en 1895, date de l’inscription, son lieu de résidence. Elle avait de ce fait 13 ans.
Elle se marie Avec Alexandre Jean-Baptiste Vandersteen le 19 septembre 1904. Signalons encore que nous relevons à deux pas de cette inscription une gravure : VANDERSTEEN LAN 1900.
Elle était domiciliée rue Léon Gambetta lors de son décès, survenu le 11 février 1916.
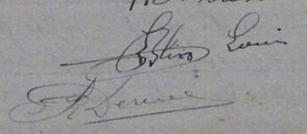
La signature de Célina Brienne.
* SERGERAERT HENRI LAN 1895
Il s’agit d’un dunkerquois né le 9 janvier 1861.
* Derache Edouard 1896
Il s’agit d’un lezennois né le 29 décembre 1879, âgé de 16 ans lors de l’inscription. Menuisier, fils de Derache Louis et de Willoqueaux Sidonie. Marié le 24 juin 1905 avec Baratte Céline. Décédé à une date qui nous est inconnue.
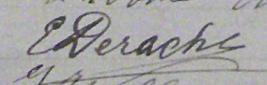 La signature d’Edouard Derache.
La signature d’Edouard Derache.
* MARCEL ET GUSTAVE VAUBAN 1898
Seul Gustave Vauban nous est connu, de par son acte de mariage le 26 octobre 1895. Il s’agit d’un lezennois qui à la date de son mariage est ajusteur, né à Hellemmes le 11 février 1869. Il a 29 ans lors de l’inscription et nous le devinons comme étant ouvrier aux ateliers SNCF. Il a un frère du nom de Vauban Jules, mais aucun Marcel ne nous est connu.
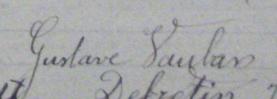 La signature de Gustave Vauban.
La signature de Gustave Vauban.
* PAUL DEFLANDRE 1899
Quantité de Deflandre sont connus sur le territoire de Lezennes et dès lors, l’identification est problématique. Il pourrait s’agir de Deflandre Paul Napoléon Joseph né le 11 mai 1862 ou bien Deflandre Paul né le 10 mars 1865.
* ARNOULD 1899 (ou 1893) - Il y a quantité de personnes au nom d’Arnould à Lezennes.
* 1900
ADÉLINE – POZEZ 1900
Il s’agit d’Adéline Posez, née le 13 mars 1884, fille de Louis Nicolas Posez et Florentine Thibaut. Vu le métier de son père : ajusteur et l’âge de l’intéressée : 16 ans, nous pouvons supposer qu’il s’agit d’une visite réalisée depuis les ateliers SNCF. Elle s’est mariée le 30 mars 1907 avec Charles Balloy. Elle était à ce moment mécanicienne et son mari chaudronnier.
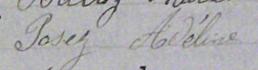 La signature d’Adéline Posez, où l’on voit bien le É.
La signature d’Adéline Posez, où l’on voit bien le É.
(16) Dennetiere Joséphine 19 ans 190(…)
Née à Lezennes le 21 octobre 1883, couturière, fille de Dennetière Pierre François. Vu sa date de naissance, l’année d’inscription pourrait être 1902. Mariée le 12 avril 1905 avec Lefebvre Paul, tourneur. Divorcée le 5 avril 1924. Décédée à une date nous étant inconnue.
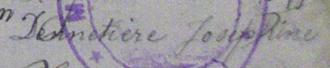 La signature de Joséphine Dennetière.
La signature de Joséphine Dennetière.
* Alexis Dubrulle 1900
Né à Lezennes le 29 juillet 1880, marchand de légumes en 1905, fils de Dubrulle Désiré, rentier. Marié le 27 décembre 1905 avec Arnould Marie Justine Julia, éventuellement la signataire de l’inscription ARNOULD 1899. Décédé le 30 novembre 1944. Il était alors domicilié au 115 rue Jean-Baptiste Defaux.
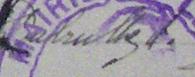 La signature d’Alexis Dubrulle.
La signature d’Alexis Dubrulle.
* Dessaint Jules 18 ans 1902
Il y a plusieurs Jules Dessaint à Lezennes. De par l’inscription, nous le supposons né en 1884. Aucun acte ne correspond de près ou de loin à cela.
* LILY HENRY 8 FEVRIER 1914
Il n’existe personne du nom à Lezennes ni dans le Nord.
* SAUVAGE 1918 1er J
Il s’agit éventuellement de Désiré Sauvage.
* WASSE 1930 BRIET
Les Briet sont nombreux et ne correspondent pas à des lezennois. Les Wasse sont inconnus.
* ANDRE 1943 CASTELIN
André Castelin, lezennois, né au n°44 de la rue Chanzy le 21 septembre 1929. Marié à Marcq en Baroeul le 3 août 1963, avec Danièle Descatoire.
* ARNOULD Juliette
Cette inscription sans date ne nous permet pas de localiser la personne. Il s’agit éventuellement du diminutif d’Arnould Julie, née le 24 janvier 1884 à Lezennes.
* CORALIE MATON
Il existe bien des Maton à Lezennes, mais le prénom le plus proche est Caroline.
Lezennes, le secteur Chatelet
* MANGEZ DESIRE AGE DE 13 ANS ½ / MARIE THERESE (…) AGEE DE 13 ANS / HENRI LETURCQ Agé de 17 AN
Mangez Désiré pourrait correspondre à Henri Charles Désiré Mangez, seclinois né le 5 août 1852. Henri Leturcq pourrait être le lezennois qui est né le 7 mai 1893. Nous nous bornerons à dire, vu les incertitudes, que nous n’identifions pas ces personnes.
* Secteur Mairie : GUSTAVE RENARD - Il n’est pas identifié.

Le mur du trésor des Barbeuses
* Le mur du trésor des barbeuses
Il s’agit d’un étrange murage, bloquant nous le supposons des remblais (mais aussi pourquoi pas le fabuleux trésor des Dumoulin !). Il fut remarqué que de nombreuses pierres sont gravées de noms, d’où notre attention portée sur l’élément architectural. Nous relevons les noms suivants :
GUICHARD 1901 / JOSEPHINE 19 ANS 1902 / JOSEPHINE 19 ans 1882 / ZOE DUMOULIN 20 ANS 1904 / BARATTE MATHILDE 18 ANS 1904 / DELDALLE ZOE 18 ANS 1904 / DENNETIERE (…) / VICTORINE MOREL 16 ANS 190(…) / DELDALLE ZOE 16 ANS 190(…)
Au vu de notre expérience, nous estimons qu’il s’agit des noms des barbeuses faisant partie de la famille et de l’équipe de Noël Dumoulin. A ce titre, bien des noms nous sont déjà très bien connus, voir le documentaire sur Lezennes.
Au sujet des années, nous estimons qu’il ne s’agit pas – comme d’habitude dirons-nous – des datations des inscriptions. Nous estimons qu’il s’agit des dates de début d’activité dans les parcs à barbe. Cette supposition est basée sur un seul (vague) indice : Zoé Deldalle écrit toujours avec un tournevis à tête large, tandis qu’ici, c’est la seule inscription de tout le réseau lezennois faite au couteau. Perturbant ! L’écriture est belle, ça a été écrit pour elle.
(17) Guichard. - A Lezennes, les intéressées du nom sont trois. Il peut s’agir de Sophie (n. 1867), Julia (n. 1870), Marie (n. 1873). Aucun indice ne nous permet d’en dire plus. Domiciliées au 18 Passage d’Hennin, signalons qu’ils sont voisins des Dumoulin.
(16) Joséphine 19 ans en 1902, nous supposons fortement qu’il s’agit de Joséphine Dennetière (voir précitée à la trompe de Fallope vu l’écriture similaire).
(18) Zoé Dumoulin nous est très bien connue.
(19) Zoé Deldalle nous est aussi très bien connue. Elle est née le 16 septembre 1886. Elle aurait donc inscrit son nom en 1902. Assez étrangement lors de son mariage en 1908, elle se déclare en tant que mécanicienne. A ce titre, nous n’avons jamais localisé dans les actes de profession « barbeux » ; il est probable que ça n’existe pas. Elle était domiciliée rue Faidherbe n°13 à Lezennes.
Cette pauvre Zoé Deldalle a perdu son père en 1907 et sa mère, Duwer Catherine Joséphine n’était pas présente à son mariage. Zoé Deldalle est décédée le 16 mars 1912 à l’âge de 25 ans.
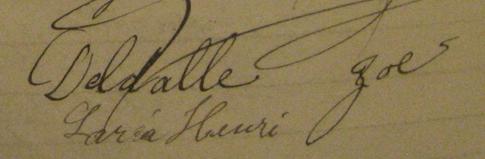
La signature de Zoé Deldalle.
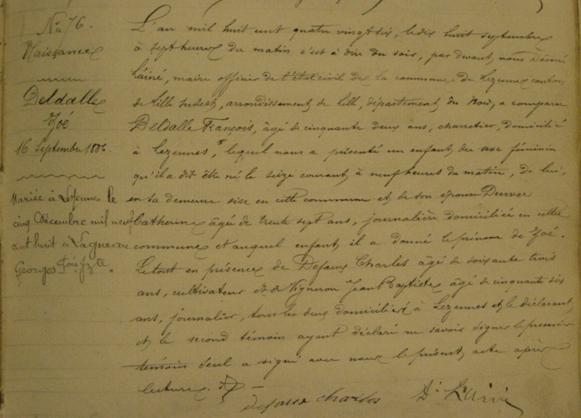
L’acte de naissance de Zoé Deldalle et ci-dessous page suivante, son acte de décès.
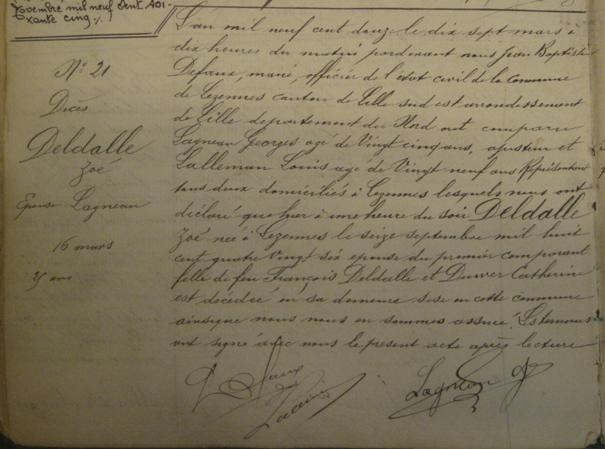
(20) Mathilde Baratte, 18 ans en 1904.
Nous la connaissons très bien étant donné qu’elle est la femme de Fernand Dumoulin.
Mathilde Julie Célanie Baratte, née le 18 février 1890 à Auchy (précisons d’emblée que la date 1904 ou l’âge 18 ans ne conviennent pas). Déclarée comme mécanicienne lors de son mariage, célébré le 7 septembre 1908. Décédée le 4 février 1916. A son décès, Fernand Dumoulin est déclaré comme étant polisseur.
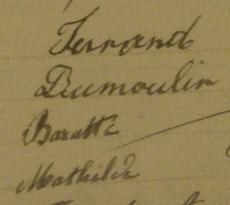 Les signatures de Fernand Dumoulin et Mathilde Baratte.
Les signatures de Fernand Dumoulin et Mathilde Baratte.
(21) Victorine Morel, 16 ans en 190x.
Elle nous est bien connue. Elle est née le 11 mai 1886 et l’inscription serait datée 1902. Lezennoise, fille de Morel Henri Joseph et de Delos Marie. Elle se marie le 3 septembre 1910 avec Hanicot Gabriel Félix. A cette date, elle se déclare en tant que mécanicienne. Décédée à Lezennes le 25 février 1960.
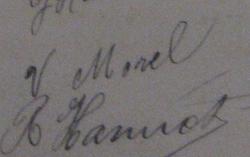 La signature de Victorine Morel.
La signature de Victorine Morel.
Notons qu’une inscription dans le secteur Mer de Porcelaine donne ce titre : Victorine Morel 15 ans. Elle a donc commencé à travailler tôt.
De manière complémentaire, nous relevons les noms suivants dans divers endroits de la carrière :
Valtier, capitaine
Rocq a Dolph a Peronne 1894
Derache Doutrelong 1792
4ème classe E. Parent 1894
Dumoulin Louise âgée de 18 ans 1888
Huvenne Adélaïde âgée de 20 ans 1896
Augustine Dumoulin 17 ans 1894
Secteur de l’inscription médiévale :
Marie Longuépée
Edouard Morel
Desmons
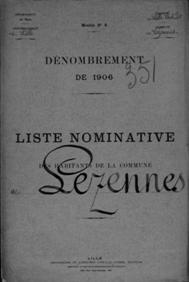
Le recensement de 1906
Recherches complétées par Cyrille Glorieus.
Il s’agit des recensements de la population. Seul le registre de 1906 a été numérisé par les archives départementales du Nord. C’est peu mais c’est déjà beaucoup pour nous car nous retrouvons nombre de nos petits artistes du dessous-terre.
Dans le recensement de 1906 à Lezennes, un individu nommé Eloi Lefèbvre, né en 1849, se déclare comme étant champignonniste chez Crombet à Thumesnil.
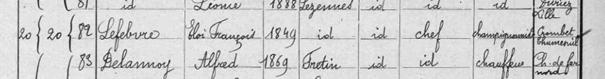
César Hayez est déclaré patron champignonniste à Lezennes, avec sa femme Clara Baron et leur fils Auguste, au numéro 27 de la rue Faidherbe.
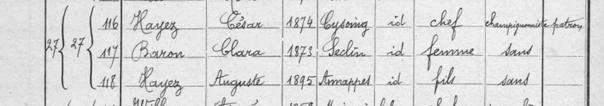
Au 31 de la rue Faidherbe, nous avons les Deldalle. Louis est journalier chez Crombet à Thumesnil. Zoé travaillait comme mécanicienne à Grimonprez à Lille.
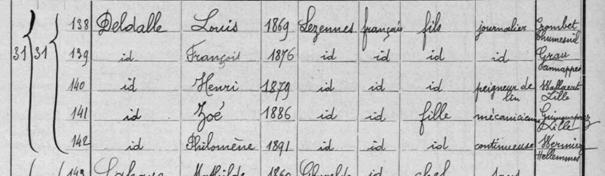
Dans le voisinage, aux 47 et 48 rue Faidherbe se trouve la famille Dumoulin. Il y a eu une séparation du bien. Au n°47 se trouvent les parents et au n°48 habite Zoé. En 1906, Zoé habite avec son mari Fernand Cuvelier. Leur jeune enfant Noël Cuvelier est présent.
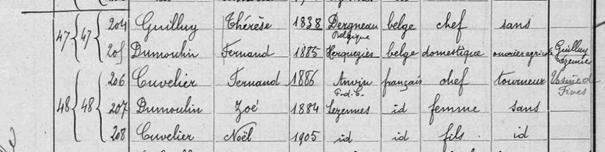
Les Dumoulin possédaient leur escalier de descente aux carrières. Ce lieu existe toujours. Il est marqué à la peinture noire de champignonniste DESCENTE DUMOULIN. Cette galerie est située au sentier de Seclin, près de la rue Gambetta. Cette descenderie est comblée à ce jour.
La localisation de cet accès pose de grandes questions, car c'est éloigné de 400 mètres de l'habitation des Dumoulin, à 500 mètres du secteur d'exploitation des parcs à barbes ; considérant de surcroît que les parcs à barbes sont éloignés de 100 mètres de leur domicile. Nous supposons qu'il était fort difficile d'avoir un accès, ce qui est compréhensible, et que les aspects de propriété des différents exploitants ont eu un rôle prépondérant.
Au niveau du 1bis rue Victor Hugo habitent Jeanne Dumoulin et Jules Marga. Grande sœur de Zoé Dumoulin, ils ont quitté la maison familiale.
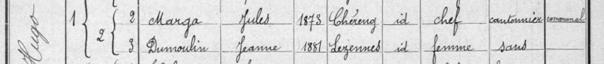
Au numéro 51 rue Faidherbe, Augustine Dumoulin. Elle est domiciliée avec son mari Louis Delobel. Leur jeune enfant Raymonde Delobel est présente.
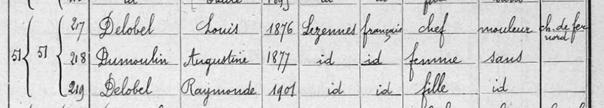
Au numéro 31 rue Chanzy, Jean-Baptiste Flinoy, employé chez Crombet à Thumesnil.
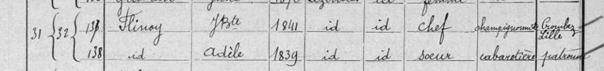
Au numéro 42 rue Chanzy, le fameux Stanislas Ducatillon, dont l’inscription se trouve rue Pasteur. Il est aussi champignonniste à Crombet.
![]()
Au numéro 57 rue Chanzy, Jean-Baptiste Dumoulin, champignonniste chez Crombet à Thumesnil. Nous ne lui connaissons pas de lien avec « nos » Dumoulin.
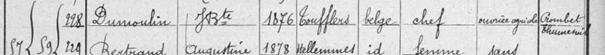
Au numéro 139 de la rue Léon Gambetta, La famille Hespel, dont l’inscription de Louis se trouve au beau milieu du réseau d’Hellemmes.
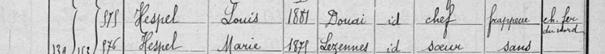
Au 61 rue Faidherbe, Victorine Morel, qui fait partie de l’équipe des Dumoulin. De même que Zoé Deldalle, elle travaillait comme mécanicienne à Grimonprez à Lille. Les deux sont nées en 1886. Comment ne pas déduire une amitié évidente ?
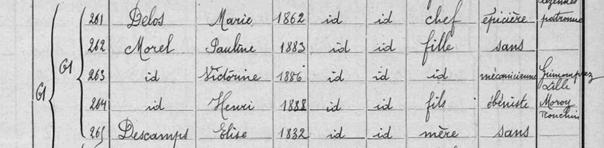
Au numéro 4 Cour Delerue, Heras Emile, Champignonniste chez Crombet à Faches-Thumesnil.
![]()
Gustave Vauban habite au 77 de la rue Gambetta. Notons la présence d’Edouard Risbourg, dont un (médiocre) graffiti orne les carrières.
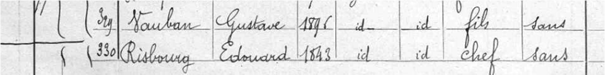
Louis Bléhaut, qui a signé au cœur du réseau d’Hellemmes, habite au hameau de l’Arsenal.
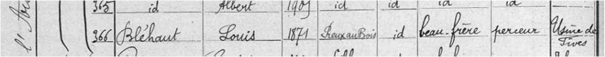
Nous retrouvons le carrier Pierre Deroo au 38 rue de Sainghin à Lezennes. Quelle étrange chose car il était domicilié rue Emile Zola à son décès. A ce titre, précisons que la rue de Sainghin à Lezennes est aujourd’hui la rue Ferrer.
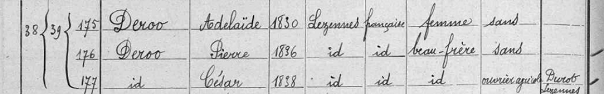
Alexis Dubrulle est localisé, 54 rue de Sainghin. C’est un simple visiteur des carrières.
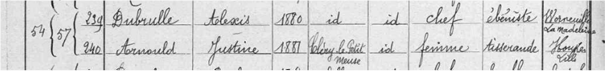
Joséphine Dennetière, visiteuse des carrières, est localisée au 61 rue de Sainghin au sein d’une large fratrie de Lefebvre.
![]()
Mathilde Baratte, ouvrière des Dumoulin, est localisée place de la République au n°10. Elle fait partie d’une large fratrie de Baratte.
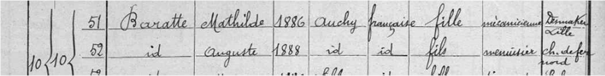
Henri Leturcq, qui signe on ne sait trop pourquoi à 17 ans, est domicilié au 11 rue Chanzy.
![]()
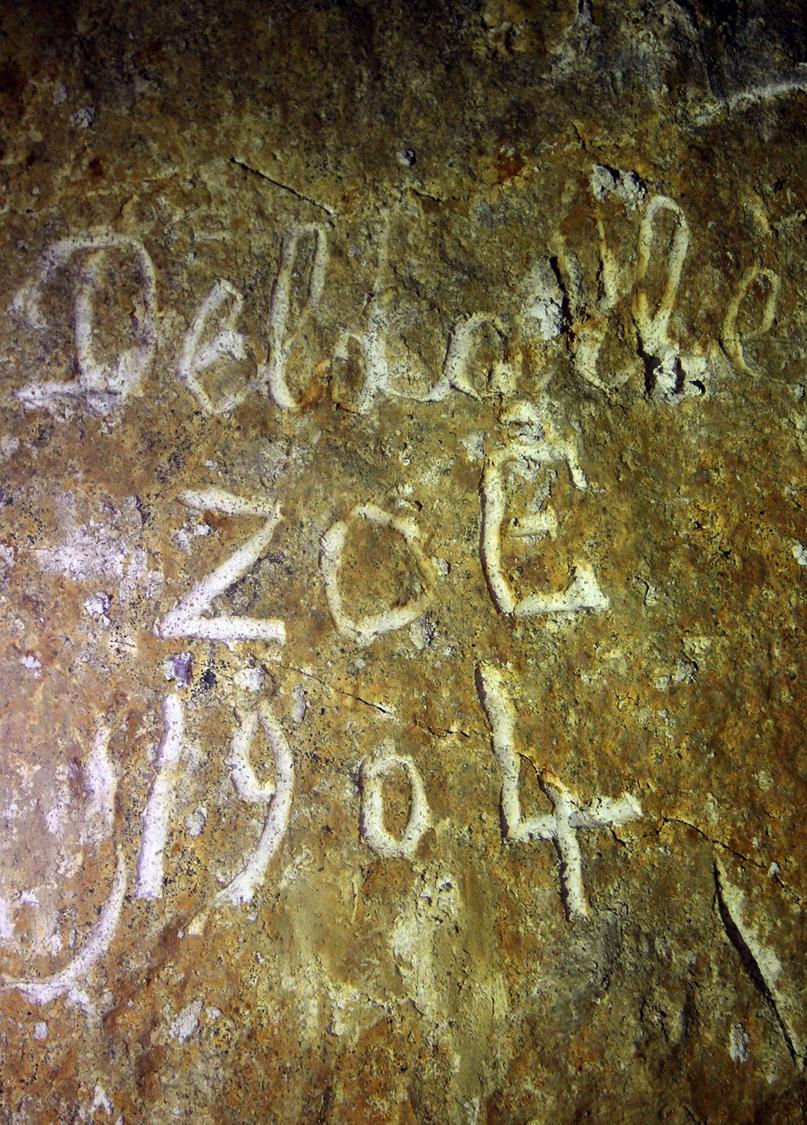
A force de chercher les moindres inscriptions dans les catiches, certains protagonistes sont devenus nos héros. Ils sont peut-être des petites-gens, ou bien plus communément des personnes du peuple. Pour nous, ce peuple est grand, riche en nos cœurs. Comme il n’est pas toujours facile de prendre possession de textes archivistiques, voici un rappel de leur vie, contée comme si c’était hier. Ce sont nos dix héros principaux.
* Jean-Baptiste Noël Dumoulin
Je naquis à Béclers le 26 décembre 1827, je suis un cadeau de Noël en retard, d’où le fait que mes parents m’appellent Noël de mon second prénom. Béclers est un petit village belge situé entre Tournai et Leuze. Les environs sont très agricoles. Les terres étant assez pauvres, ma famille s’expatrie à Lezennes alors que je suis encore assez jeune.
Le 10 février 1860, je me marie avec Thérèse Ghueluy. A cette époque là, j’étais raffineur de sucre. Ma femme Thérèse provient de Dergneau, un village belge de la section de Frasnes-Les-Anvaing. Nous nous installons dans une petite maison de la rue Faidherbe au numéro 47.
Une dizaine d’années plus tard tandis que j’étais cultivateur, j’ai l’idée de pratiquer la culture ancestrale de la barbe de capucins dans les carrières de Lezennes. C’est moi qui ai introduit la culture de ce légume au sein des catiches du Mélantois.
Sur un mur des carrières, j’ai inscrit :
MARDI 20 JANVIER
DUMOULIN JEAN-BAPTISTE
PLANTEUR DE CHICOREE 1882
AGE DE 45 ANS
Je vends mes feuilles de barbe à Roubaix sur les marchés et l’affaire est florissante.
J’ai 10 enfants : Marie, Edouard (décédé à 2 ans), Pierre, Adolphine, Louise, Paul, Ferdinand, Augustine, Jeanne et Zoé.
Je décède à Lezennes le 2 mai 1904 à l’âge de 67 ans. Je ne le savais pas : j’ai laissé derrière moi un patrimoine immatériel fort important, car la culture de la barbe de capucins a connu un grand essor.

* Zoé Dumoulin
Je naquis le 9 avril 1884 à Lezennes. Je suis la petite dernière d’une grande famille. J’ai 8 frères et sœurs, mais l’ainée qui a 24 ans lors de ma naissance se marie l’année même.
Durant mon adolescence et surtout dans la période de mes 15 à 19 ans, je travaille au sein des parcs à barbe de mon papa, dans les carrières de Lezennes. Ces cultures sont implantées dans le secteur de la Mer de Porcelaine. Lorsque mon papa décède en 1904, la culture est stoppée car ma maman Thérèse ne reprend pas l’exploitation.
Je me marie en 1905 avec Fernand Cuvelier, qui est un champignonniste ; il aida aussi dans les parcs à barbe. Il n’a pas de liens familiaux avec Constant Cuvelier. J’ai 21 ans et Fernand 18 ans. Etant donné que nous sommes tous deux mineurs, le mariage nécessite le consentement de nos parents respectifs.
Nous nous installons dans la maison de mes parents, qui vu le décès de mon papa, est partitionnée en deux habitations distinctes, les 47 et 48.
J’ai deux enfants : Noël Cuvelier et Arthur Cuvelier. Je nomme l’ainé avec le prénom de mon père en honneur à lui. Je n’ai jamais quitté l’habitation familiale, qui parfois s’appelle la Cour Marga, du nom de mon beau-frère.
Etant donné que je ne travaille plus en tant que maraichère, je prends un emploi de mécanicienne chez Grimonprez à Hellemmes (l’actuel grand stade). Au sein de la filature, je travaille dur, debout sur des machines qui assemblent des pièces de tissus. J’effectue les réglages et je travaille au bon assemblage.
Mon mari décède en 1911 à l’âge de 25 ans. Après le décès de ma maman en 1914, je me trouve assez isolée. De ce fait je retourne à la rue Faidherbe. Mon premier enfant Noël décède à 18 ans en 1921. Mon second enfant Arthur décède à 16 ans en 1927.
La situation étant difficile, je déménage. Je pars habiter chez ma sœur Jeanne.
Je décède le 20 juin 1946 à l’âge de 62 ans et je suis inhumée au cimetière de Lezennes.

* Jeanne Dumoulin
Je naquis le 28 septembre 1881 à Lezennes. Je suis la grande sœur de Zoé. J’habite à la maison de la rue Faidherbe aux numéros 47 et 48 jusqu’à mon mariage. Durant mon adolescence, je travaille dans les parcs à barbe de mon papa, notamment de mes 15 à 19 ans. Cependant, j’écris moins aux murs que mes sœurs Zoé et Augustine.
Je me marie en 1903 avec Jules Marga, j’ai alors 22 ans. Lui en a 30. J’ai deux enfants : Marie Marga, née en 1907 et Jeanne Marga, née en 1912.
En cette période, j’habite au 1bis rue Victor Hugo. Mon mari est cantonnier et je suis ménagère.
Mon mari décède en 1926. Quelques temps après, je recueille ma petite sœur Zoé à la maison. Elle-même traverse des douleurs l’année suivante. Peu avant mon décès, je déménage au 12 ter rue Chanzy. Je décède le 23 avril 1948 à Loos à l’âge de 66 ans.

* Augustine Dumoulin
Je naquis le 18 août 1877 à Lezennes. Je suis la grande sœur de Jeanne. J’habite chez mes parents jusqu’à mon mariage. Durant mon adolescence, je travaille aux parcs à barbe de mon papa. Je débute tôt car dès mes 15 ans, je suis active. J’écris beaucoup aux murs, mon nom et mon âge, jusqu’à mes 19 ans.
A mes 23 ans le 1er septembre 1900, je me marie avec Louis Delobel, mouleur aux chemins de fer du Nord. Je suis alors domiciliée à proximité de chez mes parents, au 51 de la rue Faidherbe et je reste ménagère.
J’ai une enfant, Raymonde Delobel, née le 10 août 1901.
Je décède le 13 novembre 1956 à Hem à l’âge de 79 ans.
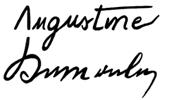
* Zoé Deldalle
Je naquis le 16 septembre 1886 à Lezennes, de mon père Jean, François Deldalle et de ma mère Catherine Joséphine Duwer. Mon papa est originaire d’Estaimpuis en Belgique et ma maman est originaire d’Annappes.
Durant mon enfance, j’habite à proximité des Dumoulin, au numéro 31 de la rue Faidherbe. Après, durant mon adolescence, je travaille dans les parcs à barbe des Dumoulin. Dès mes 15 ans, j’écris maladroitementet partout mon nom dans la craie, avec une pointe de tournevis. Les autres font ça au couteau mais moi, j’écris en grand !
En 1908, je me marie avec Georges Lagneau. J’ai alors 22 ans et lui aussi. Mon papa décède un an avant mon mariage. A la célébration de mon mariage, ma mère est absente. Ce fut assez compliqué car j’eus une enfant en juin 1908 : Julienne Lagneau. Nous la reconnaissons lors de mon mariage.
En cette période, je travaille chez Grimonprez à Hellemmes en tant que mécanicienne. C’est tout à fait comme Zoé Dumoulin, avec qui on partage des points en commun.
Je décède le 16 mars 1912 à l’âge de 25 ans et je suis inhumée au cimetière de Lezennes.

* Auguste Hayez
Je suis le fils de César Hayez, lui-même le fils de César Hayez. Tous deux étaient champignonnistes chez Crombez à Faches.
Je m’installe à mon tour comme champignonniste. Sur les parois de Lezennes et Hellemmes, à l’époque des réseaux indistincts, je marque mon nom partout au couteau.
J’y écris que je suis né à Annappes le 2 octobre 1895. En 1913 et bien que jeune, je suis déjà contremaître-champignonniste. Je fais mes classes et je suis rapidement enrôlé dans les combats contre l’occupant allemand dans le cadre de la première guerre mondiale. J’appartiens au 404ème Régiment d’Infanterie.
Je décède au champ de bataille le 14 octobre 1916, à Berny-en-Santerre, à l’âge de 21 ans. Je reçois une balle à la tête. Je ne suis pas inhumé à Lezennes, mais le monument aux morts de la place de la République porte mon nom.

* Constant Cuvelier
Je naquis le 9 mars 1822 à Meurchin, un gros bourg situé au nord de Lens. Lorsque je grave sur le mur, j’indique le 10 mars. Meurchin, j’y réside jusqu’à mon mariage. Mon papa s’appelle Louis, Joseph Cuvelier et ma maman Hiacinthe Hocq.
Le 16 avril 1849, je me marie à Lezennes avec Marie, Louise, Floride Dupont. Elle a alors 24 ans et moi 27 ans. Lors de mon mariage, je déclare une enfant née avant mariage, du prénom de Marie le 27 juin 1848.
Lors de mon mariage, l’un des témoins est l’illustre Monsieur Puy, qui s’était perdu dans les carrières en 1848. J’étais ardemment parti à sa recherche ! Etienne Puy est devenu mon ami suite à sa mésaventure lezennoise.
Nous avons 6 enfants, mais Angélique est morte-née. Ils s’appellent Marie, Henriette, Léonard, Angèle et Adolphe.
Je suis champignonniste dans les carrières de Lezennes et Hellemmes. Je signe sur de nombreux murs et je déclare souvent ma profession. Je signe toujours Constant et non Constantin.
Je décède le 1er octobre 1866 à Meurchin, à l’âge de 44 ans.

* Louis Levas
Je suis le carrier le plus célèbre de Lezennes. Je m’appelle Jean, Louis, Joseph Levas. Je naquis le 4 septembre 1838 à Lezennes. Mon papa était Auguste Levas, carriéreur de profession et ma maman était Séraphine Fayens. Des Fayens, nous provenons d’une longue lignée de carriers.
Je m’installe comme carriéreur et c’est de toute ma vie que je tire la pierre. Je suis, avec Auguste Roussel, le dernier carrier de Lezennes : l’ultime d’une très longue tradition extractive. Je mène mes travaux alors que dans tous les lieux-dits, l’extraction est stoppée, sauf celle liée à la chaux sucrière.
Je marque mon nom partout, quelquefois en très grand et je suis fier d’ajouter : carrier à Lezennes. Je reste célibataire toute ma vie.
A la fin de ma vie, je réside chez ma nièce Victorine Morel, qui tenait un café à la rue Gambetta.
Je décède le 21 février 1909 à Lezennes, à l’âge de 70 ans.

* Auguste Roussel
Je naquis le 15 avril 1820 à Audembert, un tout petit village de la côte d’Opale – belle terre venteuse des Deux Caps, mais pauvre. Mon papa se nomme Auguste Roussel et ma maman Marie Séraphine Evrard.
Je suis charron. A Herbinghen, je me marie le 7 novembre 1854 avec Marie Louise Joseph Julie Gueudre, dite « Julie ». J’ai deux enfants en 1868 et 1869. A cette période là, j’habitais à Licques. L’un de mes enfants, Zénon, est bien connu comme carriéreur.
C’est plus tard que j’arrive à Lezennes. Mon fils Zénon s’y marie le 14 octobre 1893. A partir de 1887, j’exploite la pierre avec mon compagnon carriéreur Louis Levas. Tous deux nous avons une propension à signer à la peinture en très grand !
Je décède à une date parfaitement inconnue.

* Adrien Deroo
Je naquis le 18 du mois de Messidor, an septième de la République. Pour vous qui n’êtes pas habitué, c’est le 6 juillet 1799. Je suis natif de Lezennes. Mon papa était François Deroo, carriéreur de profession et ma maman Marie Dhennin.
Je me marie le 16 octobre 1826 avec Angélique Morel. A cette date, j’ai 27 ans et je suis carriéreur. De par mon mariage, je suis affilié aux Morel et aux Delemar.
Lorsque Monsieur Puy s’est perdu dans la carrière en 1848, je l’ai cherché avec assiduité. C’est Delemar qui le retrouve. Je suis quelque peu envieux de lui alors je marque en plusieurs endroits mon nom et des circonstances de la recherche. Je signe aussi en énorme sur les murs !
J’ai 9 enfants : Guillaume, Anne, Rose, François, Adelaïde, Aimable, Jean, Pierre et César. Plusieurs de mes enfants sont nés avant mon mariage.
Je décède le 24 août 1874 en ma demeure à Lezennes, à l’âge de 75 ans.


Hellemmes, l’école Bonne-Nuit
Hellemmes a déjà été largement évoquée au sein des pages sur Lezennes. En effet jusqu’à une période récente, les carrières d’Hellemmes étaient profondément connectées au réseau de Lezennes. Reste que les prospections engagées, essentiellement généalogiques, ne faisaient pas le point sur l’inventaire des souterrains présents sur le territoire. En voici un détail.
Nous devons seulement amener la précision que, contrairement à d’autres villes du Mélantois, nous n’avons pas la possibilité de nommer les lieux concernant un certain nombre de souterrains. En effet, cela pourrait attiser des actes de vandalisme.
Hellemmes comporte de nombreuses carrières. Le dénombrement est plus que compliqué à réaliser, pour des raisons que nous pouvons lister en trois catégories :
- Le fait que nous supposons que presque toutes les carrières étaient interconnectées à l’époque. A ce jour, il reste des massifs non connus comme exploités, qui subsistent tout de même dans des zonages à classe de risque élevée. A ce titre ces zonages sont en bleu dans le PER.
- Le fait que de nombreux remblaiements ont eu lieu. De ce fait, des carrières qui étaient parfaitement jointives à l’époque sont désormais coupées.
- Le fait que des carrières situées sur le territoire d’Hellemmes ne sont que des poursuites de creusement d’éléments majeurs, notablement situés sur les territoires de Lezennes et Hellemmes.
En ces aspects, décrire Hellemmes revient à aborder le sujet avec d’innombrables précautions, ce qui ne facilite bien évidemment pas la tâche.
Nous datons l’entièreté des carrières souterraines à une période 1800-1850. Quelques creusements tardifs sont encore réalisés jusqu’en 1890, mais ils ne constituent pas le gros de l’exploitation.
* Les carrières du secteur Espoir
Cela correspond à de nombreux vides de carrières, situés dans le pourtour du bâtiment Espoir, et s’étalant jusqu’au Triolo à Villeneuve d’Ascq. Dans l’ensemble, tous ces vides de carrières sont récents (plutôt 1850-1890). De même, toutes ces galeries sont en mauvais état, de peu d’intérêt archéologique et sont séparés par d’innombrables remblaiements. Les diaclases verticales sont loin de faciliter la tâche, les blocs ayant la possibilité de se détacher facilement sans que rien ne puisse réellement le révéler. C’est donc un site assez inquiétant.
Un grand nombre de ces sites n’ont simplement pas été topographiés du fait que les réseaux sont en si mauvais état, la progression s’avérait être une prise de risque démesurée et inutile. C’est à ce titre que les terrains sont tous interdit d’accès.
Ces terrains ont été assaillis par des campements de romanichels. Il en ressort un état de saleté alarmant des terrains de surface, se répercutant inévitablement dans le sous-sol. Les catiches poubelles sont nombreuses. Dans l’ensemble, les souterrains sont repoussants. Déjà à la base, il y avait un indéniable manque de soin dans le creusement, réalisé « à l’arrachée ». A cela s’ajoutant les monticules de détritus, l’ambiance est détestable. Nous nommons ces terrains « la jungle ».
Les catiches sont dégradées et parfois à caisson bois. A la place de réaliser un encorbellement de pierre, les carriers refermaient les catiches avec des planches en bois, ce qui représente là encore une volonté manifeste de manque de soin. A ce jour tout cela est dans un état déplorable, tout comme les terrains de surface qui, n’étant plus entretenus, forment un entrelacs de végétation envahissante, surmontant des trous dangereux. Vu l’interdiction, toutes ces parcelles sont des no-man’s land.
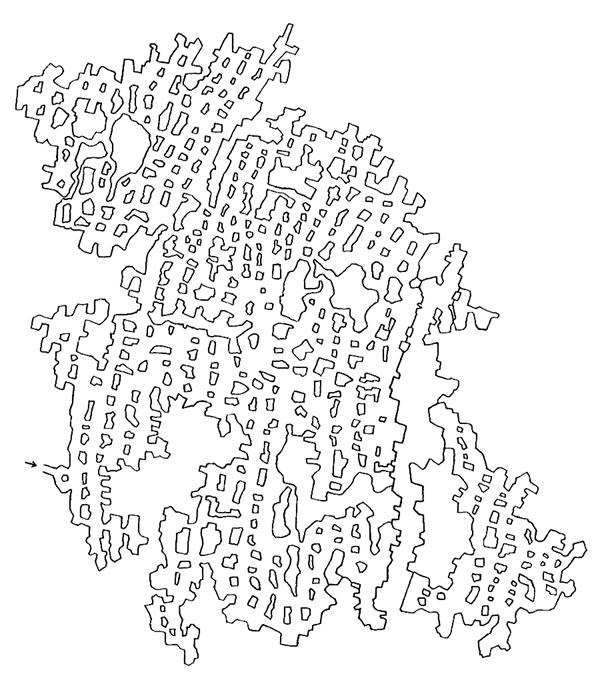
Une des carrières de ce secteur. La flèche indique le point de jonction avec une seconde carrière.
A dénombrer de ce fait :
* Une carrière dans les Bois, à l’ouest de la rue de la Voie Perdue. Elle s’étend jusqu’au Boulanger de Villeneuve d’Ascq. Elle est dans un état tel que les terrains sont interdit d’accès et nous ne disposons d’aucune topographie.
* Des carrières dans les terrains de la rue de l’Espoir. Elles sont dans un état calamiteux, font preuve d’un manque de soin important, sont victime de dépôts de déchets et ne possèdent aucun intérêt archéologique.
* des carrières au boulevard de Valmy, en grande partie sur le territoire de Villeneuve d’Ascq, jusqu’à la rue des Victoires. Le site est dans un état si déplorable que les accès physiques aux terrains en deviennent compromis. C’est à ce titre que tous ces terrains sans exception sont interdits d’accès.
Signalons que de ces carrières, tout ce qui affectait le bâti, sans exception, a fait l’objet de remblaiements systématiques.
* Plus à l’ouest, nous recensons deux carrières souterraines situées sous l’école Herriot. Ces travaux correspondent à une toute petite carrière et à un volume nettement plus vaste. Ces carrières affectant le bâti et des espaces publics, leur état n’étant guère reluisant en certains endroits, des remblaiements ont eu lieu en 2013.

Une des carrières de ce secteur.
A côté de l’école se trouve une ancienne caserne militaire, en situation de complet abandon. Dans le vocable local, ce site s’appelle la poudrerie. Il s’y trouve deux caponnières souterraines, dont une est vaste. Il n’y a aucune jonction avec les carrières.
* Les deux carrières du secteur central
Nous ne nommons pas ces sites afin de protéger le patrimoine. Si nous appelons ça central, c’est du fait que dans la constellation des carrières hellemmoises, elles occupent une portion assez centrale.
* La première carrière est une petite exploitation située sous des espaces urbains, en bon état général sous le bâti. La partie « est » de la carrière a subi des dommages (essentiellement des effondrements de calottes). Un remblaiement apparait inéluctable. C’est un lieu qui a servi aux champignonnistes, comme peut en témoigner la présence de quelques rares vestiges. Cette excavation est de dimension réduite, mais il existe un certain nombre de lieux esthétiques. Il fut localisé dedans un joli petit caillou plat gravé du nom de Jean Delobel.
* La seconde carrière est une prolongation de vastes sites d’exploitation. Des remblais récents ont fractionné cette cavité. C’est une carrière qui ne sous-mine pas l’habitat, en bon état général. Tout un cheminement interne a été réalisé par des réfugiés, lors de la seconde guerre mondiale. Une ancienne descenderie existe, celle-ci est dans un état de comblement quasiment complet. Le site est assez linéaire : une longue galerie sinueuse avec quelques petits départs de chambres. Bien qu’il n’y ait pas d’inscription ni d’intérêt archéologique, c’est dans l’ensemble un volume plutôt agréable. Tout du moins, notons que l’exploitation de la craie a ici fait l’objet d’un soin certain.
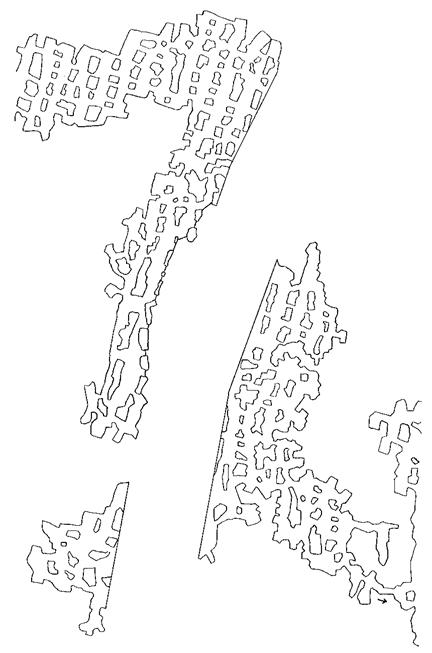
La première carrière du secteur central. La flèche indique le point de jonction cité précédemment.
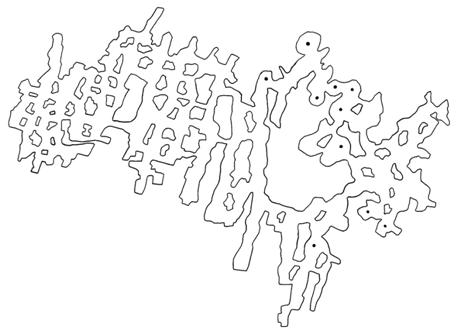
La seconde carrière du secteur central.
* Le bunker
Sur un flanc des carrières existe un bunker. Ce lieu a été aménagé par la SNCF dans le but de pouvoir protéger ses ouvriers d’une attaque aérienne. A ce jour, il reste 300 mètres de galeries, affectant un territoire appartenant à la SNCF. Ces tunnels ne permettent plus de jonctionner avec les carrières. Un nombre de déchets important et des incendies ont rendu cet endroit très glauque. Les lieux sont sombres et instiguent une ambiance inquiétante.
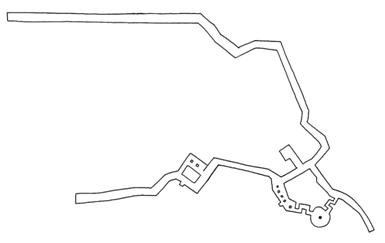
Le croquis du bunker.
* Les ateliers SNCF
Sous les ateliers SNCF existe une carrière. Elle est de dimension assez réduite. Elle se situe sous les locaux qui à l’époque servaient d’ateliers de chaudronnerie. A proximité immédiate se trouve une galerie de 120 mètres, bétonnée, qui serait là encore de bunker. A ce jour les lieux sont murés et plus aucun accès n’y est possible. Cette galerie ne rejoint pas les carrières.
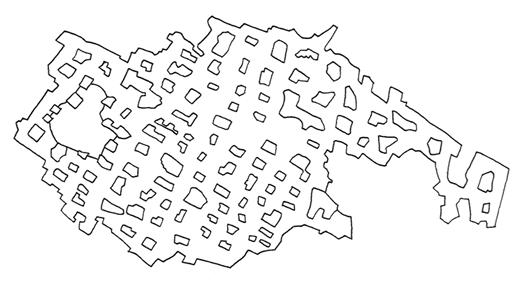
La carrière de la chaudronnerie SNCF.
* La carrière au nord de Lezennes.
Il s’agit d’une prolongation du réseau de Lezennes, que nous avons eu la chance de pouvoir décrire précédemment déjà assez largement, et notamment dans le chapitre réservé à la chambre de Monsieur Puy. Les lieux sont très esthétiques.
Le réseau est en bon état, mais il forme un labyrinthe complexe qui se révèle dangereux à visiter considérant que c’est très vaste et très anarchique.
De plus, les roches sont diaclasées verticalement, ce qui signifie que c'est « naturellement » faillé dans le sens vertical. Ces failles verticales entrainent que les blocs peuvent chuter sans qu'on puisse voir les risques. En effet, rien n'empêche le bloc de tomber si c'est en mauvais état, et pourtant ça ne se voit pas. En diaclase horizontale, les décrochages se voient bien. De ce fait les lieux n’ont rien de bien rassurant. A ce titre d’ailleurs, un graffiti à la flamme datant des années 50-60 mentionne : DANGER, N’ALLER (sic) PAS EN EXCURSION PAR PLAISIR.
Aucun territoire de bâti n’est affecté par ces carrières. L’accès à ce site souterrain est sur le territoire de Lezennes. Le réseau est à ce jour fractionné en trois entités plus ou moins distinctes. Dans l’une des extrémités de ce réseau, les carriers ont peint un fort joli calvaire à la peinture noire.
Une petite excavation existe au sein de l’établissement des Eaux du Nord, à proximité du Chemin Napoléon. Cette exploitation est de dimension très réduite.
Notons aussi l’existence d’une petite exploitation sous le bâtiment du laboratoire Anios. Cette exploitation de petite dimension a connu d’assez nombreux remblaiements.

L’exploitation du laboratoire Anios.
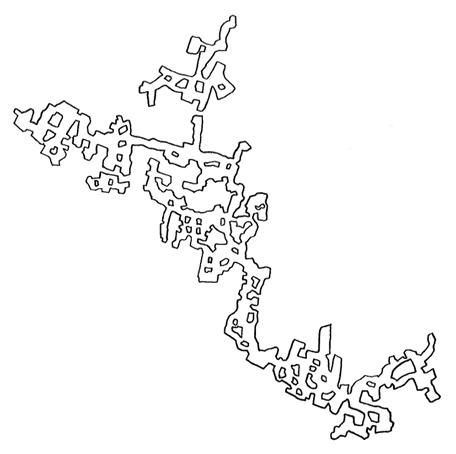
Une autre exploitation, entre Hellemmes-Sud et Lezennes-Nord.
* L’établissement Citroën
Notons qu’il existe aussi une carrière à proximité de l’établissement Citroën d’Hellemmes, situé entre le chemin du Prieuré et le Boulevard de l’Ouest. Cette excavation nous est mal connue, hormis le fait qu’il s’agit d’un volume tout de même relativement vaste. Un affaissement a eu lieu au 3 chemin du Prieuré, ce qui a mené au comblement.
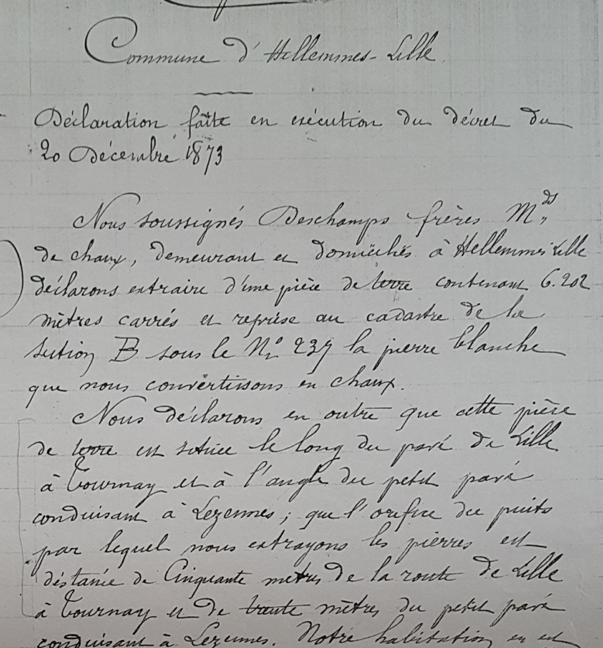
Une déclaration de carrière à Hellemmes.
Bernard Bivert estime que le volume excavé sur le territoire d’Hellemmes correspond à un million de mètres cubes. Les volumes sont très essentiellement en chambres et piliers, les catiches sont rares. Cela garantit une certaine stabilité aux lieux.Annappes, que reste-t-il de toi ?
Les carrières de Villeneuve d’Ascq, le terme ne résonne pas en nous comme une mine d’or. Pour cause, elles sont pour la plupart détruites. Il ne reste que quelques vestiges, la plupart du temps en très mauvais état. Voici un bref état des lieux de la situation sur ce territoire.
Les carrières de Villeneuves d'Ascq sont toutes situées sur l'ancien territoire d'Annappes, aux limites de Lezennes et d’Hellemmes ; il ne se trouve aucune excavation à Ascq et Flers. Elles forment le prolongement géographique de grands ensembles souterrains et il est tout à fait difficile de les en différencier. Au contraire de ces territoires précités, elles restent difficiles à cerner étant donné que des remblaiements massifs ont eu lieu. Par rapport au volume initial – qui était important – il reste une peau de chagrin.
De Lezennes, les carrières d'Annappes se distinguent uniquement de par l'aspect récent des galeries. Ces excavations ont été les derniers sites d'extensions lezennoises à avoir été ouvertes. D'Hellemmes, les galeries ne se différencient en pas grand chose.
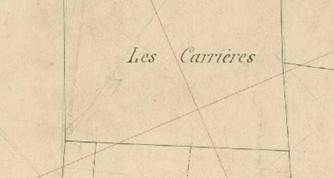
Un nom de lieu-dit bien éloquent.
Nous connaissons les exploitations suivantes :
* Dans la partie la plus au sud du secteur d'exploitation, cinq carrières sous-minent le golf de Lezennes. Ces carrières sont situées sur le territoire de Ronchin et de Lezennes, avec des extensions possibles sur Villeneuve d’Ascq. En prolongement nord direct de ces carrières existait des exploitations dans l'actuelle rue du Village et le stade Pierre Mauroy. Ces catiches ont été rayées de la carte.
Il subsiste à ce jour un immense terrain en état de friche, notamment à hauteur de la rue du Virage. Il est tout à fait évident de voir les têtes de catiches désobturées. Les espaces du dessous-terre ont subi des ravages avec la construction du stade.
* Dans le secteur de V2, des carrières ont existé. Elles étaient situées au Cash Converter et dans le périmètre de la rue de l'Espoir, de la rue de la Voie Perdue et le Chemin du Moulin de Lezennes. A ce jour, une large part a été rasée.
* De vastes carrières affectent le territoire d'Hellemmes. Des prolongations existaient à Annappes, notamment dans tout le pourtour du Centre Espoir. Une très large section a été anéantie par des travaux de construction.
Il reste toutefois des catiches à proximité du Chemin des Vieux Arbres. Les terrains sont tous clôturés et interdits d’accès. L’état désastreux de la surface laisse imaginer l’état du dessous-terre. Aucune habitation n’est sous-minée, ni aucun territoire public libre d’accès.
* Une large carrière existe sous le site de Citroën Hellemmes (avenue du Pont de Bois). De petites extensions de carrières existent sur le territoire d'Annappes.
Si le volume d'extraction de Villeneuve d'Ascq est important, c'est uniquement dû au dynamisme des grands sites d'extraction de l'époque que sont Lezennes et Hellemmes. Il ne se trouve rien d'autre sur le territoire. Par contre, de nombreux carriers et barbeux étaient annappois.
Ce dynamisme se retrouve même au sein des exploitants, dont un nombre non négligeable provient de nos habitués lezennois.
Les cadastres anciens sont peu bavards sur les carrières. Peu d’informations sont livrées et celles-ci ne se révèlent même pas exploitables tant les terrains de surface sont remaniés.

A proximité du site Citroën d’Hellemmes se trouvait, sur le territoire de Villeneuve d’Ascq, une carrière souterraine et un four à chaux. Les plans actuels permettent de déterminer qu’il ne s’agit pas d’une extension des carrières d’Hellemmes, lesquelles sont indépendantes.
Une vue plus détaillée du site permet de voir la carrière avec son tracé global en longueur et l’implantation du four à chaux (page suivante).
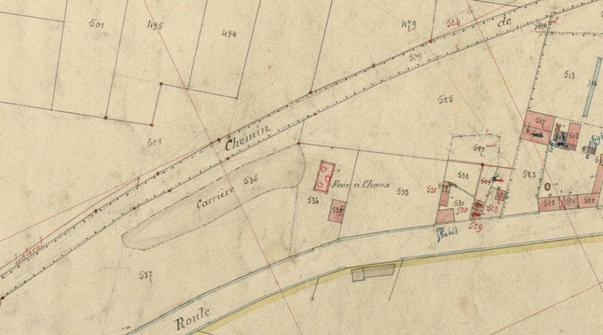
Le plan de cette carrière est disponible ci-dessous. Introuvable sur place et pourtant d’une situation évidente, nous en sommes amenés à penser qu’elle a été en large partie remblayée, si ce n’est totalement. Ce ne serait nullement étonnant vu sa situation géographique.
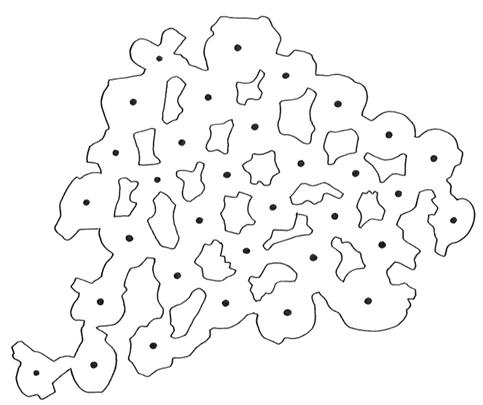
Notons aussi qu’au lieu-dit le Moulin de Lezennes se trouve un « chemin des carrières ». A n’en point douter, il s’agissait d’une voie de communication utilisée par les carriers.
Le recensement de 1906
Que trouver dans le recensement d’Annappes ? Des travailleurs faisant le trajet jusqu’à Lezennes, des champignonnistes ? La réponse est tombée après avoir évalué l’entièreté des documents : pas grand-chose. En 1906 l’activité était faible.
![]()
Siemoÿs François, né en 1856, chaufournier chez Lefebvre à Annappes.
![]()
Delecluse Henri, né en 1866, chaufournier chez Graux à Hellemmes.
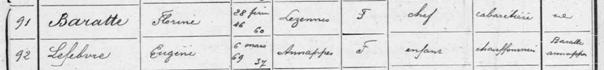
Lefebvre Eugène, né le 6 mars 1869, chaufournier chez Baratte à Annappes. Le nom de sa femme démontre clairement une filiation. De là à ce que les chaufourniers Lefebvre et Baratte soient un même établissement ou des filiales, la question reste posée.
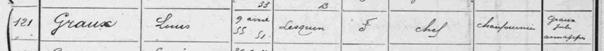
Graux Louis, né le 9 avril 1855, chaufournier chez Jules Graux à Annappes. Cet intéressant enregistrement nous donne le prénom du patron.
![]()
Carpentier Camille, né le 25 février 1878, chaufournier chez Graux à Annappes.
De tous ces enregistrements, il ne ressort que des chaufourniers. Il est loin d’être établi que cela avait un quelconque lien avec les carrières de Lezennes, d’Hellemmes ou d’Annappes.
Conclusion
Bernard Bivert mesure au sein du territoire le volume d’un million de mètres cubes extrait. Nous avons très grande peine à imaginer ce volume possible. Il est de fait que les remaniements de surface ne permettent plus d’appréhender les excavations. Il est trop tard afin d’établir un inventaire.

Ronchin, le seigneur des anneaux
Ronchin est une ville directement attenante à Lille. Du point de vue des catiches, elle reste plutôt discrète dans l’ensemble. Peu de documents historiques, peu d’informations disponibles, on en viendrait à croire que le patrimoine est passable. Pourtant, en matière de volumes de vides, Ronchin est loin d’être quantité négligeable. Deux cent vingt mille mètres cubes de pierre ont été extraits. C’est très loin d’être une simple prospection. Douloureusement les archives manquent et c’est un fait indéniable. Nous avons tenté de sortir de l’obscurité les secrets historiques de ces souterrains.
Les documents historiques sont manquants. C’est un aspect factuel et indéniable ; la matière fait défaut. Ceci a lourdement pénalisé les recherches menées jusqu’à présent. Si d’habitude, les sites d’extraction s’accompagnent d’une précieuse déclaration de carrière, ici nous n’en disposons d’aucune. A cela deux hypothèses :
- Soit l’ensemble du creusement est antérieur à 1800, date à laquelle de partout dans le Mélantois essaime l’obligation de déclarer les travaux.
- Soit les documents ont disparu avec le temps.
Une chose reste certaine : si quelques carrières sont médiévales à Ronchin, ce n’est certainement pas le cas de la majorité des restantes. Bon nombre d’excavations ont un schéma d’exploitation correspondant à une activité relativement récente. Cela signifie dès lors que les archives n’existent plus, bien malheureusement.
On pourrait tout à fait imaginer que les carriers étaient extérieurs à Ronchin (par exemple, Faches ou Lesquin) mais cela ne les dispensait pas de déclarer. Cet aspect est renforcé par un typisme bien représenté à Ronchin : les limites de propriété sont correctement respectées. Soyons lucides, cela signifie uniquement que les carriers étaient contrôlés. Dès lors il fut un jour – cela ne peut être autrement – où les documents ont existé.
Les ennuis s’accumulent de par un fait supplémentaire : les carrières sont vides d’inscriptions. Nous ne sommes pas comme à Faches ou Lezennes, face à des romans sur les parois. Quelquefois un nom éparpillé ça et là sur les murs nous aide. On y retrouve des carriers, des barbeux, des champignonnistes. Ici, rien !
Ca en est désespérant. Et si seulement ce n’était que ça… Les catiches de Ronchin sont de même absentes des cartes anciennes. Il arrive souvent que de vieux documents cadastraux mentionnent des exploitations. Sur le territoire ronchinois le résultat est d’une grande pauvreté.
Il faudra donc tolérer le lacunaire. Tout ce qui suit n’est qu’un grand parcours à tâtons dans le noir. Ronchin comporte 23 carrières d’après Bernard Bivert dans son inventaire SDICS. Certains sites sont si proches (dont à ce titre un qui est carrément imbriqué) qu’il est difficile de compter.
Tout au plus savons nous que seules deux carrières sont en activité après 1848. Elles sont dirigées par les Chaufourniers nommés Wacrenier et Planquelle-Dupret. Au sujet du premier, nous ne savons rien car le nom est très fréquent. Au sujet du second, nous supposons qu’il s’agit du couple Planquelle Désiré Philippe (né aux environs de 1806) et Dupret Aimé Florentine (née aux environs de 1804).
Du point de vue des cartes, nous avons épluché tous les cadastres anciens possibles et imaginables, carte de Cassini, de la châtellenie de Lille, carte d’état-major, etc.
Seul le cadastre de 1903 mentionne une carrière. Le document est abscons car cela ne correspond pas à une réalité connue. Nous sommes à proximité de la salle Jean Jaurès. La carrière qui est actuellement connue et cartographiée en détail n’est ni placée là ni avec cette forme là. Quel grand mystère encore ?
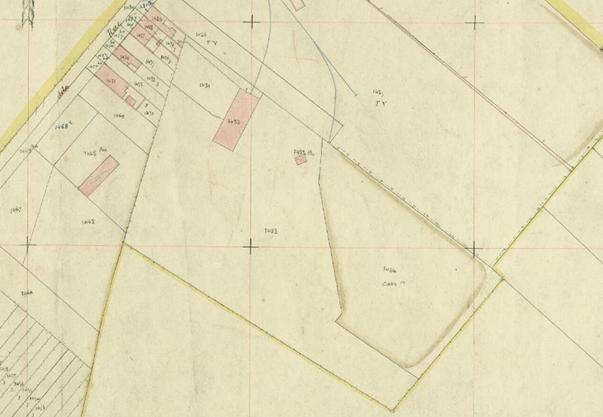
Nous allons par ce qui suit passer en revue l’inventaire des carrières existantes, dont les topographies ont été réalisées par le SDICS.
La description des carrières existantes
Selon Bernard Bivert, Ronchin totalise 1201 catiches pour 220.000 mètres cubes d’extraction.
Selon nos estimations, Ronchin totalise 1134 catiches pour 205.000 mètres cubes d’extraction. La différence est probablement due au fait que le site de l’église paroissiale du Christ Ressuscité est difficile à appréhender. Les lieux ont été fort remaniés avec la construction de lotissements.
Comme évoqué, Bernard Bivert comptabilise 23 exploitations. Afin d’avoir un classement autant que possible similaire, nous avons classé ici chaque site d’extraction en lettres R, correspondantes à l’initiale de Ronchin.
R01 ~ R02 ~ R03
Dans le vocable local, ces catiches sont appelées « le club électronique », du fait du nom de l’ancien local situé globalement au dessus, ou tout du moins à proximité immédiate. Il s’agit de quelques catiches éparpillées sur le site du tennis, à proximité du stade Léo Lagrange. Ces catiches ne font pas l’objet d’une exploitation vaste et ordonnée. Il s’agit plutôt de quelques prospections. En quatre exploitations distinctes, le site comporte 24 catiches, 21 catiches et 13 suspectées, 4 catiches et 34 catiches. C’est un site sans ampleur particulière et sans histoire notoire. Le quatrième site laisse à penser qu’il s’agit uniquement d’une détection en gravimétrie.
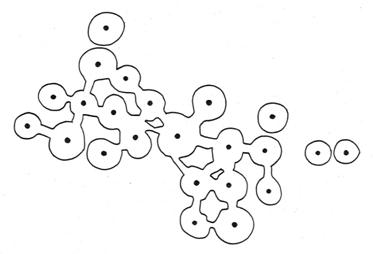
La carrière R01.

La carrière R03.
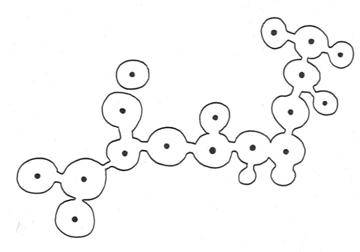
La carrière R02.

La carrière R10-1.
Les sites ne posent pas de souci particulier étant donné qu’ils sont bien circonscrits. Ils ont tout de même mené à l’abandon d’un cours de tennis extérieur.
R10
Ce n’est pas dans l’ordre des R. C’est parce qu’a posteriori, nous avons constaté qu’il s’agit de groupements de quelques catiches éparpillées, aux abords de la rue Chalant. Le site est strictement attenant aux terrains de tennis et fonctionne sur le même système. C’est à ce point proche que le site n’en est pas loin d’être indissociable. Ces excavations comportent : 4 catiches, 4 catiches, 17 catiches, 3 catiches et 4 catiches.

La carrière R10-2.

La carrière R10-4.

La carrière R10-5.
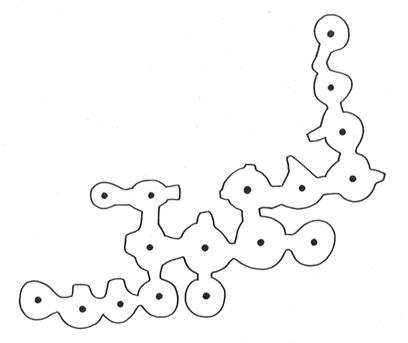
La carrière R10-3.
Dans l’ensemble, tous ces sites à proximité du stade Léo Lagrange sont de faible ampleur. Ce sont des exploitations familiales, éparpillées, qui n’ont pas prospéré. Le creusement est moderne vu les alignements de catiches et il est à suspecter que le four à chaux était la destination finale de telles extractions.
R04
Il s’agit d’une carrière que nous identifions mal, située rue Rembrandt. La raison pour laquelle elle est mal connue, c’est du fait que nous en possédons un plan incomplet. Il s’agit d’une excavation assez vaste, en chambre et piliers et technique mixte catiches. Elle affecte un terrain agricole sur environ 1,5 hectares. Vu la technique de creusement, elle pourrait être assez ancienne : XVIème siècle au plus tôt, XVIIIème siècle le plus probable.
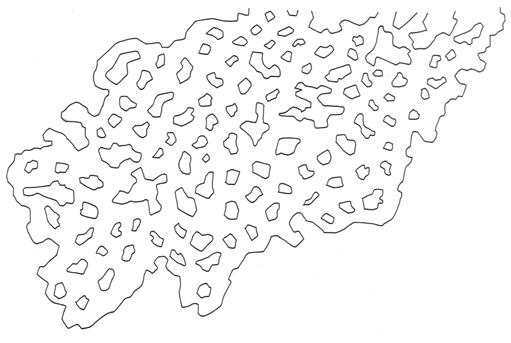
La carrière R04, un plan partiel.
La datation provient de la ressemblance du schéma d’exploitation avec les carrières les plus anciennes d’Hellemmes. On est à ces périodes là, dans laquelle un creusement mixte entre catiches et tunnels est opéré. Cette carrière vit mal, plusieurs effondrements existent. Elle affecte un champ et une terre non bâtie. Vu la gravimétrie, la surface réelle de l’exploitation est bien plus grande que ce plan (environ le triple).
R05-1
C’est une petite carrière située avenue Jean Jaurès, non située avec précision. De faible ampleur, elle allie technique mixte et catiches. Etant donné qu’elle possède 2 catiches, nous l’avons comptabilisée en excavation de chambres. Elle affecte lourdement une habitation. Son schéma d’exploitation laisse à penser, là encore, à des travaux d’une période 1760-1790, comme c’est bien souvent le cas dans le cadre de ces petites excavations.
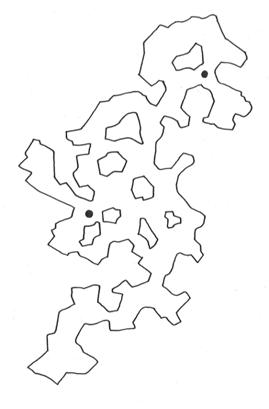
La carrière R05-1.
R05-2
Il s’agit d’une vaste exploitation en tout catiches, dénombrant 104 catiches. L’excavation est localisée en frontière avec Faches-Thumesnil et se situe avenue Jean Jaurès. C’est un vaste ensemble, de creusement récent. Cette excavation affecte quasiment exclusivement des jardins.
Au sujet de toutes ces exploitations, il est à se demander si le maître d’œuvre est réellement Bruant, ou s’il s’agit d’une main d’œuvre Thumesniloise. En effet, nous nous trouvons en bordure immédiate de très gros sites d’extraction (La Jappe, rue Henri Dillies). C’est à ce point que face aux mastodontes Faches-Thumesnilois, les excavations Ronchinoises sont menue monnaie. Il semblerait logique de dire que l’ensemble faisait un tout à l’époque. Cet aspect se trouve renforcé par l’information que sur Lesquin et sur Loos, c’était effectivement le cas, des exploitants ouvraient plusieurs sites d’extraction. Dès lors, pourquoi Ronchin aurait fonctionné différemment ? Les exploitants Thumesnilois ont été très entreprenants, cela fait aussi partie des paramètres connus.
R05-3
Ce sont deux petites carrières subalternes situées avenue Jean Jaurès face à la rue du Tchad. Elles comportent 17 et 11 catiches. Elles ne possèdent aucun intérêt particulier et les deux puits d’accès ont été supprimés. Elles se situent à quelques pas de la rue Dillies de Faches, sous laquelle existe un vaste site souterrain.
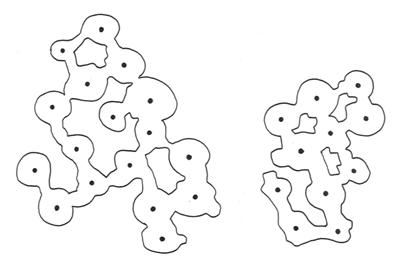
La carrière R05-3.
R06
C’est une excavation très bien ordonnée, en tout catiches, qui forme une prolongation géographique au nord de la carrière R05-2. Elle est située rue du Lieutenant Colin. Elle possède 41 catiches bien alignées. Cette excavation est régulièrement inondée par un volume impressionnant d’eau, allant jusqu’au noyage complet parfois. Il apparaît que le SDICS a mené les investigations topographiques en bateau. C’est une des rares carrières du Mélantois à subir de tels battements de nappe.
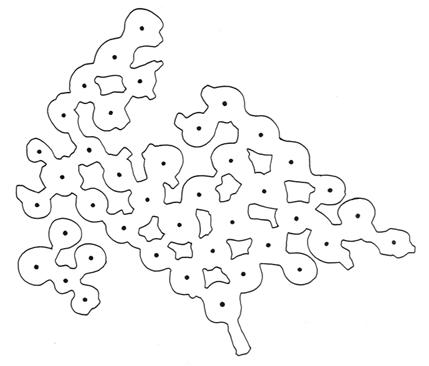
La carrière R06.
R07
C’est une assez petite carrière en chambres et piliers qui s’étend sous la rue Ghesquières. Le creusement est visiblement celui de temps médiévaux, au vu du positionnement anarchique des galeries. Cela donne un petit air de Lezennes à cette excavation au demeurant fort sympathique. Sans nul doute, les moellons extraits ont servi à l’érection de l’église Sainte-Rictrude, vu la proximité de cette dernière. Considérant le volume important de hagues et bourrages, il est à supposer que le réseau était un peu plus étendu de par le passé, et que les carriéreurs de l’époque ont procédé à des remblaiements systématiques.
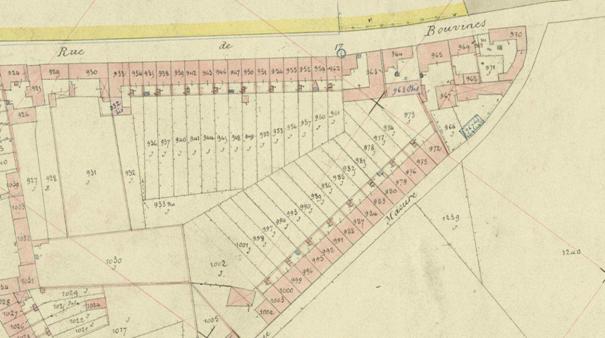
Le cadastre ancien ne mentionne pas la carrière.
L’église datant du XIème siècle, doit-on conclure que les travaux souterrains sont contemporains ? Si tel est le cas, c’est évidemment un creusement de grande valeur. Aucune information factuelle ne nous permet de consolider cette hypothèse. Au niveau des plans anciens, aucune information n’est disponible, ce qui peut témoigner de l’oubli de cette excavation en certaines époques. Rien d’étonnant lorsque l’on sait qu’on y accède via un escalier démarrant d’une habitation privée.
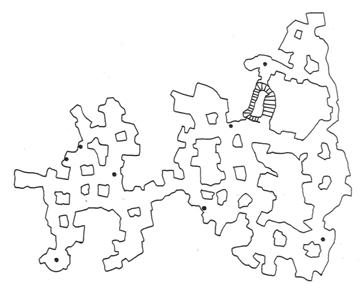
La carrière R07.
R08
C’est un énorme site. La carrière comporte à elle seule et en un seul tenant 344 catiches. Elle est située à proximité immédiate de Faches-Thumesnil, dans un secteur hautement creusé. La carrière n’est pas dans un alignement parfait de bouteilles comme à la Croisette de Faches, mais progresse au gré des besoins en craie.
Il pourrait être évalué que ce site a servi à alimenter des fours à chaux, vu l’ampleur du creusement. Les travaux datent vraisemblablement de la période fin XVIIIème siècle, début XIXème siècle. Malgré la quelque peu immensité des travaux souterrains, cette carrière n’amène pas de remarque particulière. Il s’agit en réalité de travaux industriels, menés dans une probable hâte. Ce site laisse en tout cas un volume de vides impressionnant, ce qui justifie une attention toute particulière en matière de gestion.
Le plan est placé à la page suivante.
R09
Cette carrière comporte 18 catiches. Elle est située exactement face au débouché de la rue Dillies. Elle a fait l’objet de remblaiement partiel. Elle ne possède pas d’aspect particulier.
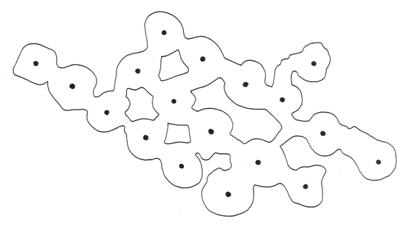
La carrière R09.
R11-1
Cette exploitation est étrange. Située au 102 rue Roger Salengro, c’est un tunnel sinueux qui mène à un puits à eau. Sans nul doute, ce creusement est ancien. Il est difficile de qualifier ce lieu d’exploitation. Ne serait-ce pas là un tunnel très ancien n’ayant eu pour vocation que de rechercher une eau limpide ?


La carrière R08.
R11-2
C’est un minuscule début d’exploitation, potentiellement en chambres et piliers. L’extraction a été avortée très rapidement. Située au 44 rue Roger Salengro. C’est un creusement visiblement ancien, mais nous ne disposons d’aucune information. Ce n’est nullement étonnant vu l’ampleur du site.
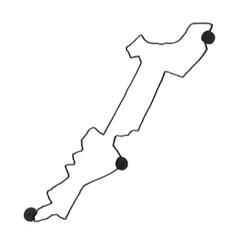
R12-1
Située rue des Forsythias. Curieuse exploitation tout en longueur, ce qui pourrait retraduire la forme d’un terrain de l’époque, ou bien, c’est la seule partie qu’on connaît actuellement d’un site qui pourrait être plus vaste. Cette seconde hypothèse est valable vu la proximité immédiate d’autres carrières. A l’heure actuelle en tout cas, on dénombre 31 catiches en ce lieu. D’après les relevés du SDICS, le site possède 90 cm d’eau en niveau de nappe aquifère.
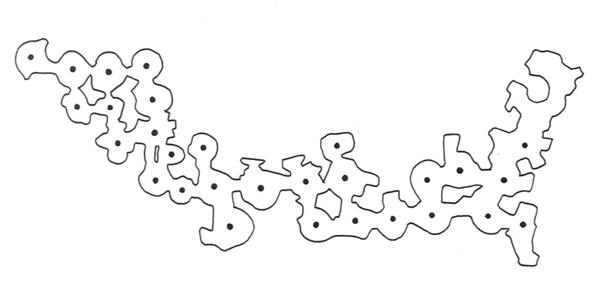
La carrière R12-1.
R12-2
C’est un vaste site qui comporte 120 catiches en quatre exploitations distinctes (38+50+10+22). Ces excavations sont situées à proximité de la rue de l’abbé Jacques Toulemonde. L’exploitation à 10 catiches a été remblayée en des temps reculés. Les autres l’ont été lors de la construction des lotissements. D’un point de vue extractif, c’était un seul volume de vides pour l’ensemble 38+50. Un dernier site de 22 catiches plus au sud complète le tout. A savoir que 25 catiches existent de l’autre côté du chemin d’Esquermes, mais le plan dont nous disposons est incomplet.
Nous avons affaire très visiblement à quatre exploitations différentes. Les schémas d’exploitation ne sont pas similaires. Celle du milieu est ancienne (R12-2-2) et correspond quasiment à un chambres et piliers des temps Renaissance. L’exploitation Nord et l’exploitation Sud sont deux excavations ordonnées ayant pu servir aux fours à chaux. Il est à imaginer que les sites se sont recoupés avec le temps.
Il est impossible d’étudier ces exploitations autrement que par déduction, car à ce jour tous ces sites d’extraction sont remblayés. Le seul point réellement interpellant est la présence de cette exploitation ancienne, phagocytée dans des exploitations récentes. Vu le schéma de creusement et considérant les habitudes locales, nous estimons que la carrière ancienne a été creusée dans un créneau de dates s’étalant de 1720 à 1760.
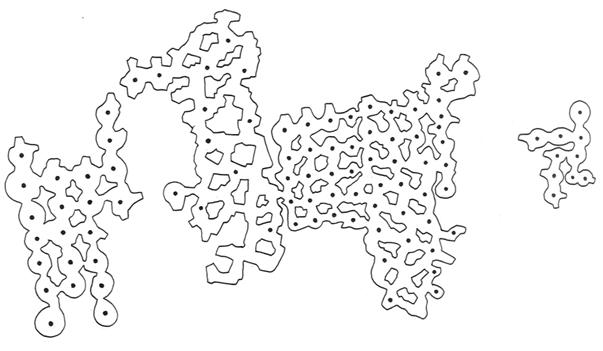
A gauche, la carrière R12-2-1, au milieu R12-2-2 et à droite, R12-2-3.
R13-1
Cette exploitation toute en longueur est située immédiatement au nord de la R13-2. Elle a de même scrupuleusement suivi les limites de propriété, tout en prenant le soin de ne les dépasser « que » d’un mètre, mais pas plus ! Pas fait exprès ! Cette exploitation comporte 41 catiches.
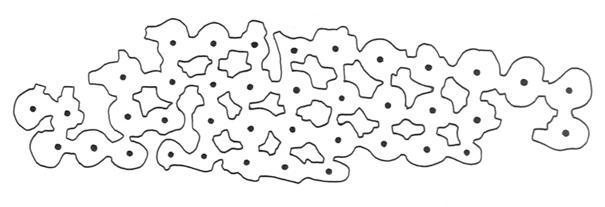
La carrière R13-1.
R13-2
C’est un vaste site en tout catiches, ordonné, qui a suivi les limites de propriété avec scrupules, ce qui peut s’avérer rare. Cette exploitation comportait 103 catiches et a fait l’objet d’un remblaiement complet lors de la construction du lotissement rue Paul Eluard.
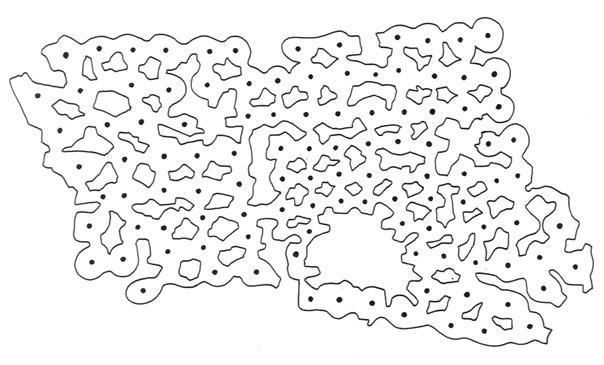
La carrière R13-2.
R13-3
Nous ne disposons pas du plan, mais seulement du contour. C’est une petite exploitation en tout catiches, très bien alignées, et comportant 27 catiches. Elle sous-mine une cour de l’école primaire Guy Mollet. Vu l’absence d’information, nous supposons que tout a été comblé.
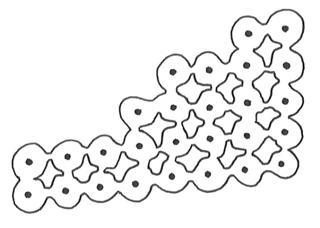
La carrière R13-3.
R13-4
C’est un site de catiches situé près de l’église paroissiale du Christ Ressuscité et entièrement démoli par comblement et compactage. La carrière comportait 46 catiches.
R14-1
Petite carrière de 10 catiches, affectant la rue des Forsythias, et totalement remblayée en 1999. Ce site semble être le satellite d’autres plus vastes.
R14-2
Petite carrière de 4 catiches, affectant la rue des Forsythias, et totalement remblayée en 1999.
|
La carrière R14-2. |
R15
Cette carrière à catiches affecte la salle Jean Moulin, devenue actuellement le dojo de Ronchin. Le plan émane très visiblement d’une gravimétrie, vu qu’on voit les traces de traînées. Le site comporte 60 catiches dans un plan assez bien ordonné. Cette carrière sous-cave la totalité de la salle. Elle a été visiblement visitée postérieurement vu les détails mentionnés (calotte effondrée, etc). Nous n’en savons pas plus.
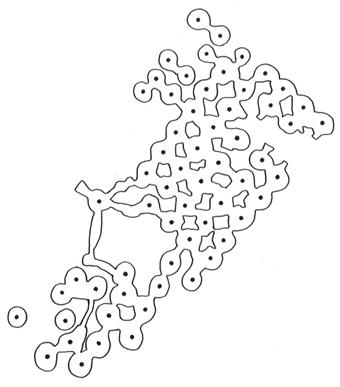
La carrière R15.
R16
Un plan de Lesquin mentionne une minuscule carrière à la rue Georges Basquin. C’est probablement une détection de gravimétrie car le champ ne possède aucune plaque. Par défaut, il a été compté 4 catiches pour ce site.
Le recensement de 1906
Les carrières de Ronchin sont récentes. De ce fait, il pourrait s’y localiser de nombreux chaufourniers. Cependant le recensement de 1906 restera bref, et ce n’est pas faute à l’écriture difficile à lire. Tout a été dépouillé durant des semaines. Voici le court inventaire des personnes concernées par les carrières.

Fontaine Paulin, né en 1863, champignonniste chez Crombez à Faches.
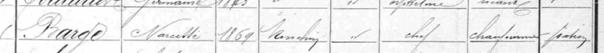
Barge Narcisse, né en 1869, champignonniste à son compte.
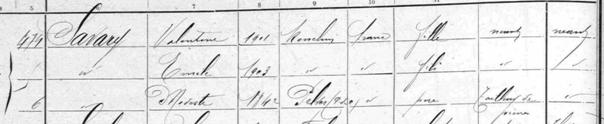
Savary Modeste, né en 1842, tailleur de pierres.
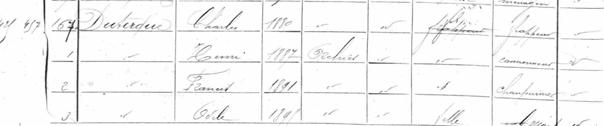
Duterque Francis, né en 1891, et chaufournier.
Ajoutons que dans un acte de Maître Pierre Antoine Duhayon, notaire à Ronchin en 1824, traite d'une cession mobilière dans lequel Etienne Wattrelos, cultivateur de Ronchin cède à Xavier Déchin, Désiré Leclercq, carriéreurs à Faches et Bernard Descamps, carriéreur à Ronchin, la pierre blanche à extraire sous un terrain situé à Lesquin. Ceci nous ajoute quelques noms de carriers.
Synthèse
1) Du point de vue du comptage des sites souterrains, nous préférons aborder la question avec de grandes précautions, comme évoqué précédemment, vu la conjugaison de plusieurs aspects :
- Les petits sites de quelques catiches pullulent.
- Certains sites sont juxtaposés voire même, un est imbriqué.
- Un seul site comporte un tiers des catiches que nous évoquons. Pour autant, ce n’est pas forcément le site le plus intéressant.
De ce fait, nous préférons établir avec simplicité que nous avons globalement une trentaine de sites souterrains (28), possédant toute la panoplie représentative de ce qui s’est fait dans le Mélantois.
Les carrières médiévales et l’extraction en besoins de pierre de taille : R04, R05-1, R07, R12-2-2.
Les carrières destinées à la chaux : R01, R02, R03, R10-1, R10-2, R10-3, R05-2, R05-3-1, R05-3-2, R06, R08, R09, R12-1, R12-2-1, R12-2-3, R12-2-4, R13-1, R13-2, R13-3, R13-4, R14-1, R14-2, R15, R16.
Avec toutes les précautions qui s’imposent, que peut-on déduire de ce comptage ? Quatre carrières plus ou moins médiévales et vingt-quatre sites d’extraction récente ; dans les récentes la R08 totalisant un très grand volume. Une seule conclusion s’impose, Ronchin est plutôt un territoire d’exploitations récentes.
Dans les temps médiévaux, des creusements ont été réalisés, sans que cela ne fasse appel à une logique ordonnée, au contraire du territoire de Lezennes, ou le schéma d’exploitation est très lisible. Après, de 1780 à 1820, l’extraction de la chaux amène une ruée vers l’or. En cela, le territoire de Ronchin est comparable en totalité à sa voisine Faches-Thumesnil. La ressemblance est telle qu’on en viendrait à penser que les territoires sont indissociables.
2) La localisation des sites souterrains ne permet pas une globalisation. En effet, le territoire est largement affecté, comme en témoigne d’ailleurs et à ce titre le PPRMT. Tout juste pouvons-nous dire que, majoritairement, les sites sont situés plutôt à l’ouest et plutôt au sud du territoire.
La proximité de Faches-Thumesnil reste là encore une influence qui est lisible. Les plus gros sites et les plus grosses concentrations de catiches sont à la proximité de ce territoire. La carrière médiévale R07 est la seule qui affecte le bourg ancien de Ronchin. Elle apparaît isolée par rapport aux autres sites d’extraction.
L’influence de Lille ne se ressent pas, du fait que les sites d’extraction lillois sont éloignés (globalement Hellemmes et Lille-Sud). La proximité de Lezennes n’a non plus aucune influence étant donné que de très larges portions du golf ne sont pas exploitables pour des raisons géologiques. L’influence de Lesquin est négligeable vu que cette dernière était un faible site d’extraction. Bref, nous sommes donc pleinement en rapport avec Faches-Thumesnil et plus précisément encore, avec Thumesnil seule.
3)
Quant aux exploitants, malheureusement nous ne savons rien et cela perdurera
assez vraisemblablement. Qui sera le chercheur apportant la manne
céleste ?
Lesquin, hôtel-catiches
Lesquin est une commune du sud-lillois. Elle est assez bien connue de par la présence de son aéroport, dont une partie de l’infrastructure est située sur la commune de Fretin. Le territoire de la commune de Lesquin est concerné par la présence de catiches. Mis à part quelques articles de presse sporadiques et déformés, les catiches sont mal connues. Pourtant, l’entité connait un patrimoine souterrain plutôt intéressant.
Cet écrit ne prétend nullement à l’exhaustivité, considérant que les recherches ne sont pas achevées, et elles ne le seront pas de sitôt. En effet, les plans font apparaître d’assez larges zones de catiches suspectées. De ce fait, il pourrait y avoir à l’avenir de nouvelles découvertes de carrières souterraines.
D’emblée, nous minorons tout propos catastrophiste (du genre Metro News). Ces carrières sont situées dans des terrains visés d’office dans un secteur bleu du PER. Cela signifie, en pratique, que ces terrains ne sont pas urbanisés, pas urbanisables sans contrainte(s) et voire même, ce sont des lieux laissés à l’écart. En effet, il peut s’agir d’espaces verts bordant l’autoroute A1, des terrains privés clôturés et interdit d’accès, etc. Tous les secteurs « sous » l’autoroute A1 ont été sondés et, selon nécessité, remblayés. Bref, il n’y a pas danger pour la population lesquinoise.
Nous proposons ici une étude en deux parties.
1) La description des carrières existantes.
2) Les recherches généalogiques au sujet des carriers. En réalité, seule cette part nous intéresse, mais elle est indissociable d'une description globale des sites.
La description des carrières existantes
Une différentiation importante doit être faite entre les déclarations de carrières et les carrières réellement connues. Les déclarations furent réalisées en nombre assez important, à savoir une quinzaine. Or, seulement cinq espaces d’exploitation sont actuellement reconnus et cartographiés.
Les secteurs concernés sont :
1) Le quartier du Moulin de Lesquin, lequel est affecté par de petites exploitations. Ce sont apparemment les plus anciennes.
2) Le golf. Cet espace est situé à cheval sur les communes de Lesquin, Ronchin et Lezennes. Il a existé des déclarations d’ouverture sur le territoire de Lesquin, mais des microgravimétries n’ont pas permis de les localiser. Tout du moins à l’état actuel des connaissances, elles ne sont pas percées de puits et cartographiées.
3) Le sud de la commune, dans un assez large périmètre au nord de la Pissatière. Ce sont des carrières plutôt vastes, bien connues et bien cartographiées.
4) Une déclaration de carrière affecte la route d’accès à l’aéroport, mais aucune carrière n’y a été détectée. Il se pourrait qu’elle n’ait jamais été ouverte.
Dans l’ensemble, aucune carrière n’affecte le centre-ville. Tous les sites « réels », c'est-à-dire connus par cartographie, se situent à la limite avec Faches-Thumesnil. Lé géologie des sols ainsi que le niveau de nappe phréatique déterminent cela. Au sujet des catiches qui sous-minent les pistes de l’aéroport, il s’agit tout bonnement de légendes. Un certain nombre de déclarations de carrières mènent à des impasses. Dès lors, seuls deux secteurs nous intéressent : les catiches anciennes du Moulin de Lesquin, les catiches plus récentes du secteur Nord Pissatière.
Le Moulin de Lesquin
Ces catiches anciennes dateraient de 1780-1790. Nous le devinons du fait des exploitants qui sont concernés par ces excavations. Un fait assez rare, la carte de l’état major, dressée entre 1820 et 1866 (la date exacte du Lillois, nous ne la connaissons pas) mentionne les carrières. C’est en fait à signaler car peu de carrières sont mentionnées lorsqu’on parcourt les communes avoisinantes.

La carte du cadastre de 1812 ci-dessous ne les mentionne pas.
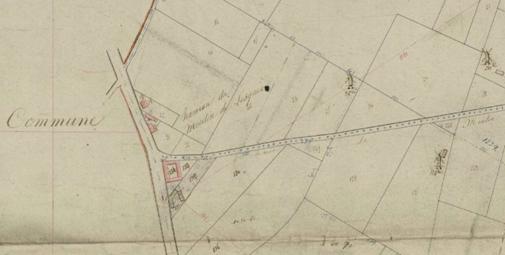
Les carrières du Moulin de Lesquin ont été recherchées par le SDICS. Une a été localisée, les autres semblent être remblayées de longue date. Nous relevons :
a) Une exploitation située au n°33 route de Douai. Elle comporte 27 catiches. Tout laisse à penser que cette carrière a été remblayée en totalité de manière récente.
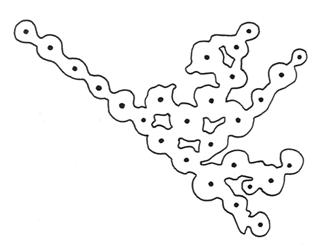
Les autres exploitations, inévitablement de petite taille, sont inconnues. De ce fait, l’étude du secteur Moulin de Lesquin est réduite à portion congrue. Dans ce secteur tout de même assez bien urbanisé, la présence de carrières aurait été détectée lors de constructions. De ce fait, l’hypothèse de comblements anciens n’est franchement pas négligeable.
Les autres catiches nous intéressant se situent toutes au sud de la commune. Par facilité, nous différentions la partie Est de l’autoroute, côté Lesquin, et la partie Ouest, côté Faches. A l’époque l’autoroute n’existait pas et tout cela ne formait qu’un seul secteur. De toutes les cartes anciennes, ces carrières n’existent pas, ce qui justifie quelque part leur aspect récent.
Le secteur Est
b) Il s’agit d’une vaste exploitation. Elle est « naturellement » découpée en quatre parties, lesquelles étaient attenantes et connectées dans le passé. A ce jour, de nombreux remblais sectionnent totalement l’exploitation.
La carrière comporte 189 catiches. Nous dénombrons excavation 1 : 44 catiches, excavation 2 : 46 catiches, excavation 3 : 42 catiches, excavation 4 : 51 catiches, plus 6 catiches annexes éparpillées. Aurions-nous eu quatre exploitants tirant la pierre dans la même période, et tous stoppés en même temps ? La similitude des nombres est quelque peu interpelant.
Notons que les volumes d’excavations sont très réguliers. Cela atteste encore l’aspect récent de ces travaux d’extraction. Au niveau de ce secteur Est et comme nous l’évoquions, le site est désormais fracturé en nombreuses entités totalement distinctes. Cela entraine une mauvaise compréhension du volume souterrain. Soit, les nécessités de remblaiement étaient bel et bien présentes.
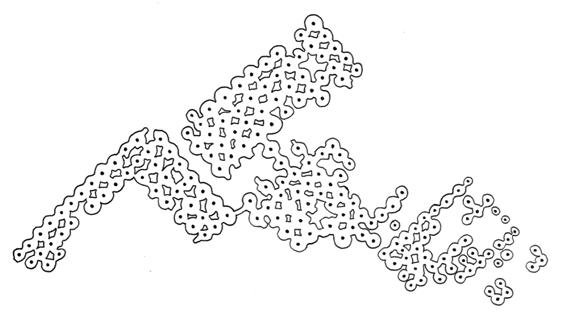
Le secteur Ouest
c) Il s’agit d’une fort vaste exploitation. Elle est d’un volume plutôt monolithique, signalons juste qu’elle possède quelques catiches dispersées sur le pourtour.
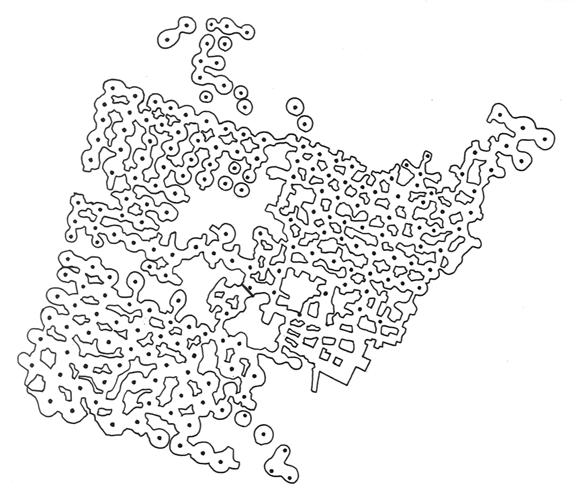
La carrière possède 197 catiches et 22 catiches plus ou moins annexes. Nous figurons le terme de ‘plus ou moins’ du simple fait que ces catiches sont strictement attenantes au réseau principal. Le total est de 219 catiches.
Cette valeur de 219 catiches est à prendre avec précaution étant donné qu’un bunker existe au sein de la carrière. Un certain nombre de catiches (nous estimons 10 à 12) ont été transformées. Les murs sont en brique et béton. Selon Bernard Bivert, ce site aurait permis le cantonnement des troupes. Disons dès lors qu’une valeur initiale de 230 catiches est à considérer, sans que cela ne soit le témoignage d’une exagération.
L’urbanisation très récente des lieux a entraîné la construction au dessus des catiches. Dans l’étape précédant cette construction, 66 + 5 catiches ont été totalement remblayées. Cela ne sectionne pas l’excavation, mais condamne définitivement l’accès à une vaste partie Nord.
Si l’on suit la géographie du bassin crayeux vers Faches, on trouve l’existence de trois exploitations plutôt vastes sous les terrains d’Auchan, Amiland, Intersport, etc. Ces carrières ont été inévitablement remblayées par l’urbanisation récente.
Au secteur Est viennent s’ajouter quelques exploitations annexes et tout à fait anecdotiques.
d) Dans un terrain désaffecté, deux exploitations distinctes de 6 catiches. Ces 12 catiches n’amènent aucune remarque, si ce n’est qu’une, instable, a été comblée.
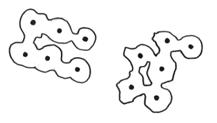
e) Dans un terrain privé, clôturé et non utilisé, une exploitation de 9 catiches. Cette excavation semble être en très mauvais état général, ce qui se retraduit notamment par des cratères en surface. Si la presse se focalise à ce sujet, notons que ça n’a aucun intérêt et que les lieux sont inaccessibles au public.
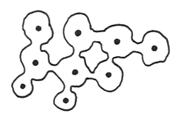
Selon Bernard Bivert, Lesquin totalise 550 catiches pour 100.000 mètres cubes d’extraction.
Selon nos estimations, Lesquin totalise 467 catiches pour 81.000 mètres cubes d’extraction.
Nous n’avons pas d’explication à ce sujet, hormis que Bernard Bivert localise éventuellement de potentielles exploitations sous le golf, ce dont nous n’avons pas connaissance. Cela pourrait aussi provenir des catiches de la rue des Meuniers. Une fort ancienne déclaration de carrière a existé, mais cette dernière n’a jamais été détectée, malgré les microgravimétries, les détections magnétiques et les chantiers. Ce secteur est en blanc dans le PER.
Les recherches généalogiques au sujet des carriers
Bernard Bivert cite les noms de Pierre Raoul et Jacques Badoux, actifs en 1781, au Moulin de Lesquin. Ces deux individus nous sont inconnus, le premier pour cause de très grande banalité du patronyme, le second parce qu’aucune information ne nous est disponible. Il s’avère en fait qu’il n’est nullement étonnant que le Sieur Badoux nous soit inconnu. En effet, il est assez probable qu’il faille lire Jacques Randoux. Il faut dire que certaines déclarations d’ouverture de carrières sont si mal écrites, comment s’étonner des difficultés de lecture !
Plus en détails, le 21 février 1788 est réalisée une contravention à l’encontre de deux carriers. Bernard Bivert cite que cette procédure est menée à l’encontre des Sieurs Loblin et Badoux. En réalité, le texte d’archive nous apprend qu’il s’agit d’une : Ordonnance condamnant les nommés de Loblin et Randoux des villages de Faches et Thumesnil, chacun à 300 livres d'amende pour avoir ouvert une carrière près du moulin de Lesquin sur la chaussée de Lille à Douai, avec injonction de les combler.
Il est donc envisageable de déclarer que nous avons affaire à Pierre Raoul, Jacques Randoux et le Sieur Loblin. Ces trois personnes pourraient être originaires de Faches ou de Thumesnil. Nous n’avons aucune information les concernant tous trois. A savoir que les Raoul / Raoux / Raoust / Rahoux et variantes sont un très grand foyer apparu à Faches au début des années 1610. Quant au "sieur Loblin", il doit s’agir de la grande famille Lamblin qui provient de Vendeville à la base et dont une branche s'est installé sur Faches. « Loblin » n'existe pas dans le secteur du Mélantois, ou bien il s'agit d'une grossière déformation.
Duhaillon Antoine – déclaration de carrière en 1851. Nous ne disposons d’aucune information. Une simple précision peut être apportée, dans le sens où Duhaillon est un nom assez rare et bien représenté dans le département du Nord. Il ne doit donc pas y avoir de faute d’orthographe.
Bernard Bivert cite dans son opus un les familles Deschamps – Lefebvre – Leclercq, actives dans le secteur carrier. Quelques précisions peuvent être apportées.
Deschamps Jean-Baptiste – déclaration de carrière en 1852. Cette personne nous est connue. Son acte de baptême est disponible ci-dessous. Né le 8 juin 1790, il fut baptisé à Lesquin le 9 juin 1790. Il est le fils de Jean-Louis Des Chant (sic) natif de Ronchin et de Rosalie Rachez, native de Lesquin.
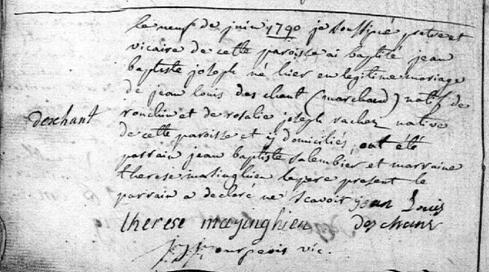
L’acte de baptême de Jean-Baptiste Dechamps.
Cyrille Glorieus précise : l'acte de baptême de Jean Baptiste Deschamps est écrit « Deschant », le curé écrivait comme il le voulait à l'époque. Il faut lire Jean Louis Deschamps (marchand) natif de Ronchin et Rosalie Joseph Rachez native de Lesquin.
Un acte de décès est proclamé le 23 décembre 1866 à Faches, concernant un certain Jean-Baptiste Deschamps. Attention, il s’agit d’un piège, et notamment un homonyme, car le défunt a 6 mois. Son père est Hercule Deschamps. On y apprend la présence de Marie Louise Leclercq, ménagère, son épouse. Cette donnée nous intéresse étant donné que cela nous apporte des précisions quant aux familles Deschamps – Lefebvre – Leclercq précitées.
Dame Veuve Lefebvre de Deschamps Florentin – déclaration de carrière en 1876.
Deschamps Florentin nous est connu comme étant né le 08 novembre 1847 à Lesquin. Fils de Louis Auguste Dechamps et de Marie Louise Adélaïde Joseph Devendeville. Déclaration faite en présence de Florentin Deschamps, 64 ans, cultivateur et domicilié à Faches. Nous ne disposons pas d’autre information. Cela nous donnerait un décès de Florentin à 29 ans, c’est fort jeune. Le grand-père du même nom aurait eu quant à lui 93 ans en 1876.
Nous relevons de même un mariage contracté entre un certain Deschamps Florentin et Delezennes Florence, le 31 janvier 1816. Cela n’a rien à voir avec une dame veuve Lefebvre. Nous relevons encore un Deschamps Florentin né à Faches le 15 avril 1860. La date nous semble incohérente. Notons aussi qu’un Florentin Deschamps est baptisé le 5 mai 1785 à Ronchin. Là encore, la date place le personnage hors contexte.
De ce fait, nous nous bornerons à citer ces informations factuelles, et de dire que concernant toute extrapolation, les données sont floues.
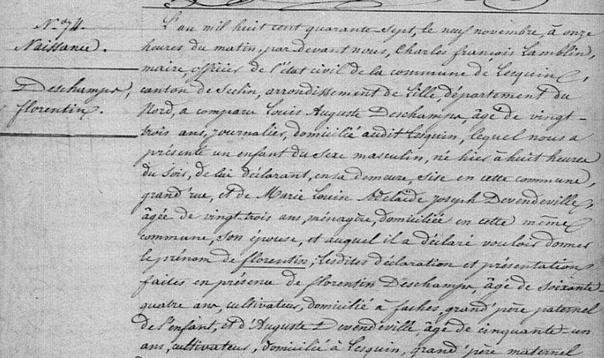
L’acte de naissance de Florentin Dechamps.
Lefebvre Flore, chaufournière – déclaration de carrière en 1876. Quelques individus de ce nom sont connus, mais ils ne sont pas domiciliés dans des lieux concordants. Nous retrouvons par contre sa trace de manière extrêmement ténue.
Elle « pourrait » être la fille d’Auguste Lefebvre, ce dernier né le 30 juin 1837 à Lesquin, et de Florine Henriette Baratte, née à Lezennes. Auguste Lefebvre est chaufournier à Lesquin. Seul anachronisme de taille, Flore Lefebvre serait née le 21 janvier 1871 à Annappes. Nous citons cette information car nous possédons un doute quant à la date, vu que l’acte est incomplet.
Badoux Jacques – déclaration d’une carrière, active dans la période 1876-1885. Nous ne possédons aucune information.
En tant que chaufournier, et donc en l’absence de toute déclaration officielle de carrière, nous relevons l’existence de Lefebvre Marie Joseph Désiré, né le 7 février 1791 à Lesquin et décédé après 1860 à Faches-Thumesnil. Notons que nous ne savons pas s’il est actif à Faches ou à Lesquin.
Le recensement de 1906
La commune ayant un patrimoine souterrain assez récent, nous avions espoir de retrouver des carriers. Cependant nous n’avons retrouvé que des chaufourniers, à Faches et à Lille. Nous les citons dans le but d’être complet, mais ils ne furent pas carriers à Lesquin.
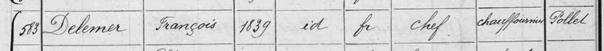
Delemer François, né en 1839, chaufournier chez Pollet de Lille.
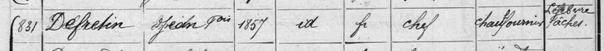
Defretin Jean-François, né en 1857, chaufournier chez Lefebvre de Faches.
![]()
Defretin Jean-Baptiste, né en 1838, chaufournier chez Lefebvre de Faches.
![]()
Buisine Charles, né en 1840, chaufournier chez Pollet de Lille.
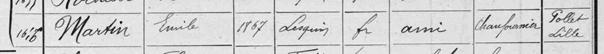
Martin Emile, né en 1867, chaufournier chez Pollet de Lille.
Au vu des trouvailles en archives, les conclusions ne peuvent être que succinctes.
* Des carrières visiblement plus anciennes, situées dans les alentours du Moulin de Lesquin, dans une période avoisinant les 1780-1790. Les exploitants sont tous très mal identifiés.
* Des carrières postérieures, exploitées en tant que chaufours, dans un créneau de dates 1850-1885. Les familles Deschamps – Lefebvre – Leclercq sont visiblement impliquées dans l’industrie chaufournière. Notons que ces noms sont notablement connus dans les localités voisines de Lezennes et Faches, dans de mêmes secteurs d’activité.
Cela signifie que l’extraction a tâtonné en de petites exploitations, sur une période de 10 ans et quelques, à partir de 1780. Cela fut probablement artisanal. Par la suite, deux grands sites se sont ouverts. Ces exploitations ont été supposément ouvertes en même temps. Il fut mené une extraction de chaux assez intensive sur une période de 35 ans, à partir de 1850.
Nous ne serions pas étonnés outre mesure qu’entre 1790 et 1850, il ne se passe rien d’un point de vue extractif. La pierre de taille était en chute libre et l’industrie chaufournière plus ou moins naissante. En tout état de cause, ces deux périodes extractives ne sont certainement pas comparables.
* Le patrimoine carrier de Lesquin est en forte récession sur ces 20 dernières années. C’est un peu le modèle actuel de l’urbanisation qui veut ça, si ce n’est qu’à Lesquin même, c’est assez marqué. Dans de nombreux cas (si ce n’est tous), il faut se méfier des dires de la presse.
* Les carrières souterraines de Lesquin sont contemporaines de celles de Faches, en tout cas en ce qui concerne les excavations de type catiches (Faches comporte quelques secteurs médiévaux). Elles sont un peu comparables à Wattignies et Seclin mais concernant ces dernières, ce sont de nombreux petits sites éparpillés. En matière de technique d’exploitation et de période, c’est entièrement comparable.
*
Lesquin comporte deux sites souterrains majeurs et forts intéressants. Les
exploitants semblent difficilement dissociables de l’histoire de
Faches-Thumesnil.

Faches, la fascinante
Si l’on considère l’ensemble des catiches du Mélantois comme un tout, au sein de ce grand mélange de cultures et de pratiques, Faches-Thumesnil ressort comme étant assez bien connue du public. Malheureusement, cette connaissance s’accompagne d’une réputation exécrable pour le moins injustifiée. Quelques effondrements spectaculaires ont eu lieu, ce qui a permis à la presse de s’emparer du sujet. Or, même si ces rares accidents furent calamiteux en termes matériels, les souterrains de Faches sont très loin de se borner à une indistincte bouillie de dangers invisibles. Au même titre que Loos, Faches possède un patrimoine ample, riche et varié. Ce document fait le point sur l’ensemble de ce patrimoine.
Bernard Bivert a dénombré, lors de sa carrière au sein du SDICS, la valeur de 33 carrières souterraines creusées sous le territoire Faches-Thumenislois. En comparaison avec Seclin ou Lesquin, c’est élevé. Nous en dénombrons quant à nous un nombre supérieur. En réalité il est quasiment impossible de prétendre à l’exhaustivité tant les sites sont difficiles à caractériser. De plus, entre les petites et les grandes carrières, les remblayées et les non-remblayées, que comparer ? Disons simplement que le nombre est élevé.
Ces carrières sont intéressantes à de nombreux titres. Bien que cela ne surpasse pas les carrières de Lezennes, il existe une série d’intérêts qui mérite d’être mis en valeur : historique, technique, esthétique. En effet, le point de vue historique n’est pas absent, car les carrières anciennes sont archéologiquement parlant des vestiges intéressants. L’aspect technique est quant à lui époustouflant, comme à Loos. La plus grande des carrières de Faches totalise à elle seule 652 catiches. C’est un véritable labyrinthe. Quant à l’aspect esthétique, il n’est autre qu’indéniable.
De ce fait, nous considérons Faches comme une commune majeure du point de vue des catiches. Seule trois autres communes peuvent rivaliser : Loos, Lezennes et Hellemmes.
Nous proposons ici une étude en deux parties.
1) La description des carrières existantes.
2) Les recherches généalogiques au sujet des carriers. En réalité, cette part nous intéresse le plus, mais elle est indissociable d'une description globale des sites.
La description des carrières existantes
La description des carrières est un sujet difficile étant donné que c’est une description d’ampleur. Si sur Haubourdin, ça demande quelques lignes, ici d’emblée la question qui se pose, c’est comment synthétiser ? Un livre serait à écrire rien que sur Faches.
Résumé
- Les carrières anciennes se situent en deux endroits : l’une (en deux sections) à la rue Kléber près de l’église Sainte-Marguerite, deux petites autres au quartier de la Jappe.
- Les réseaux les plus importants en développement se trouvent dans le quartier de la Croisette, avec de très larges extensions sous Les Maréchaux et la rue de la Résistance. Tout cela donc pour dire : majoritairement le nord de la commune et sur le territoire de Thumesnil.
- Trois carrières de grande dimension ont été creusées au tout à fait sud de la commune, à la limite territoriale avec Lesquin. Ces carrières, affectant de grandes zones commerciales, ont été totalement remblayées.
Selon Bernard Bivert, Faches totalise 3174 catiches pour 570.000 mètres cubes d’extraction.
Selon nos estimations, Faches totalise 3307 catiches pour 600.000 mètres cubes d’extraction.
Il est très difficile d’estimer ces volumes, car d’une part nous possédons un inventaire que nous savons être incomplet. D’autre part, les découvertes de nouvelles catiches sont régulières. D’autre part encore, parce que cet inventaire ne tient pas compte des remblaiements.
Habituellement
nous sommes inférieurs aux valeurs de Bernard Bivert. Nous préférons simplement
préciser que ces valeurs sont à considérer avec de grandes précautions.
Inventaire des cavités
Fa1
Il s’agit d’une assez vaste carrière, qui sous-mine un terrain qui se trouve
désaffecté à ce jour. La désaffectation n’est pas spécialement liée à un
mauvais état du site souterrain, considérant que celui-ci se trouve dans un bon
état global. Aucun effondrement n’est à déplorer jusqu’à présent. Cette
carrière est située à proximité immédiate de Ronchin et forme un prolongement
géographique de cette dernière ; tout en précisant bien que les exploitants
sont différents, vu que le creusement n’est pas de forme identique.
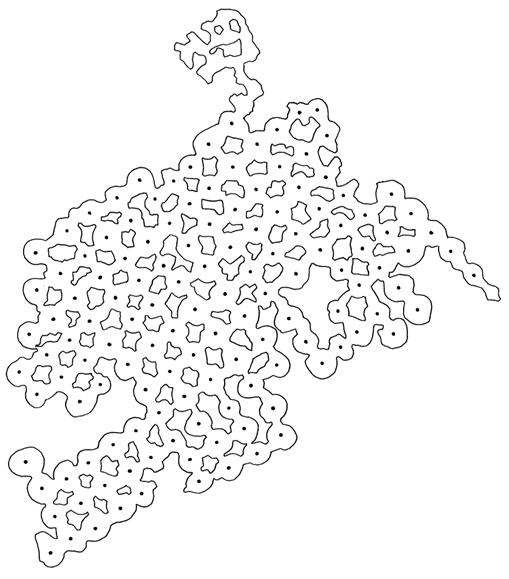
Le volume bien régulier de la carrière Fa1.
En cette carrière, le creusement pourrait dater d’une période 1900-1905, vu les quelques rares graffitis existants. Il est à penser que ce fut une exploitation de chaux sucrière. Le schéma d’exploitation est en tout catiches, elles sont pour la plupart parfaitement alignées. Le site totalise 142 catiches.
Dans l’une des extrémités du réseau se trouve une toute petite carrière médiévale. Elle est surélevée par rapport au fond de catiches ou disons le plus simplement, elle est creusée à moins grande profondeur, comme bien souvent dans le cadre des carrières médiévales. Ce petit réseau est malheureusement dénué de tout intérêt. Un délavage du remblai argileux provoque naturellement un beurrage de toutes les parois avec une glaise collante marron foncé. Aucun graffiti ancien n’est lisible.
Au sein de la partie récente de la carrière, Cyrille Glorieus a localisé les inscriptions :
- Demessine Désiré 1900 Nord.
Et plus loin : 1897.
Nous estimons qu’il s’agit de Demessine Désiré Joseph, né vers 1875, marié à Loeil Lucie Victoire le 3 août 1919 à Lesquin.
- Lantoing 1912 et Louis Lantoing 1912
- Fernand Desmarescaux 1912, qui se retrouve dans le recensement de 1906, rue de Lesquin à Faches, fils de Léandre, ce dernier qui est champignonniste.
- Pollet / 3me / 24 septem/
Il pourrait s’agir du Pollet habitant à la route de Douai côté Faches.
- Jules Courbeville de Loos. Il s’agit de Jules Courbeville, champignonniste chez Roussel habitant rue de Wattignies à Loos.
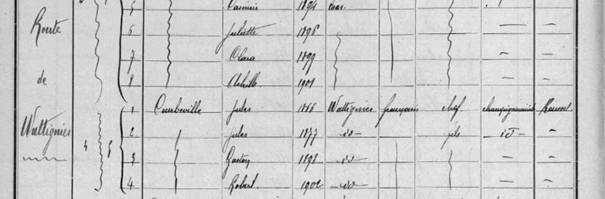
La complication est qu’il y a deux Jules Courbeville, le père et le fils, et tous deux travaillaient chez Roussel… Le recensement indique que Jules père aurait eu Jules fils à. 11 ans. Impossible. Petite vérification : Jules fils est bien né en 1897 à Wattignies ~ l'Arbrisseau et non 1877. Cependant, difficile de dire lequel des deux a écrit son nom.
Fa2
Ce sont deux fort petites carrières, situées sous la rue de la Jappe. L’une
d’entre elles est accessible par une cave. Il pourrait être soupçonné que ces
vides relèvent d’un caractère médiéval, vu le type de creusement. Cependant sur
de si petits volumes, c’est assez difficile à affirmer.
|
|
|
Les deux petites exploitations de la Jappe. |
|
Fa3
Ce site souterrain est intéressant car il s’agit de l’unique travail
d’excavation connu sous le vieux Faches. C’est un seul site d’extraction, pour
deux carrières souterraines presque jointives. Ces deux exploitations sont situées
près de l’église Sainte-Marguerite de Faches. Au vu du schéma d’exploitation et
la faible profondeur des travaux, il est clairement supposé que ces excavations
sont médiévales. Quant à les dater avec précision, c’est plus difficile.
Si les travaux sont contemporains de l’érection de l’église Sainte-Marguerite d’Antioche, ce serait alors une mise en exploitation datant du XIIIème siècle. C’est en tout cas de cette période là que datent certaines parts de l’église. Rien ne s’oppose non plus à ce que des travaux d’excavation aient été menés de manière postérieure. Quoi qu’il en soit, ces exploitations souterraines sont antérieures au XVIème siècle, car à cette période débutait le creusement généralisé en mixte-catiches.
Les carrières sont très basses. Les travaux dépassent rarement le mètre. Au vu des remblais incessants, il s’agit d’un volume de carrière difficile à visiter. Il n’existe pas d’inscription de carrier aisément décelable.
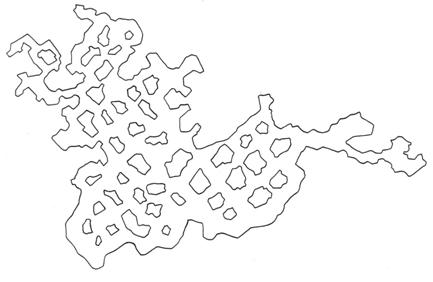
La première exploitation de la rue Kléber.
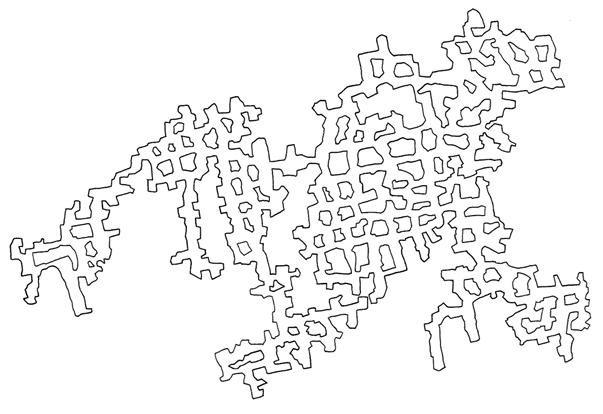
La seconde exploitation de la rue Kléber.
Fa4
Il s’agit d’une petite carrière en tout catiches, située rue de Joinville. Ces
catiches ne sont pas alignées, cela pourrait retraduire un travail relativement
ancien, éventuellement un début du XIXème siècle. La carrière comportait 26
catiches. Cette excavation a été totalement remblayée.
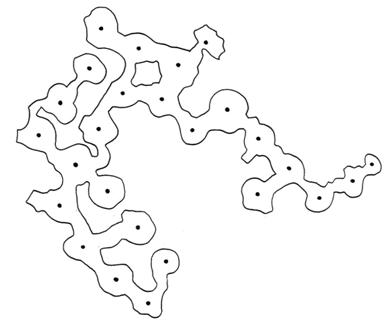
L’exploitation de la rue de Joinville.
Fa5
Cette carrière souterraine était située sous l’ancienne biscuiterie
Geslot-Voreux. Elle a été totalement comblée. C’était un site en tout-catiches,
avec un bel alignement de l’ensemble. On pourrait imaginer dès lors des travaux
assez récents, plus ou moins 1900. Le site comportait 159 catiches. Certaines
catiches n’étaient plus jointives aux autres. Le site n’appelle aucune autre
remarque étant donné que nous en ignorons pour ainsi dire tout.
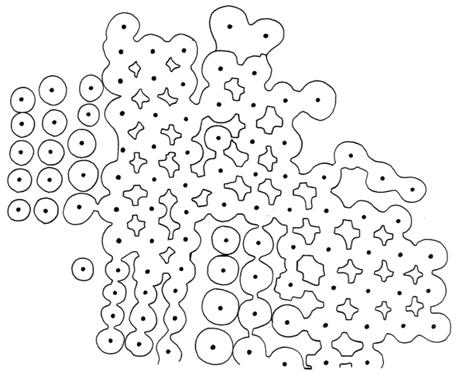
Un plan partiel de l’ancienne carrière Geslot-Voreux.
Fa6
Un très vaste site souterrain affecte le joli parc de la Croisette. C’est une carrière majeure décrite en Fa20. Autour de ce site de la Croisette se trouve une étonnante multiplicité de carrières. Ces sites ne sont aucunement jointifs car de courts massifs non exploités existent. Sans nul doute, il s’agit d’un respect de limites de propriété. A la suite de ces exploitations, les vides de carrières ont été massivement investis dans le but de cultiver du champignon. Il s’agit des exploitations du début du XIXème siècle nommées les champignonnières Crombez et / ou Crombet. Dans les registres anciens, ces deux orthographes sont sans cesse rencontrées. Aucune ne prédomine l’autre, nous ne savons pas de la sorte déterminer s’il existe une faute d’orthographe.
Ici la carrière que nous rencontrons, il s’agit comme sur de nombreux autres sites d’un vide de carrière satellite de la Croisette. Le terme de satellite fait penser à de petits espaces de carrières ; en bien des cas autour de la Croisette – disons le massif central – ce sont de vastes volumes, non pas équivalents en taille mais conséquents tout de même.
L’exploitation que nous abordons ici est nommée rue Alexandre Dumas, de par les terrains attenants qu’elle affecte. En réalité, ce nom n’a aucun sens historique. En effet il s’agit avant tout de la champignonnière Crombez. C’est un site historique dans lequel se déroula une culture massive de champignons. A cet effet, la carrière est fortement cloisonnée. Des murs légers ont été érigés afin de canaliser les courants d’air.
A ce jour, le site n’est plus utilisé en tant que champignonnière en souterrain. Les champignons sont cultivés en surface, dans un hangar situé au-dessus de la carrière. L’atmosphère de la carrière est puisée par un gros ventilateur. Cet air froid et humide, idéal au champignon, est pulsé dans le hangar. De la sorte l’ambiance hygrométrique de la carrière est reproduite dans le bâtiment. L’exploitation est menée par Monsieur Bernard Crombez.
Quant à la carrière elle-même, c’est un joli volume de catiches bien alignées, lequel comporte 327 catiches. Au sein de la Croisette, l’excavation se trouve au sud-est. C’est une exploitation qui est distincte et l’a toujours été. Le massif de séparation est important. L’excavation a été vraisemblablement réalisée en même temps que le site de la Croisette, vu que le schéma d’exploitation est identique.
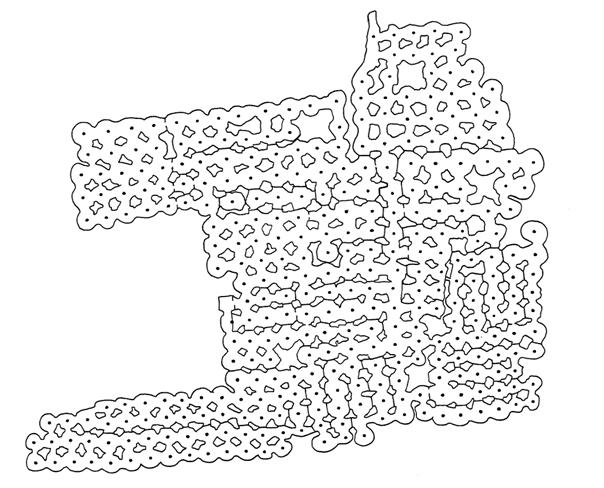
La champignonnière Crombez.
Fa7
Cette exploitation est un satellite de la Croisette. Cette excavation, nommée Gallieni de la rue éponyme, est située au nord-est de la Croisette. C’est une exploitation tout à fait indépendante car le massif non exploité est important, une fois encore dans ce que nous devinons un respect des limites de propriété. En cet endroit plus qu’ailleurs, on voit que ces limites ont été parfaitement respectées. Vu l’importance de l’activité extractive, nous supposons que tout cela était bien contrôlé par l’administration.
Nous ne disposons que d’un plan incomplet de cette exploitation. C’est un site hautement comparable à la Croisette, si ce n’est identique : alignement parfait des catiches, murs de cloisonnement des champignonnistes, soin dans le creusement des catiches. Ce plan, fort incomplet, laisse apparaître 163 catiches.
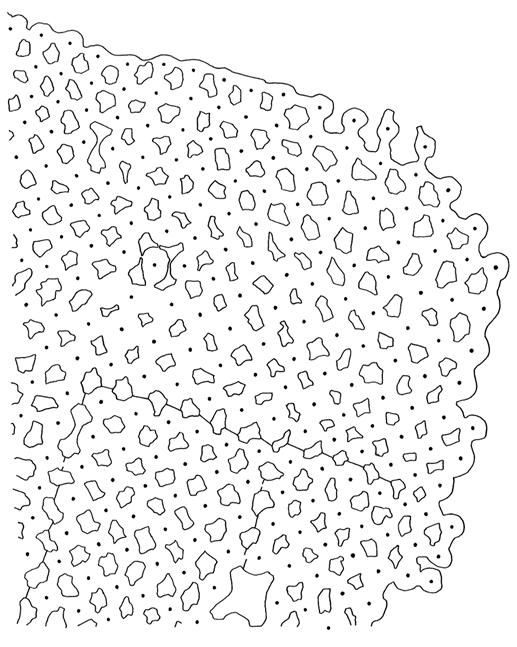
Un plan partiel de l’exploitation Gallieni.
Fa8
Cette mise en exploitation est un satellite de la Croisette. Il s’agit d’un site d’extraction situé rue du Maréchal Lyautey, du nom de la rue éponyme. Nous en disposons d’un plan largement incomplet, duquel nous relevons :
- Une suite jointive du plan de l’exploitation Gallieni. Nous y dénombrons 114 catiches complémentaires, tout autant alignées.
- A hauteur du puits de Monsieur Lion dans le site de la Croisette, à l’est, un massif exploité, que nous nommons l’exploitation du Maréchal Lyautey proprement dite. Ce plan incomplet mentionne 93 catiches. Cette excavation est proche de celle de Gallieni, dont elle est presque jointive. D’après le plan, les habitations ne sont pas sous-minées.
- Une petite exploitation complémentaire et totalement indépendante, située dans le bout de la rue du Maréchal Gallieni. Ce site comporte 25 catiches dans un schéma de creusement légèrement plus rudimentaire.
Notons donc que cet ensemble est relativement difficile à interpréter. Le site Gallieni attenant à la Croisette comporte au minimum 277 catiches, un petit site de 25 catiches est complémentaire. Le site du Maréchal Lyautey, dont notre connaissance est très lacunaire, comporte au minimum 93 catiches. Tous ces sites sont contemporains de la partie centrale de la Croisette.

Un plan partiel de l’exploitation Lyautey.
Fa9
Il s’agit d’une exploitation totalement imbriquée dans le site de la Croisette, et attenante aux vastes sites de la rue du faubourg d’Arras. Ainsi, nous ne dénombrerons que le réseau de catiches totalement indépendant. C’est une petite carrière située dans le chemin nommé Cité Opsomer. Ce site se trouve au nord-ouest du bloc central de la Croisette. On y trouve donc deux petites carrières, une première de 29 catiches, une seconde de 8 catiches. A l’est se trouve l’énorme site de la Croisette, à l’ouest et au sud se trouvent les exploitations de la rue du faubourg d’Arras.
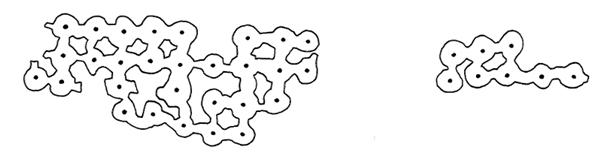
Les deux petites exploitations Opsomer.
Fa10 et Fa11
Ces deux exploitations sont les précitées en Fa9, situées rue du Faubourg d’Arras. Ce sont de vastes exploitations en tout catiches, quasiment attenantes au front de taille ouest de la Croisette. La première exploitation comporte 132 catiches et la seconde 50 catiches. Le plan de la seconde est très incomplet.
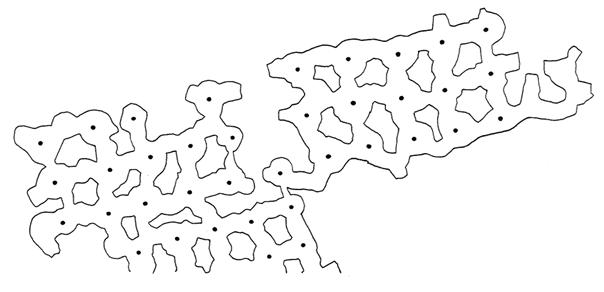
La seconde exploitation de la rue du Faubourg d’Arras.
Ces volumes de carrières sont particulièrement touchés par les rejets d’égouts en pleine catiche, ainsi que les catiches poubelles. Une large section de ces vides est insalubre, à tel point que l’atmosphère en est viciée. Notons notre totale incompréhension à ce sujet : comment cela peut-il encore perdurer de nos jours ? Les piliers sont affaiblis par les rejets incessants, ce sans compter l’aspect de pollution de la nappe engendrée. Etant donné que cette carrière sous-mine de l’habitat, nous ne comprenons pas comment les habitants peuvent laisser sciemment leur sous-sol se dégrader et par là même, déforcer le sol où ils sont assis ; lequel est déjà fragile ! Il va sans dire qu’il y a là un état de fait du plus alarmant.
En cet état des lieux, il est évident de dire que cet ensemble de carrières est désagréable à visiter. Ce sont des creusements récents qui, malgré le soin d’exploitation qui est moindre, pourrait dater d’une période contemporaine à la Croisette.
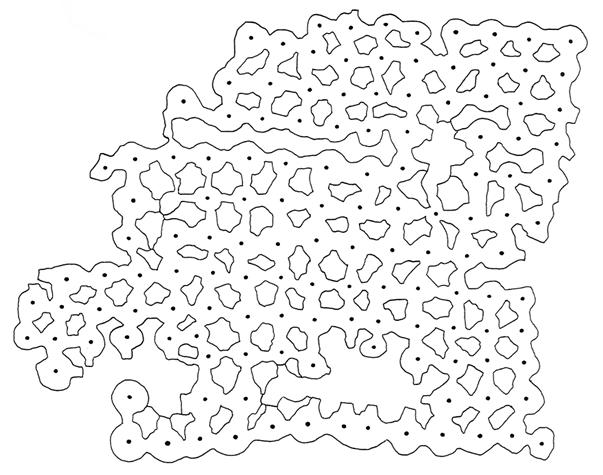
La première exploitation de la rue du Faubourg d’Arras.
Fa20
Nous intercalons dans la numérotation le site de la Croisette, que nous évoquons depuis le Fa6, c'est-à-dire le dénombrement des satellites. C’est comme nous le disions, un fort vaste site d’exploitation. Cette carrière sous-mine totalement le parc de la Croisette. Afin de stabiliser les catiches, chaque tête de puits a été plantée avec un arbre. Le système racinaire permet de stabiliser les terres argileuses au dessus des encorbellements. Une partie du parc est interdite d’accès du fait d’un risque d’effondrement.
Jusqu’à récemment (2015), le site était l’objet d’une culture active de barbe de capucins – sur 50 catiches – exploitée par les frères Patinier de Laventie : Damien et Alain Patinier. Du fait de vandalismes terriblement incessants sur leurs structures, ils ont décidé de stopper leur activité de culture. [Notons à ce titre qu’à peine arrivés sur le site, nous avons été pris pour cible de même].
L’exploitation de La Croisette est un des rares sites du Mélantois où les catiches sont alignées dans un état qui est qualifiable du plus parfait. Ce sont d’exceptionnels alignements, que seules de rares anomalies viennent perturber. L’exploitation comporte d’un seul tenant 650 catiches. Un second volume, moins bien rangé, est accessible via un tout petit tunnel de jonction. Dans la section nord-ouest se trouvent des volumes d’exploitation qui contournent la cité Opsomer. Ce site affecte notablement un hangar de la société Coca-Cola (ou ex-hangar).
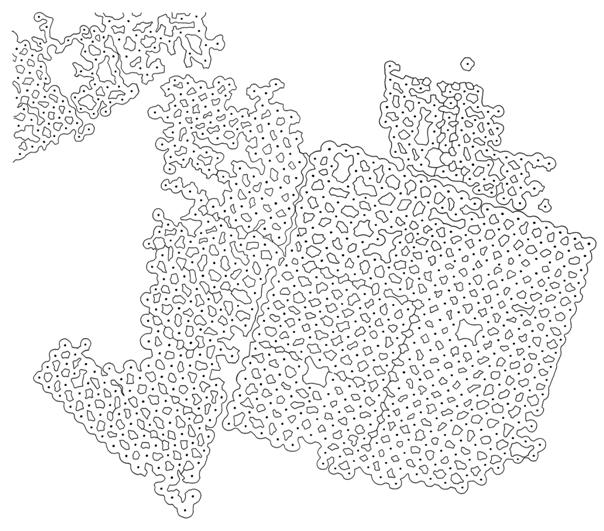
Le majestueux site de La Croisette.
En ce qui concerne le plan de l’exploitation, il s’agit du tracé le plus connu et le plus emblématique. En effet, dès que l’on parle de catiches, c’est à ce lieu qu’il est fait référence et bien souvent, l’emblème thumesnilois est utilisée afin d’expliquer le phénomène « catiches ».
Fa21
Cette excavation est un vaste site qui affecte le secteur sud-ouest de la Croisette. C’est là encore un joli alignement de catiches, dont le schéma d’extraction fait largement penser à une exploitation contemporaine à la Croisette. Ce lieu est distinct du site en question par un large volume non exploité. Nous avons donc affaire à un réseau totalement indépendant. A contrario, un tunnel traverse la rue d’Haubourdin (sans l’existence d’un maillage dense de catiches, d’où une volonté réelle de préserver cet ancien chemin de communication, très important à l’époque comme aujourd’hui d’ailleurs). Cette traversée entraine l’existence d’une excavation sur le territoire de Wattignies.
L’exploitation sur le territoire de Faches comporte 297 catiches et l’extension sur Wattignies 46 catiches – notons que ce dernier plan est incomplet. Curieusement, l’exploitation du côté Faches est sectionnée en quatre blocs, qui ne sont pas loin d’être distincts. De longs massifs non exploités sectionnent le volume, avec la particularité que ces massifs laissés en place sont très fins ! Vu la géométrie des lieux, une mise en culture de champignons parait avoir existé.

Le plan partiel de l’exploitation 21. Le sud est à Wattignies.
Fa12
Il s’agit d’un site situé dans une zone d’activité économique (probablement
Auchan), qui comporte 25 catiches. Nous ignorons tout de cette exploitation. Ce
sont des travaux de faible ampleur, menés probablement à une échelle familiale
et dans une durée limitée.
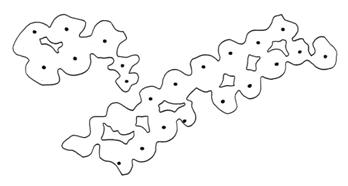
La petite exploitation de la ZAC.
Fa13
C’est une carrière qui affecte les jardins situés au nord de l’avenue Désiré
Verhaeghe. Cette carrière à une structure qui est un peu intermédiaire entre le
tout-catiches et le mixte-catiches. En effet, quelques curieuses galeries de
jonction font penser à des petits tunnels de galeries en technique chambres et
piliers. En cela, nous pouvons soupçonner que ces travaux d’excavation sont
assez anciens. Ces galeries font penser à ces nombreuses carrières datant de la
fin du XVIIIème siècle. Le site possède un ensemble de 39 catiches, plus un
petit développé linéaire de galeries.
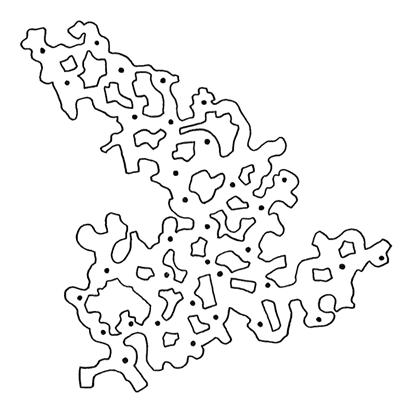
La carrière de la rue désiré Verhaeghe.
Fa14
Il s’agit de plusieurs carrières, nommées communément les exploitations du chemin Fourmestraux. Cet ancien chemin n’est plus très bien connu de nos jours. Il s’agit en réalité de sites localisés globalement au nord d’Auchan, dans un secteur semi-rural à proximité du chemin de Templemars. Notons ici encore à quel point les carrières se situent toujours à proximité des anciens chemins de communication.
- La première exploitation est un petit bloc rectangulaire de 37 catiches, qui respecte admirablement les limites de propriété.
- La seconde exploitation laisse à penser qu’il s’agit d’un volume un peu plus ancien, étant donné qu’on se trouve dans un schéma de creusement non loin d’être un mixte catiches et piliers tournés. Ce type d’exploitation batarde est assez typique des creusements de la fin du XVIIIème siècle. L’ensemble comporte 33 catiches.
- La troisième exploitation est un début d’activité, lequel a été avorté. Il n’y a que 2 catiches et un petit tunnel d’accès.
- La quatrième exploitation est non localisée nous concernant. Il s’agit de deux volumes, ayant gardé un volume restreint et disons d’un ordre familial. On y trouve 25 catiches.
- La cinquième exploitation est non localisée nous concernant. C’est un court alignement de 7 catiches.
Ces cinq exploitations totalisent 104 catiches. Globalement, elles forment des satellites assez cohérents avec les excavations qui existaient dans le secteur d’Auchan et toute cette zone d’activité économique.
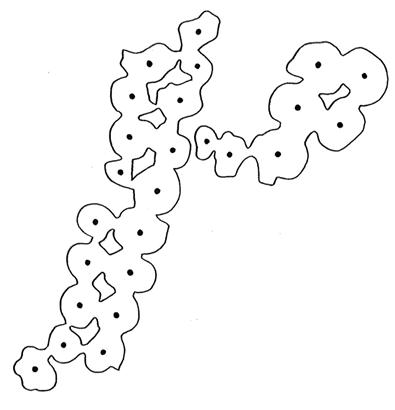
La première exploitation des Fourmestraux.
|
|
Les deux petites exploitations des Fourmestraux. |
|
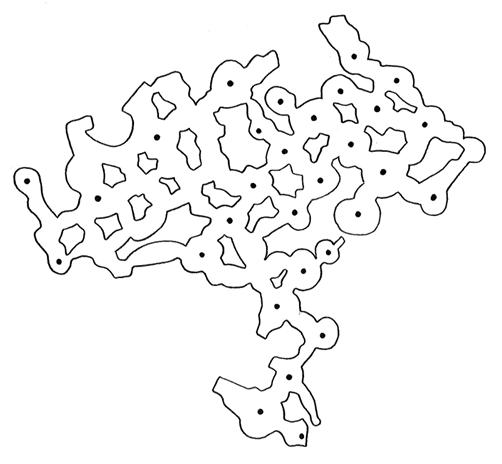
La quatrième exploitation des Fourmestraux.
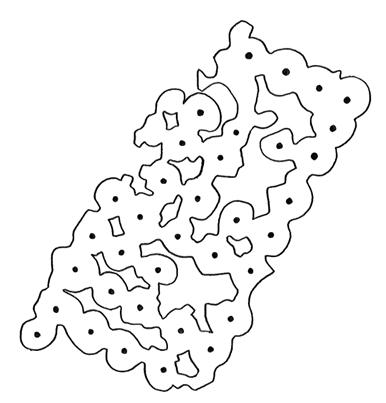
La cinquième exploitation des Fourmestraux.
Fa15
Cette carrière est assez connue car c’est le plan présent dans le livre de Bernard Bivert afin d’illustrer Faches-Thumesnil. Cette carrière, nommée Renault du fait de l’ancien concessionnaire automobile situé au-dessus, comporte 67 catiches. Elle a été quasiment totalement remblayée en 1985 et 1986. A ce jour, les terrains de surface consistent au bâtiment Midas. Signalons que cette carrière donne une suite logique à l’exploitation située sur le territoire de Lesquin, en ce lieu directement attenant.
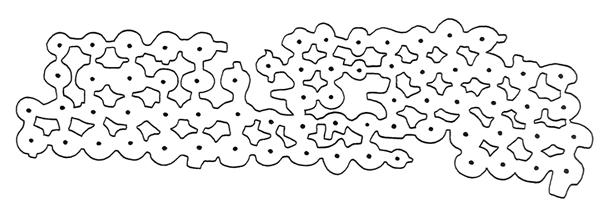
L’ancienne exploitation Renault.
Fa16
Triste carrière…
Cette exploitation se trouve sous les jardins et habitations de la rue Henri Dillies. Le schéma de creusement n’est pas ordonné, ce qui déjà à la base peut témoigner d’un certain manque de soin ; cet état ne permet cependant pas de dater l’exploitation, comme nous le faisons parfois en d’autres lieux. Il ne s’agit pas de technique mixte piliers tournés et catiches. C’est simplement un creusement mené à la hâte.
Cet ensemble est quelque peu bizarre. Il existe une petite exploitation de 9 catiches, laquelle possède un long tunnel exploratoire. Ce tunnel rejoint le reste du site souterrain. La partie centrale de l’excavation possède 122 catiches. L’ensemble de ces deux sites est très fortement fractionné par de multiples zones de remblaiements.
Là encore, déplorons la présence de nombreuses catiches poubelles et de déversements d’eaux usées. Quand on vous dit que ça pose problème !!!
Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2009, deux catiches se sont effondrées dans le fond de jardin d’Odile et Michel Magrez. Le cratère est gigantesque. Etant donné que l’habitation n’est pas touchée, aucune instance n’a accepté de financer les travaux de comblement. Ces deux habitants se sont retrouvés parfaitement seuls ; avec de surcroît le fait de n’avoir jamais rejeté d’eaux usées à cet endroit là. La difficulté supplémentaire était que le jardin se trouvait totalement enclavé, sans accès à la voirie possible. Les travaux de comblement ont duré 6 ans. Depuis cet évènement, les Magrez ont créé une association de défense des personnes victimes des catiches.
Au sujet de cet effondrement, nous lisons dans « 20 minutes » une phrase que nous retranscrivons : Christian Szymanski, envisage même un recours ultime, retrouver les descendants des extracteurs de craie pour établir les responsabilités. Nous espérons que nos recherches en généalogie permettent de déterminer de manière factuelle que cela est parfaitement impossible, vu la méconnaissance importante des exploitants ; ce que nous avons cesse d’écrire dans toutes les communes du Mélantois. De plus, faire porter la charge à 120 descendants non concernés a quelque chose de puissamment absurde.
C’est avec très grande peine que les Magrez ont réussi à faire combler les catiches (par sécurité ils en ont comblé cinq). Plus qu’ailleurs, et malheureusement à grand renfort de communication, les catiches pâtissent d’une image exécrable.
Les aides à ce sujet seraient déjà :
- Stopper totalement les rejets de poubelles et d’eaux usées, et ce de manière urgente. Trop de catiches sont encore concernées.
- Si un cas d’affaissement d’encorbellement est détecté, ne pas recharger en terres mais justement alléger. En solution plus efficace, faire poser une dalle de béton, ce qui est une pratique assez commune. A défaut, la plantation d’un arbre n’est pas une mauvaise idée, bien que ça ne résolve pas tout loin de là.
- Que la presse cesse de se focaliser sur l’accidentel, et qu’un volet de prévention et de mise en valeur soit mis en avant. En effet, les communications de presse ne font que dévaloriser l’urbanisme (et à ce titre surtout Faches-Thumesnil), cela dégrade l’image de la commune, cela porte de lourdes répercussions, alors que l’essentiel est d’avoir une bonne connaissance des catiches et un comportement responsable vis-à-vis de ces exploitations.
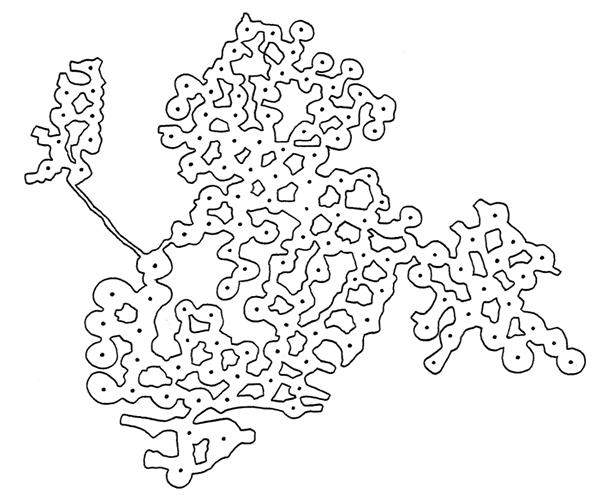
L’exploitation de la rue Dillies.
Fa18
Il s’agit d’une petite exploitation située au 50 rue Faidherbe. Elle totalise 24 catiches. Elle possède une curieuse galerie exploratoire qui rejoint un puits à eau. Nous n’avons pas d’explication quant à cette particularité. Les exploitants ont visiblement peu lésiné sur les débords des limites de propriété !
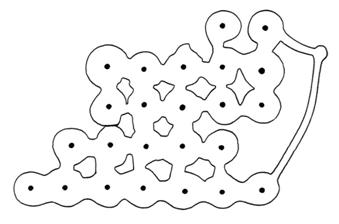
La petite carrière de la rue Faidherbe.
Fa19
Cette exploitation est nommée Trailor du fait de sa présence sous des terrains appartenant à cette ex-société. A ce jour, cette excavation tombe dans les terrains du Amiland Intersport et Electro-Dépôt, près de l’Auchan. Cette exploitation est totalement comblée. Le site de Fa24 nommé Berliet est attenant et se trouve immédiatement au sud de Fa19. Cette carrière Trailor possède un schéma d’exploitation relativement peu soigné, pour 55 catiches dispersées.
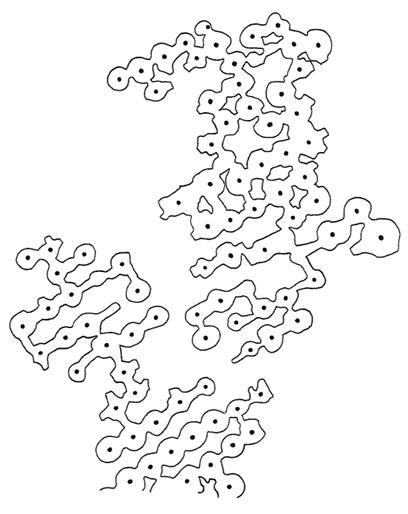
L’ancienne exploitation Trailor.
Fa21
Ce vide de carrière se situait entre la rue Anatole France, la rue du Maréchal Joffre et la rue Pierre Mendès France. Ce sont 5 catiches alignées, qui formaient en quelque sorte une prolongation à l’est du site de la Croisette. Ces catiches, situées en jardin, ont été comblées en février 1994.
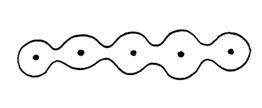
Fa23
Il s’agit d’une exploitation nommée Clinique Icare. A ce jour, ça ne se rattache à plus rien de concret. C’est une excavation qui était située sous des terrains globalement proches du Midas actuel. Dans un petit plan assez bien ordonné, le site comportait 27 catiches. Des comblements partiels ont eu lieu.
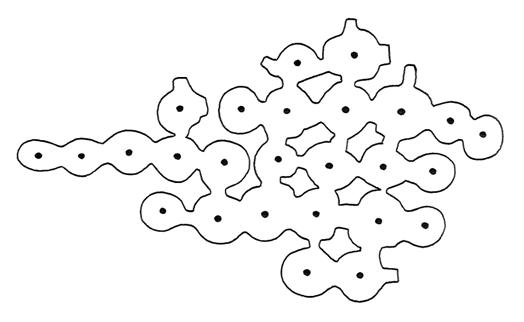
La petite carrière de l’ancienne clinique Icare.
Fa24
Il s’agit de la carrière dite Berliet du fait de sa présence sous des terrains appartenant à cette ex-société. Au même titre que la Fa19, ce site sous-minait les terrains de Amiland Intersport et Electro-Dépôt, près de l’Auchan. Les vides de carrières sont à ce jour totalement remblayés. Dans deux volumes de vides mieux ordonnés que la carrière Trailor, cette carrière comporte 88 catiches.
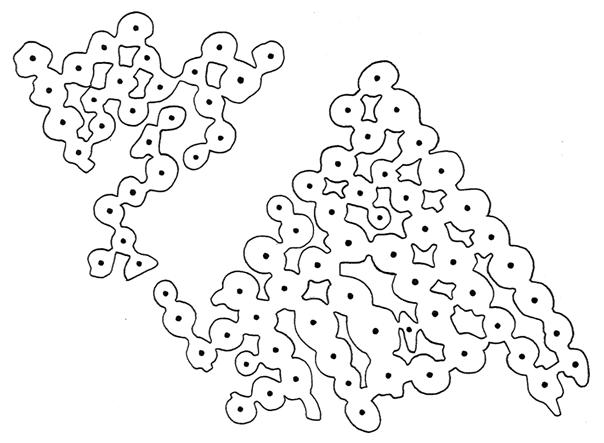
L’ancienne carrière Berliet.
Fa25
Ces volumes de carrières sont nommés Bonnier (notamment du fait de l’ancien chemin de la Carrière Bonnier). Cette dénomination n’est plus très claire de nos jours. Il faudrait les appeler : rue de la Résistance, rue Marcel Bédène et Brico-Dépôt. Tous ces sites correspondent à une extension nord-est des vides de la Croisette. L’ensemble est compliqué à décrire, sauf la rue de la Résistance.
- La carrière de la rue de la Résistance est un vide d’exploitation qui affecte la rue éponyme, jusqu’à la Linière. Des remblais partiels ont eu lieu, vu le mauvais état global du site. L’excavation comporte 73 catiches. Signalons toutefois des remblais non négligeables, autant du fait des nouvelles constructions de la rue de la Linière, les initiatives du SEISM en territoire public. De ce fait, il est difficile de caractériser ce volume d’exploitation.
- La carrière au nord-ouest de la précitée. C’est un petit volume d’exploitation, presque jointif mais tout de même distinct, qui comporte 40 catiches. Là encore, signalons des situations de remblaiements partiels.
- La carrière de la rue Marcel Bédène. C’est une extension nord-est de la vaste carrière du Brico-Dépôt. Cette exploitation comporte 104 catiches. Elle est de nos jours distincte du réseau Brico-Dépôt car la route a été remblayée en 1997.
- Le Brico-Dépôt. Nous en disposons un plan partiel, pour lequel nous pouvons simplement dire : c’est vaste, le magasin n’est pas sous-miné, le parking l’est très peu. La zone concernée par les vides est surtout située vers le parc de la Croisette. Nous dénombrons 80 catiches mais cela ne signifie pas grand-chose vu l’aspect lacunaire du plan.
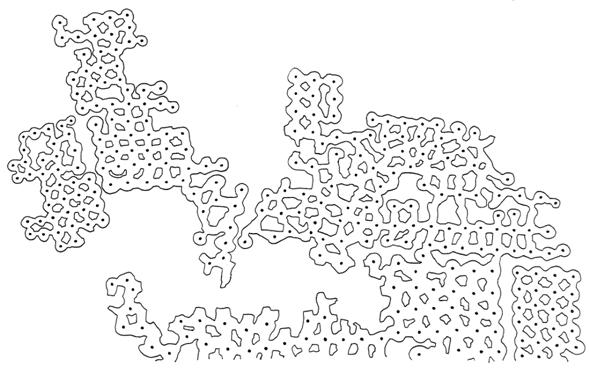
Rue de la Résistance, rue Bédène, le Brico-Dépôt.
Fa27
Ces carrières sont nommées Choteau, du nom de l’ex-établissement éponyme. Ce sont deux petites carrières situées non loin de la rue du Pont. Elles comportent 27 et 15 catiches, sur un schéma de creusement bien structuré.
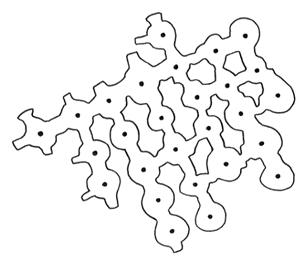
La première carrière Choteau.
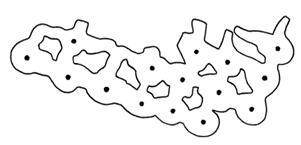
La seconde carrière Choteau.
Fa29
Cette petite exploitation était nommée Caravanes, du fait du vendeur situé sur le terrain de surface. A ce jour, c’est un dépôt de chantier, situé dans un échangeur autoroutier en face de Renault et Electro-Dépôt. Le site comporte 26 catiches.
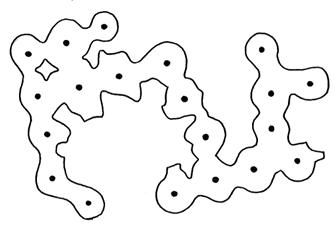
La petite carrière dite « des caravanes ».
Fa30
Cette exploitation est située rue Nelson Mandela, sans affecter du bâti. L’excavation comportait 34 catiches. Vu le terrain failleux, la moitié en a été remblayée.
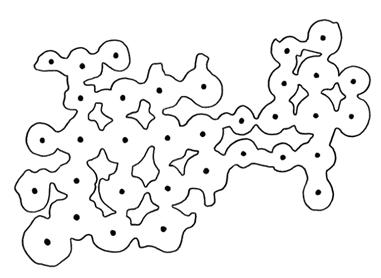
La petite carrière de la rue Nelson Mandela.
Fa31
Il s’agit d’une minuscule exploitation située sous une habitation de la rue Salengro. On y devinerait presque un creusement médiéval, mais rien n’en est bien attesté. L’accès se faisait par la cave de la maison, mais des remblaiements partiels ont eu lieu.
Fa32
Ce sont deux minuscules exploitations, nommées Moulin de Lesquin (comme à Lesquin d’ailleurs), et situées chemin Louis Pollet. Elles totalisent 5 catiches. Si l’on en croit le creusement existant au moulin de Lesquin proprement dit, ce sont alors là de vieilles carrières, imputables à une période Renaissance.
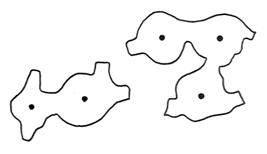
Le site du Moulin de Lesquin.
Fa33
Ce petit réseau s’appelait La Linière. C’est un minuscule réseau localisé à l’ouest de la Cité Butin, et globalement dans un secteur nord de la Croisette. Ce petit réseau indépendant de 11 catiches a été totalement remblayé.
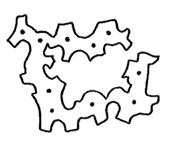
Fa34
Ce petit site souterrain complète les Fa19 et Fa 24. C’est un petit nuage de quelques catiches, situées sous l’établissement ex-Tousalon. A ce jour, cela correspond à un zonage proche du Electro-Dépôt. Les 15 catiches sont comblées.
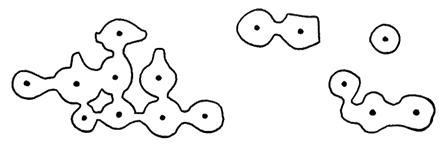
Les recherches généalogiques au sujet des carriers
Nous ne possédons malheureusement pas les déclarations d’ouverture de carrière, mais seulement quelques citations les concernant. Ainsi, il nous est impossible d’évaluer le nombre. Par exemple sur Lesquin, il y a plus de déclarations que de carrières connues à ce jour. De plus, ça nous prive du nom de nombreux exploitants.
Du peu que nous avons pu répertorier, les carriers furent les suivants :
Verdière Cyrille, déclaration d’ouverture de carrière en 1806. Bien que son nom soit rare, nous ne possédons strictement aucune information.
Duhayon Antoine, déclaration d’ouverture de carrière en 1851. Sur le territoire de Lesquin, le même Antoine se déclare comme Duhaillon. L’orthographe juste n’est pas connue. En ce qui concerne Duhayon, le nom est nettement plus fréquent que Duhaillon, mais pourtant, c’est l’absence d’information qui prédomine. Les seules personnes au patronyme approché sont dans les environs d’Hazebrouck.
Dumont, déclaration d’ouverture de carrière en 1861. Vu la fréquence du nom et l’absence de donnée supplémentaire, il est impossible d’en savoir plus.
Pollet Isidore, maître de chaux en 1876. Assez étrangement, nous ne savons rien de cet individu. Pourtant, son patronyme n’est pas fréquent. A noter qu’un individu du nom, né en 1833, était chef d’exploitation chaufournière, il s’agissait de l’établissement Pollet.
Plancquelle Auguste, déclaration d’ouverture de carrière en 1876.
Serait né en 1835 et serait décédé après le 26 avril 1885. L’information est mise au conditionnel car il pourrait s’agir d’un homonyme, sans qu’il ne soit possible de le vérifier. L’on sait de lui, en tout et pour tout, qu’il s’appellerait plutôt Planquelle Auguste et qu’il divorce le 2 avril 1882. Dans cet acte de séparation avec Mme Planquelle née Dhelin, il est nommé en tant que chaufournier à Faches.
Lefebvre Flore, chaufournière, déclaration d’ouverture de carrière en 1876. Notons qu’il s’agit du même individu et même date qu’à Lesquin. L’activité s’étendait donc sur les deux communes.
Leclercq Marie-Louise et veuve Deschamps, maîtres de chaux en 1876. Les deux nous sont inconnues. Au sujet de la première, deux homonymes existent, un siècle trop tôt.
Veuve Tierce, déclaration d’ouverture de carrière en 1885. Nous ne savons rien de cette personne. Pourquoi donc toutes ces veuves ouvrent des carrières ?
Pollet frères et sœur, déclaration d’ouverture de carrière en 1913. L’aspect récent de cette ouverture nous pose question, car elle est très tardive.
Le Ravet-Anceau de 1891 cite des exploitations menées à Faches par : Veuve Deschamps, D. Lefebvre et Pollet
De manière complémentaire, nous relevons dans les registres toute une série d’habitants de Faches se déclarant comme carriéreur. Cette liste est non limitative car nombreux étaient ceux qui se déclaraient en tant que laboureur. Attention que les orthographes sont strictement respectées, ainsi il y a des carriéreur, carrièreur, cariéreur, carrier, etc.
Dupuis Antoine François Joseph, né à Faches-Thumesnil le 13 janvier 1778 et décédé le 2 octobre 1830 au même lieu.
Leclercq Ange François Joseph, né à Faches-Thumesnil le 2 octobre 1769 et décédé le 25 octobre 1842 au même lieu. Il se déclare en tant que ouvrier, carrier et journalier. Il se marie avec Liagre Charlotte Joseph le 5 juillet 1791.
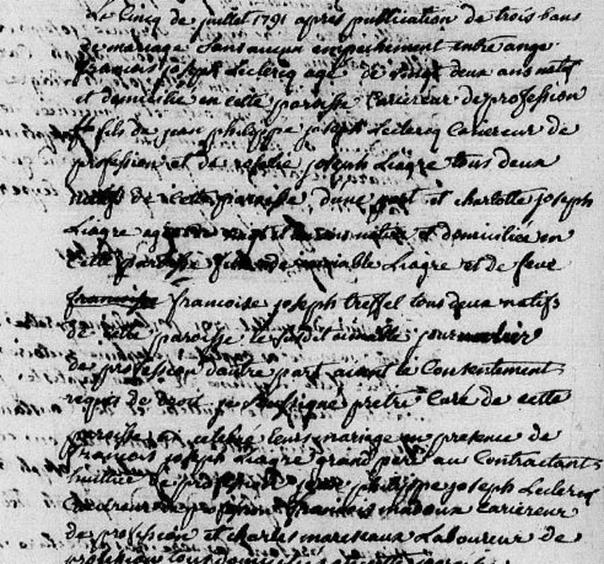
L’acte de mariage d’Ange Leclercq. On y lit clairement qu’il est carriereur de profession, ainsi que son père Jean Philippe Joseph Leclercq.
Leclercq Alexandre Joseph, né à Faches-Thumesnil le 22 août 1805 et décédé à date inconnue. Il se déclare en tant que maître carrier.
Leclercq Jean Baptiste Joseph, né à Faches-Thumesnil le 20 février 1784 et décédé le 31 mars 1867 au même lieu. Il se déclare en tant que carriereur.
Leclercq Jean Baptiste, né à Faches-Thumesnil le 2 décembre 1727 et décédé le 2 novembre 1794 au même lieu. Il se déclare en tant que carriéreur.
Leclercq Philippe Joseph, né à date et lieu inconnus et décédé le 11 mai 1776 à Faches-Thumesnil. Il se déclare en tant que carrièreur.
Leclercq Philippe Joseph, né à Faches-Thumesnil le 3 avril 1747 et décédé le 17 octobre 1831 au même lieu. Il se déclare en tant que cariéreur et cabaretier. Il se marie le 7 mai 1769 avec Liagre Marie Rosalie Joseph.
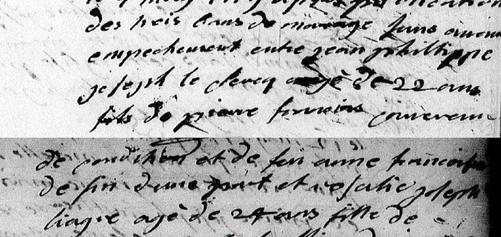
L’acte de mariage de Philippe Leclercq. Son père Pierre François est déclaré
carrièreur de condition (admettons que ce n’est pas facile à lire sans
habitude).
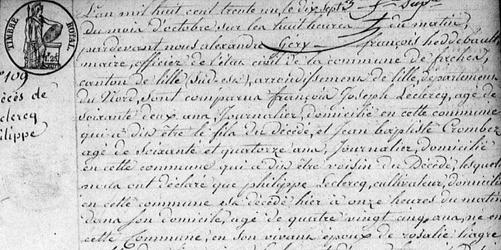
Son acte de décès. Il y est déclaré en tant que cultivateur.
Leclercq Matthieu Joseph, né à Faches-Thumesnil le 21 septembre 1744 et décédé le 21 juin 1832 au même lieu. Il se déclare en tant que carriereur et tordeur d'huile.
Leclercq Alexandre, né à Faches-Thumesnil en 1817 et décédé en date et lieu inconnus. Il se déclare en tant que carrier.
Chrétien Henri Joseph, né à Faches-Thumesnil le 15 mai 1742 et décédé le 27 novembre 1795 en même lieu. Il se déclare en tant que huilier et carriereur.
Cela fait peu comparé à l’ampleur de l’exploitation. Disons malgré tout que c’est déjà intéressant par rapport à d’autres communes qui ont eu leurs archives brûlées ou qui restent, envers et contre tout, de grands mystères. C’est le cas, par exemple, de Ronchin.
Que peut-on déduire de cette liste ?
- La première chose, c’est que l’exploitation se mène en famille ; cet aspect est prépondérant. En résumé en vue d’être carrier à Faches, il vaut mieux être un Leclercq, un Lefebvre ou un Liagre. Les unions de mariage seront relativement fréquentes entre les Leclercq et les Liagre (bien que ça ne transparaisse pas forcément aussi, cet aspect touchant des non-carriers).
- La seconde, c’est que les exploitations étaient potentiellement transfrontalières entre communes. On retrouve certains mêmes individus entre Faches et Lesquin – éventuellement Lezennes, mais ce dernier trait resterait à prouver.
- La période d’exploitation donne l’impression d’être plus nivelée que sur les communes avoisinantes, c’est peut-être dû au nombre de carrières. Une exploitation précoce semble avoir lieu en 1760-1770. Ensuite, cela s’intensifie, avec une chute de production estimée aux environs de 1890.
- Faches a comporté plusieurs carrières médiévales. Malheureusement et sans que cela en soit étonnant, aucune donnée n’est disponible.
Des témoignages de visiteurs
La carrière médiévale de la rue Kléber était située sur le parking jouxtant le numéro 59 de ladite rue. Aujourd’hui le puits d’accès n’existe plus, ce qui sous-entend que la carrière est probablement remblayée. Cette exploitation était située non loin de l’église Sainte Marguerite d'Antioche. Doit-on en conclure que l’excavation a servi à l’érection de l’église ? Doit-on conclure que les travaux sont contemporains et dateraient dès lors du XIIIème siècle ? Nous en sommes réduits aux simples hypothèses. A évaluer la technique de creusement de l’exploitation, c’est en réalité entièrement possible.
Il s’agissait d’une petite excavation en piliers tournés, réalisée sur un schéma anarchique. Nous l’avons visitée en 2002, dans le but de localiser les graffitis anciens. De manière très décevante, ce fut un échec. D’une part il nous fut impossible de les trouver (et ce n’est pas faute d’efforts déployés) et d’autre part, l’excavation était pauvre en inscriptions diverses.
Il se passa en réalité exactement la même chose dans les exploitations médiévales de Valenciennes (XIème au XIIIème siècle). Les battements de nappe phréatique dégradent les parois, rendant les inscriptions illisibles. Cela explique l’aspect brun et rugueux des parois de la carrière de la rue Kléber, au même titre que la carrière du Glacis à Valenciennes. En contrepartie briser la roche révèle une pierre parfaitement blanche.
Du coup, nous nous basons sur des photos d’archives (1988). Ces photos retracent un parcours de quelques visiteurs très intéressant.
Il s’agissait de réfugiés, ou plus précisément des conscrits. Ils cherchaient à échapper au recrutement des guerres napoléoniennes. Nous reproduisons ci-dessous deux des inscriptions, en tentant de rester le plus fidèle possible à leur aspect initial.
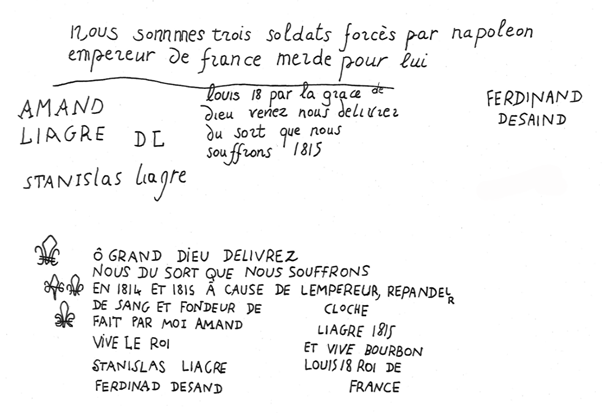
Le texte de ces inscriptions est :
Nous sommes trois soldats forcès par Napoléon
empereur de France merde pour lui
louis 18 par la grace de
dieu venez nous délivrer
du sort que nous
souffrons 1815
Amand Liagre DL
Stanislas Liagre
Ferdinand Desaind
Ô grand dieu délivrez
Nous du sort que nous souffrons
En 1814 et 1815 à cause de l’empereur, répandeur
De sang et fondeur de cloche
Fait par moi Amand Liagre 1815
Vive le roi et vive Bourbon
Louis 18 roi de France
Stanislas Liagre
Ferdinad Desand
Plus loin et sans que nous n’en disposions de photo, une inscription complémentaire décrit la fin de la cache et le début du calvaire pour ces trois jeunes gens :
adieu mes amis, il faut que je parte demain
le 9 de juin 1815 par force pour napoléon
le plus grand voleur de la france mais
nous n’avons point l’envie.
Une autre et dernière inscription est relatée dans le livre de Bernard Bivert :
Amand Liagre déserteur du 72me régiment de ligne
Moi deuxime 12 de cuirassés et moi troisime 55 de ligne 1815
De tout cela ressort un seul sentiment, il est très dommage de ne pas les avoir trouvées en 2002. Cela aurait mérité de nombreuses photographies. Quoi qu’il en soit, une recherche généalogique, reste possible, les textes ayant été convenablement relevés.
Stanislas Liagre est connu dans les registres. Il s’agit de Liagre Stanislas François Joseph, né à Faches le 31 mars 1793. Fils de Liagre Jean-Baptiste Joseph (né en 1762) et de Delvalez Elizabeth Joseph. Il nous est connu en tant que journalier.
Il décède le 23 août 1843, veuf de Viloquau Marie Agnès, ou encore dans un second registre, de Willocaux Marie Agnès. La seconde orthographe nous parait la plus plausible.
Lors des évènements en 1815, l’intéressé avait donc 22 ans. Il est notablement répertorié comme faches-thumesnilois.
Amand Liagre, nous aurions tendance à le supposer comme étant son frère. Pourtant, tout laisse à penser que ce n’est pas le cas. C’est le hasard qui nous a permis de le retrouver et notamment une étude corollaire à ce document, les catiches de Wattignies. En effet, Amand Liagre n’était pas un habitant de Faches.
Il nous est connu comme étant né le 5 décembre 1797 à Lille et décédé le 17 juillet 1862 à Wattignies. Journalier, ouvrier carrier, il se marie avec Roussel Virginie Augustine à une date que nous n’identifions pas dans l’immédiat. Cela pourrait être le 3 juin 1821 à Marquette-Lez-Lille, mais nous ne l’affirmons pas. Sous réserve de mésinterprétation, il est le fils de Liagre Pierre Joseph et de Leclercq Marie Rose Joseph.
Lors des évènements en 1815, l’intéressé avait donc 18 ans.
Ferdinand Desaind nous est parfaitement inconnu. Nous avons de même recherché sur les noms Desau, Desaint, De Saint, Desand, Degand. Nous retrouvons les deux noms des Liagre dans le registre des soldats napoléoniens, Ferdinand y est quant à lui absent. Cela confirme en tout cas de manière attestée que les deux Liagre ont été enrôlés.
Ils se tirent tous deux de la guerre sans trop de dommages car leur décès sont nettement postérieurs. Quel devait être le calvaire de ces jeunes gens au sein des carrières froides et sombres ?
Ils ne furent pas les seuls car une autre inscription existe, antérieure à tout cela.
Amand Fournier l’an 4me de la liberté
Le 2 octobre 1792 siège de Lille
Au sujet de Fournier Amand, nous ne disposons de presque aucune information. Nous savons juste que, lors d’un décès le 25 septembre 1814, il est le voisin de Liagre Philippe Joseph, un nom qui résonne comme une étrange potentialité de carrier, mais nous n’en disposons d’aucune preuve. Les deux intéressés étaient-ils carriers ?
Cette inscription est réalisée lors du siège de Lille par les autrichiens. Le siège s’est déroulé du 29 septembre au 8 octobre. A-t-il déserté, s’est-il simplement rendu dans un endroit à l’abri des boulets de canon ?
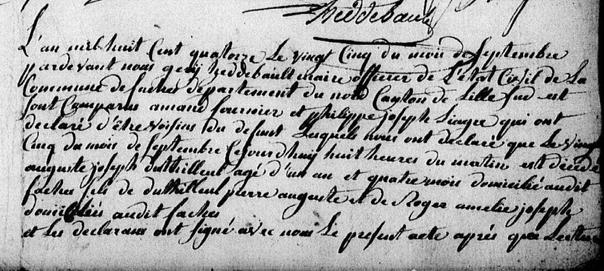
Le document où Amand Fournier est cité.
Le recensement de 1906
Le recensement de 1906 sur la commune de Faches donne des résultats gargantuesques, d’un nombre supérieur aux autres communes du Mélantois. Cyrille Glorieus a fait l’inventaire complet de ces habitants. Voici le tri axé sur les professions liées aux carrières.
A l’établissement Pollet, chaufournier
![]()
Desaint Charles, né en 1844, carrier chez Pollet.
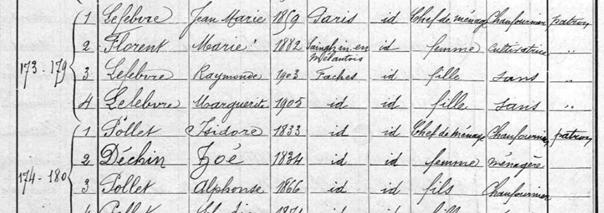
Lefebvre Jean-Marie, né en 1859, chaufournier et patron (d’une autre exploitation ?)
Pollet Isidore, né en 1833, chaufournier et chef de l’exploitation.
Pollet Alphonse, né en 1866, chaufournier.
Chez Crombet frères, les champignonnistes
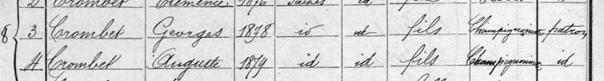
Crombet Georges, né en 1878, champignonniste et chef d’exploitation.
Crombet Auguste, né en 1879, champignonniste et chef d’exploitation.
![]()
Planckaert Louis, né en 1869, champignonniste chez Crombet.
![]()
Chimot Edouard, né en 1857, champignonniste chez Crombet.
![]()
Pasbecq Armand, né en 1866, champignonniste chez Crombet.
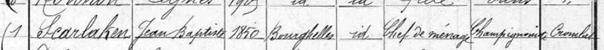
Scarlaken Jean-Baptiste, né en 1850, champignonniste chez Crombet.
![]()
Brulle Louis, né en 1873, champignonniste chez Crombet.
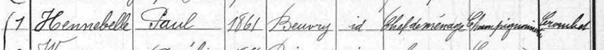
Hennebelle Paul, né en 1861, champignonniste chez Crombet.
![]()
Marchant Arthur, né en 1870, champignonniste chez Crombet.
![]()
Van Mullem Henri, né en 1878, champignonniste chez Crombet.
![]()
Menu Camille, né en 1840, champignonniste chez Crombet.
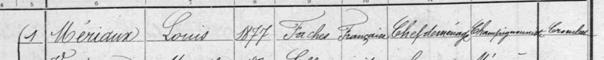
Mériaux Louis, né en 1877, champignonniste chez Crombet.
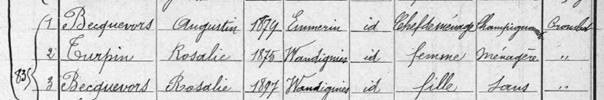
Becquevors Augustin, né en 1874, champignonniste chez Crombet.
![]()
Dubreucq Arthur, né en 1849, champignonniste chez Crombet.
![]()
Hérace Honoré, né en 1852, champignonniste chez Crombet.
Chez Crombet frères, les autres métiers que champignonniste
Buisine Léon, né en 1892, coursier chez Crombet.
Beghin Gustave, né en 1854, charretier chez Crombet.
Leclercq Jules, né en 1875, domestique chez Crombet.
Meurice Désiré, né en 1852, domestique chez Crombet.
Cuvilliez Jules, né en 1868, charretier chez Crombet.
Poupart Arsène, né en 1875, cocher livreur chez Crombet.
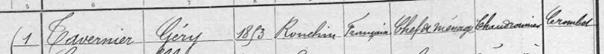
Tavernier Géry, né en 1853, chaudronnier chez Crombet.
![]()
Depraeter Charles, né en 1865, journalier chez Crombet.

Pasbecq Edouard, né en 1866, journalier chez Crombet.
![]()
Ghislain Abel, né en 1893, coursier chez Crombez.
A l’établissement Roussel, champignonniste
Pasbecq Louis, né en 1846, maçon chez Roussel.
Dumoulin Julia, né en 1866, journalière chez Roussel.
![]()
Demarescaux Léandre, né en 1873, champignonniste chez Roussel.
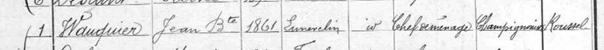
Wauquier Jean-Baptiste, né en 1861, champignonniste chez Roussel.
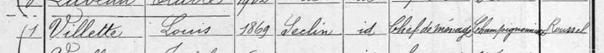
Villette Louis, né en 1869, champignonniste chez Roussel.
![]()
Leclercq Urbain, né en 1856, champignonniste chez Roussel.
![]()
Willemot Léon, né en 1864, champignonniste chez Roussel.
Chez Barge, chaufournier
![]()
Nonon Jean-Baptiste, né en 1845, chaufournier chez Barge.
![]()
Plays Ernest, né en 1872, chaufournier chez Barge.
Chez Dhélin, tailleur de pierres
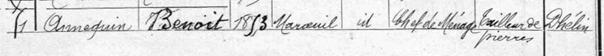
Annequin Benoît, né en 1853, tailleur de pierres chez Dhelin.
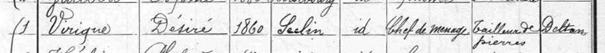
Virique Désiré, né en 1860, tailleur de pierres chez Deltan. Il s’agit de Dhélin ?
Au sein d’employeurs non identifiés
Rochart Emile, né en 1868, champignonniste.
![]()
Leturcq Fernand, né en 1862, champignonniste.
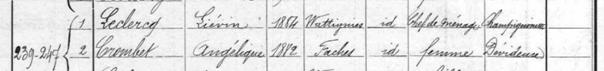
Leclercq Liévin, né en 1884, champignonniste.
![]()
Delalonguehaie Victor, né en 1871, champignonniste.
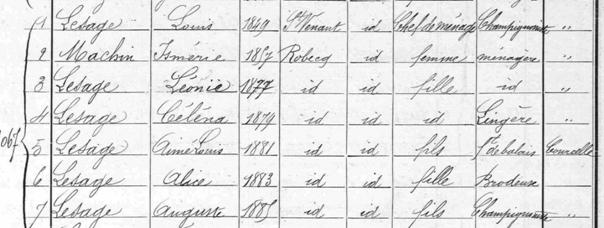
Lesage Louis, né en 1849, champignonniste. Lesage Auguste, son fils, né en 1885, champignonniste.
Conclusion
Faches-Thumesnil est une des communes du Mélantois les plus intéressantes à étudier. Il y a une richesse, une diversité, une ampleur qui ne se retrouve pas vraiment ailleurs. L’intensité des travaux sur le site de La Croisette n’y est pas étranger. Les lieux comportent tout de même 73% des catiches faches-thumesniloises !
Les carrières anciennes sont à Faches, l’écrasante majorité des autres carrières sont à Thumesnil, site où s’est concentré une énorme épopée de culture de champignons.
Du côté des exploitants, on se retrouve devant un magma de personnes, le plus souvent un peu anonymes. Les familles Crombez ressortent du point de vue des champignonnistes, les Pollet du point de vue des chaufours. Au niveau des carriers, de forts échanges ont eu lieu entre communes du Mélantois.
Faches
est loin d’avoir livré tous ses secrets, ne serait-ce que par l’ampleur de la
tâche de décryptage.

Seclin, un bout du monde
Si les lillois savent que de très larges secteurs de catiches s'étendent sous Lezennes, plus rares sont ceux qui perçoivent que ces mêmes souterrains se prolongent en de vastes excavations sous Hellemmes. Plus rares encore sont les lillois qui savent que de nombreuses communes du Mélantois sont affectées par la présence de catiches. Il s'agit en réalité de Lille, Hellemmes, Lezennes, Villeneuve d'Ascq, Haubourdin, Ronchin, Vendeville, Seclin, Faches-Thumesnil, Loos, Lesquin, Wattignies et Templemars.
Cette commune n'est pas fortement affectée par la présence de catiches, mais il existe tout de même une petite dizaine d'exploitations. Seclin est la commune la plus au sud du secteur des catiches du Mélantois. Une minoration encore, ces catiches n'affectent que – en large majorité – le nord de la commune. Seule une est hors périmètre.
Au niveau des recherches sur les catiches, Seclin est pour ainsi dire une terra incognita. Les presque seuls documents existants sont la première édition du livre de Bernard Bivert ; il reste très succinct et évasif sur la question, puis quelques vagues mentions dans la presse, en général peu précises et souvent exagérées. Après, le SDICS en tant que tel a réalisé une masse d'études somme toute colossale, mais ces documents ne sont pas accessibles au public.
Nous proposons ici une étude en deux parties.
1) La description des carrières existantes.
2) Les recherches généalogiques au sujet des carriers. En réalité, cette part nous intéresse le plus, mais elle est indissociable d'une description globale des sites.
La description des carrières existantes
Les catiches de Seclin sont toutes de creusement récent. Cela induit que, au contraire de Lezennes où le réseau est en technique mixte chambre & piliers et catiches, ici nous sommes en tout catiches. Les réseaux anciens ont tendance à être anarchique (ce qui fait la terrible réputation de Lezennes), à Seclin les réseaux sont purement et simplement des accolements de catiches. Elles se suivent les unes aux autres. Lorsque les gens descendent à Lezennes, ils s'attendent à voir ce type de structure. Or, non. Mais soit…
Donc il n'y a aucune carrière ancienne connue actuellement à Seclin.
a) La carrière de l'église
Seclin est un village très ancien. Des témoignages ont placé une carrière plus ou moins sous l'église Saint-Piat. Cette excavation daterait alors du VIIème siècle. S'il peut paraître logique qu'une carrière se trouve à proximité immédiate de cette église, il s'avère qu'aucune excavation n'a été trouvé par le SDICS en avril 1977 (inspecteur : Pierre Triadou). Or, le service des carrières était méticuleux dans ses recherches. A savoir que rien n'a été localisé ensuite par microgravimétrie, mais il est à savoir qu’il est plus facile de procéder dans les champs qu'en ville. A ce sujet, le SDICS établit le rapport suivant :
Accompagné de Monsieur Quignon, (employé retraité de l'Usine mayolande, historiographe de Seclin et membre du Syndicat d'Initiative), je me suis rendu dans la crypte de l'église abbatiale. C'est de là, en effet, que selon la légende, devait partir un escalier donnant accès à des souterrains dont l'un longerait la R.N. 25 vers Carvin et l'autre se dirigerait vers le Fort de Seclin. Il apparaît assez nettement que le seul accès possible vers un escalier descendant aux souterrains doit se situer en 10. Or un moellon, dans le haut mur 13 permet de se rendre compte que derrière ce mur tout est remblayé. Dans la partie principale de la crypte rien ne permet de déceler une ouverture quelconque donnant accès à un escalier - en A - B - C - des pierres ont été descellées mais n'ont pas laissé apparaître de vide. En 2 sur le croquis, figure un puits d'une dizaine de mètres encore équipé d'une poulie et de vieux seaux en bois qui servaient aux pèlerins à remonter de l'eau. Ce puits est maçonné presque jusqu'au fond mais il ne donne accès à aucune galerie. C'est uniquement un puits d'eau.
Bref, les légendes ont probablement la peau dure. Si carrière il y a sous l'église, cela fait bien longtemps que plus aucun accès n'est connu.
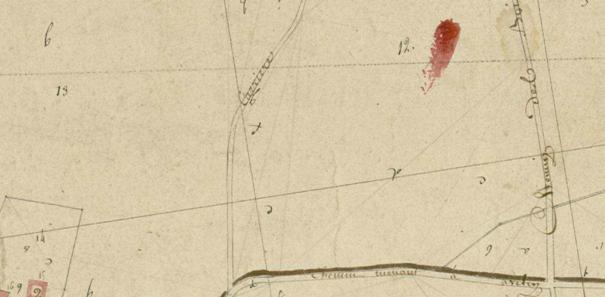
Plus tard (et d’ailleurs très nettement plus tard), ça ne s’arrange pas énormément du point de vue des carrières. En 1812 sur le cadastre du Consulat, tout est vide d’excavations, pourtant elles sont parfois mentionnées ailleurs (Hordain, Avesnes-le-Sec). Sur cette carte ci-dessus figure le mot carrière. Est-ce une exploitation ? Si oui, cela ne fait appel à rien de connu à ce jour.

1812 toujours, sur le secteur précis des carrières qui sont connues à ce jour, un zoom effectué sur ce quartier rural laisse apparaître une foultitude de moulins, mais pas de carrière.

En 1857 ci-dessous, le même secteur est toujours aussi vide. Sur ce cadastre napoléonien, bien des exploitations figurent pourtant. L’absence de carré plus sombre, mentionnant dès lors une exploitation, est à considérer comme un témoignage important : cela n’avait pas encore débuté.
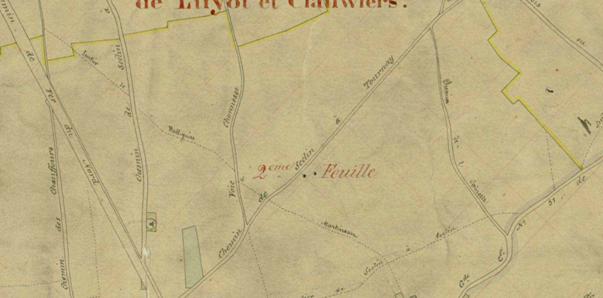
D’après nos estimations, les premières excavations du secteur Bouchery ont été réalisées à partir de 1855-1860. Nous avons par contre une méconnaissance totale en matière de datation de chaque exploitation individuelle. Nous allons lister ci-dessous les exploitations connues.
b) Des carrières pourraient exister au coin de la rue Maurice Bouchery avec la départementale 952. Vu les remaniements, ces vides affecteraient en fait essentiellement le rond-point. Il s’avère que le vaste chantier du secteur n’a pas spécialement mis au jour cette carrière. Il est envisageable de penser qu’elle fut comblée. Elle aurait comporté 16 catiches.
c) Une carrière à catiches affecte la rue Maurice Bouchery à hauteur de ce que le SDICS appelle l’avis 594. C’est une excavation qui affecte les terrains privés. Elle totalise 15 catiches en trois exploitations différentes et 22 catiches suspectées.

Les catiches de l’avis 594.
d) Deux carrières à catiches affectent la rue Maurice Bouchery à hauteur de ce que le SDICS appelle l’avis 833 et l’avis 3547. Ce sont deux excavations qui affectent les terrains privés. A savoir que les limites de propriété ont été correctement respectées, ce qui est loin d’être le cas pour bon nombre de communes ! C’est ainsi qu’on se retrouve avec des routes sous-cavées en certains lieux…
La carrière 833 totalise 21 catiches, sur un site tout en longueur. Deux fois deux catiches sont indépendantes du reste. 13 catiches sont suspectées.
La carrière 3547 totalise 12 catiches et 14 catiches suspectées.
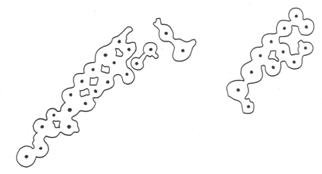
Les catiches des avis 833 et 3547.
e) Une carrière à catiches affecte la rue Maurice Bouchery à hauteur de l’avis 2477, et non sous la boulangerie Marie Blachère comme ce fut initialement calculé (par nous et par erreur). Cet assez grand site totalise 48 catiches. Fait assez étonnant, 9 catiches sont excentrées, le site est relié par un petit tunnel exploratoire.
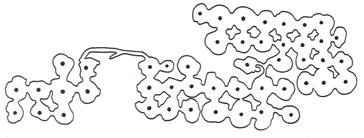
Les catiches de l’avis 2477.
f) Une carrière à catiches affecte la rue Maurice Bouchery à hauteur de l’avis 428. Il s’agit d’un site totalisant 36 catiches. 9 catiches sont suspectées sur la partie strictement attenante à cette carrière.
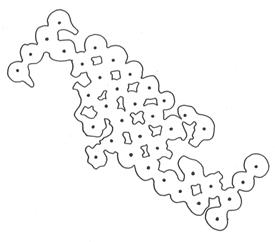
Les catiches de l’avis 428.
Cette carrière affecte les terrains privés, le bâti, et traverse la route. C’est la seule carrière qui est située à l’est de la rue Maurice Bouchery, devenant route de Lille à cet endroit. A la précision près, tout de même, que de nombreuses autres catiches sont suspectées de l’autre côté de la route.
Face à l’avis 594 : 28 catiches suspectées.
Face à l’avis 833 : 2 catiches suspectées et plus au nord, 17 catiches suspectées.
Face à l’avis 2477 : 8 catiches suspectées.
g) Une carrière à catiches affecte les terrains proches de Wacrenier Renault Seclin, sous le nom de l’avis 4403. C’est un petit site totalisant 17 catiches. Détecté par microgravimétrie, nous ne savons pas si cette excavation a été visitée.

Les catiches de l’avis 4403.
h) Une carrière à catiches affecte les terrains de l’actuel Lidl. Il s’agit de l’avis 5072, bordé de l’avis 4835 (11 catiches suspectées) et de l’avis 609 (3 catiches suspectées). La carrière affectant le bâti de Lidl comporte 8 catiches. Sans preuve disponible, nous supposons que le site est remblayé.

Les catiches de l’avis 5072.
i) De nombreux affaissements et quelques effondrements ont été constatés dans le groupe Lénine. Une ancienne et assez vaste carrière à catiches a visiblement affecté les lieux. Connue dans un document d’archive, cette carrière défraie régulièrement la chronique par des affaissements localisés
Il s’avère que cette carrière est comblée et n’a jamais été visitée par le SDICS. Les affaissements ayant lieu résultent de tassements et de poches résiduelles.
j) Deux catiches affectent le groupe Paul Vaillant Couturier. Ces catiches sont comblées.
k) Une vaste carrière affecte un terrain agricole à hauteur de la route départementale 549, dite route d’Avelin. C’est la seule carrière qui n’est pas située dans le nord de la commune. De même, c’est le seul site d’ampleur qui n’est pas situé dans les alentours proches de la rue Maurice Bouchery.
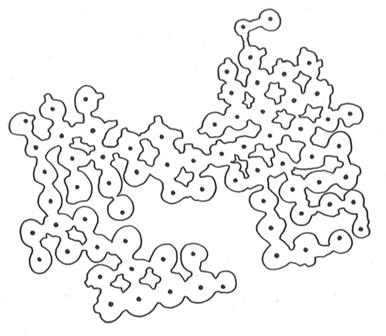
Les catiches de la RD 549.
Ce site, vaste, a débordé des limites de propriété, ce qui a entraîné le sous-cavement de la route. Cela a été problématique. De ce fait à ce jour, ces catiches en espace public sont toutes comblées.
Ce site comporte 62 catiches, 10 catiches comblées, 2 catiches excentrées, 8 catiches suspectées.
l) Plus loin encore et dans le cadastre, on retrouve une mention de carrière sur le site de Martinsart, à l’est du village, la « carrière du Plat ». Mais cela fait-il vraiment référence à une exploitation ? Strictement rien n’y est connu à ce jour.
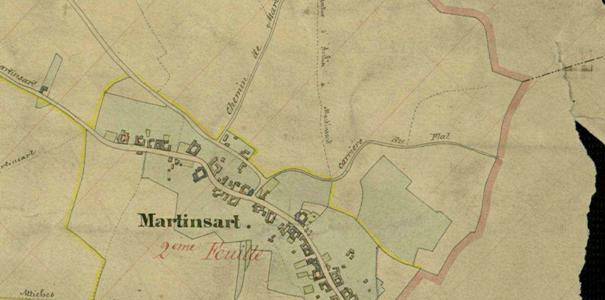
m) Il y eut deux catiches ouvertes à proximité du stade Paul Durot. Bien que la documentation soit succincte sur le sujet, cela laisse à penser que les excavations ont été remblayées.
Selon Bernard Bivert, Seclin totalise 358 catiches pour 72000 mètres cubes d’extraction.
Selon nos estimations, Seclin totalise 349 catiches pour 70000 mètres cubes d’extraction.
La différence provient assez probablement des estimations du Groupe Lénine, que nous n’avons pas comptabilisée, pour cause de méconnaissance du site.
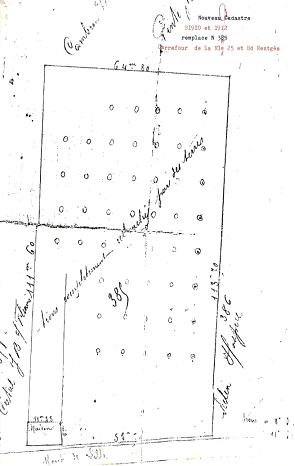
Les recherches généalogiques au sujet des carriers
Il est répertorié 15 ouvertures de carrières sur l’entité de Seclin. Cela ne correspond nullement aux sites souterrains inventoriés, en nombre plus faible. Ceci est bien évidemment à minorer car les sites répertoriés sont, comme nous l’avons mentionné, parfois en plusieurs cavités. De plus, en ce qui concerne le site du groupe Lénine, visiblement assez vaste, nous ne savons pour ainsi dire rien. Dès lors, il est impossible de prétendre à une quelconque exhaustivité.
Dans son ouvrage sur les souterrains du Nord Pas-de-Calais, Bernard Bivert cite 15 exploitants, que nous listons ci-dessous en noir. En bleu, nous ajoutons les déclarations d’ouverture de carrière, souvent extrêmement similaire. L’un et l’autre se complètent en vue d’une recherche généalogique.
Leroy Alexandre (1821-1831)
Dassonville Pierre Joseph (1821)
Houzé Louis (1847-1848), fabricant de chaux à Seclin.
Deletombe Auguste (1847-1849). Un document annexe à la déclaration précise qu’il s’agit d’un chaufournier installé à Phalempin.
Fournier (1853). Un document annexe à la déclaration précise qu’il s’agit de Fournier Henri, cultivateur.
Vasseur Désiré (1861)
Cambier, Debuchy, Herbaut-Dervaux (avant 1876)
Mallet-Deletombe (avant 1876)
Hottin Jean-Baptiste (1876). Un document annexe à la déclaration précise qu’il est habitant de Carvin.
Vasseur Désiré, Gruson Théodore (1877). Le premier est répertorié comme étant fabricant de chaux à Seclin. Le second est répertorié comme étant fabricant d’huile.
Demazières (1892-1902), fabricant de sucre. Notons que la déclaration d’ouverture est un peu… hiéroglyphique. Il pourrait s’agir de « Veuve » Demazières, mais c’est difficile à affirmer. Un document annexe à la déclaration, dactylographié, en fait la même lecture. Il est ajouté : carrière exploitée autrefois par Monsieur Gambier. Un autre document mentionne « Cambier ».
Decourtray (1892). Un document annexe à la déclaration précise qu’il s’agit de Decourtray François.
Dujardin Victor et fils (1906), fabricant de sucre. Cette déclaration concerne visiblement la carrière de la RD 549. C’est intitulé : Clauwières, le long du chemin n°10 de Seclin à Avelin.
Vasseur Robert, chaufournier (1913). La déclaration mentionne que l’intéressé est domicilié 73 rue de Lille à Seclin.
Vasseur-Dimiez (1913). La déclaration mentionne que l’intéressé est domicilié 130 rue de Lille à Seclin.
1) Leroy Alexandre. Seclinois. De cet individu nous connaissons le détail de son mariage. Celui-ci eut lieu à Seclin le 26 mai 1851, avec Verlynde Adèle.
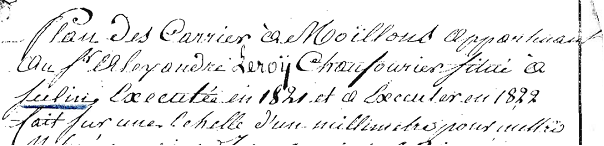
La déclaration cadastrale d’Alexandre Leroy.
2) Dassonville Pierre Joseph. Nous répertorions effectivement un individu de ce nom, né le 13 décembre 1843, et marié avec Caquant Marie Catherine. Ceci ne correspond nullement avec la date de la mise en exploitation, qui est 1821. Cette date est uniquement citée par Bernard Bivert et nous n’en localisons pas la source. Cela parait en fait fort tôt pour une exploitation à Seclin. Toutes les exploitations semblent avoir été ouvertes largement après. De ce fait, nous ne savons borner avec précision l’activité du nommé.
Un homonyme existe. Né en 1795 sans plus de précision et décédé après 1861 à 62840 Lorgies. Marié avec Queste Françoise Angélique. Bien que le lieu de décès n’ait rien à voir, le créneau de dates est concordant. Notons aussi que son fils, Dassonville Fidèle, nous rapproche de Seclin car ce dernier travaillait à la prison de Loos et il est décédé à Haubourdin.
Un plan très médiocre nous apprend que ledit Dassonville était domicilié à Avelin.
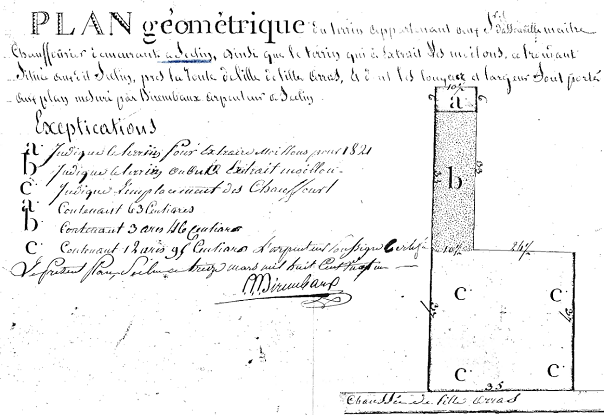
La déclaration cadastrale de Pierre Dassonville.
3) Houzé Louis. Seclinois. Nous connaissons un individu du nom à Seclin par son acte de mariage, à Seclin aussi, le 5 août 1845, avec Bernard Catherine.
Un homonyme existe. Il s’agit de Houzé Louis Joseph, né vers 1820 et décédé le 21 mai 1865 à Seclin, marié avec Descamps Catherine. Il eut pour fille Houzé Eugénie (1850-1901).
Un troisième homonyme existe : Houzé Louis François Joseph. Nous le connaissons par son mariage le 21 septembre 1819 avec Dujardin Catherine Joséphine. La date nous semble précoce pour une exploitation de catiches bornée en 1847-1848, mais nous ne pouvons pas écarter l’individu pour autant, ce serait un peu rapide.
Les trois fiches sont à considérer comme valables du point de vue des dates et localisations.
Il existe un homonyme décédé en mer à Coudekerque-Branche. Nous avons écarté sa fiche.
4) Deletombe Auguste. Phalempinois. Un individu anachronique fut témoin à un mariage en 1813. Il avait alors 53 ans, demeurait à Phalempin et se déclarait comme laboureur. Ceci était très fréquent à l’époque, voir notamment à Lezennes. Les ouvriers travaillaient en agricole à la belle saison et carrier durant la morte saison. Cela nous donne donc une date de naissance supposée en 1760. Cela nous parait très précoce, voire inadapté, car le créneau de date d’exploitation serait 1847-1849. Une autre fiche le déclare né le 18 septembre 1760 à Phalempin, ce qui est pleinement concordant.
Il existe un homonyme à Tourcoing, mais celui-ci est décédé à l’âge de 5 ans.
Il existe un second homonyme à Tourcoing, né le 26 avril 1831, marié avec Dewitte Barbe Thérèse. Le créneau de dates est peu concordant, car il ouvrirait une exploitation à l’âge de 16 ans, cela parait peu envisageable en tant que chef d’exploitation.
5) Fournier Henri. Seclinois. Il existe un individu du nom marié avec Finneman Marie Cécile Joseph le 9 mai 1832. Ce dernier serait né vers 1806 et décédé après 1873 à Seclin. Il eut pour fils Fournier Alexandre en 1834. Pour une date d’exploitation en 1853, le créneau de dates est concordant. Un second enregistrement établit le même mariage à la même date avec Penneman Marie Joseph.
6) Vasseur Désiré. Seclinois. Il nous est inconnu.
7) Cambier, Debuchy, Herbaut-Dervaux. Nous ne savons rien, si ce n’est que nous retrouvons un nommé Cambier dans le cadre de l’exploitation de Veuve Demazières. Notons tout de même que nous relevons un mariage à Seclin, le 6 juillet 1872, entre Herbaut Louis François Joseph et Dervaux Angélique. Cela pourrait être concordant.
8) Mallet-Deletombe. Nous ne savons rien, si ce n’est que le nom Deletombe se rencontre précédemment. Cela n’indique cependant rien de formel.
9) Hottin Jean-Baptiste. Carvinois. Nous relevons un individu du nom né à Carvin en 1770 et décédé en 1848. C’est un peu précoce, bien que toutefois la date d’exploitation est mentionnée « avant 1876 » par Bernard Bivert. Il est à considérer que l’information pourrait être valable, ce qui signifierait des exploitations précoces à Seclin, admettons dès le début 1800. Pour l’instant, aucun document ne vient attester ce genre d’exploitation. De l’individu en tant que tel, nous ne savons rien d’autre.
Nous relevons un homonyme, né le 22 août 1806 à Carvin. Fils de Hottin Pierre Joseph et Catenne Marguerite. La date de naissance serait un peu plus concordante avec une mise en exploitation quelque peu tardive.
10) Gruson Théodore. Nous le connaissons en tant que Seclinois (Gruson Théodore François) par son acte de mariage le 22 juillet 1840, avec Pasbecq Angélique.
11) Veuve Demazières. Nous ne savons rien de cette dame. Il est apparemment établi qu’elle reprend l’exploitation d’un nommé Cambier. Il pourrait être mis en doute qu’il s’agit du nom Desmazières, car des catiches pourraient affecter la ferme éponyme (rapport SDICS du 6 février 1981).
12) Decourtray François. Nous relevons l’existence d’un individu de ce nom, Decourtray François Henri, Seclinois, né en 1836. Fils de Decourtray Charles Antoine et Dubreucq Marie Eléonore Josèphe.
13) Dujardin Victor. Seclinois. Il s’agit d’un individu bien connu, ou tout du moins bien circonscrit. Marié le 13 novembre 1884 à Seclin avec Delecourt Joséphine. Décédé le 31 juillet 1936.
Les archives nationales du monde du travail (2006 075_INV) citent : La sucrerie a été créée en 1847 la « Société Dujardin Père et Fils », entre Augustin Dujardin, fabricant de sucre et ses trois fils, Victor, Emile et Augustin (ce dernier est admis comme associé). Les Dujardin sont une famille d’exploitants agricoles à Seclin. En 1878, la raison sociale devient « Société Dujardin Frères » entre Rosalie-Sophie-Joseph Dujardin, veuve de Augustin-Joseph Dujardin (décédé en 1874) et Augustin Dujardin, Victor Dujardin et Emile Dujardin. Puis en 1902, la société est constituée en nom collectif sous la raison sociale « Société Victor Dujardin et Fils », entre Victor Dujardin-Mulliez et Victor Dujardin Fils. Le siège social est situé à la sucrerie, à l’angle des routes de Pont-à-Marcq et Douai.
Le fait qu’il s’agit d’une usine conséquente à l’époque pourrait expliquer qu’il s’agit de la seule carrière à catiches de taille industrielle à Seclin. Cela expliquerait aussi que, sorti du contexte familial, nous ne soyons pas dans le secteur de la rue Maurice Bouchery.
A minorer toutefois, nous avons ici une ouverture d’exploitation sous le nom Dujardin Victor et fils en 1906. Rien ne vient attester que Victor était actif en tant que carrier, car l’exploitation est menée par la société. Quoi qu’il en soit, le créneau de dates est parfaitement concordant.

La sucrerie Dujardin de Seclin. Photo : bibliothèque municipale de Lille.
14) Vasseur Robert. Seclinois. Nous ne savons rien de lui. La numérotation du n°73 rue de Lille, adresse de sa domiciliation, ne correspond plus à aucune donnée concordante à ce jour, il s’agit d’une adresse dans la zone d’activité économique. La date d’exploitation est 1913, ce qui correspond apparemment aux toutes dernières catiches de Seclin.
15) Vasseur-Dimiez. La numérotation du n°130 rue de Lille, adresse de sa domiciliation, ne correspond plus à aucune donnée concordante à ce jour, il s’agit d’une adresse dans la zone d’activité économique. C’est situé en face du n°73, à quelques détails près. Nous ne savons rien du couple. Notons juste que nous citons précédemment un Vasseur Désiré, dont nous ne savons non plus rien.
Nous relevons uniquement un mariage entre Dimiez Lucrèce Adèle et Vasseur A. Nous ne possédons ni date ni prénom.
Le recensement de 1906
S’il y a bien une commune où il était escompté ne pas se localiser beaucoup d’informations dans le recensement de 1906, c’est bien Seclin. L’exploitation était trop modeste et familiale afin que ça soit déclaré comme métier. Voici les quelques enregistrements trouvés :
![]()
Vasseur Charles, né en 1848, chaufournier à son compte.
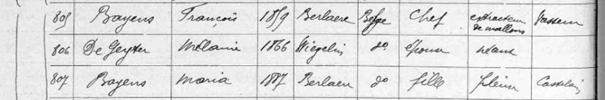
Bayeux François, né en 1859, extracteur de moellons. C’est une donnée intéressante car c’est finalement un des rares de tous les enregistrements à se déclarer véritablement comme carrier.
Analyses et conclusions
Dans l’ensemble, les 15 ouvertures d’exploitations sont bien identifiées. Si l’on ne possède pas le détail parfait concernant les exploitants, ils sont au minimum chacun nommé, ce qui permet de bien réaliser un découpage séquentiel des exploitations. Les dates sont visiblement 1820 pour les plus précoces et 1913 pour les plus récentes. Le pic d’ouvertures serait 1855-1860 et un déclin très rapide, 1890. Il est suspecté une exploitation ancienne à proximité de l’église mais à ce jour, aucune investigation n’a permis de localiser ce site, qui pourrait dès lors relever de la légende.
Les exploitations de la rue Maurice Bouchery et route de Lille sont toutes des excavations mono-familiales, qui ont sur le principe assez bien respecté les limites de propriétés. Seule l’exploitation de la RD 549 est de type industriel. Aucune exploitation n’est autre que du tout catiches.
Toutes les exploitations sont visiblement hors du secteur de la pierre de construction. Elles sont déclarées en tant que chaufour (exploitation de chaufournier) et/ou incluses dans la production de sucre. A la période concernée, cela faisait déjà longtemps que la brique avait supplanté la pierre en matière de construction.
Au sujet des chaufours, il est mentionné l’existence de deux fours, qui étaient situés dans la cité du Groupe Lénine, jusque dans les années 1950. La production de chaux a largement émaillé la culture industrielle du Nord-Pas-de-Calais dans la période de 1850-1900. L’ouverture d’exploitations fut assez intense (Saint-Saulve, Marly, etc). Rien d’étonnant donc à ce qu’on en rencontre dans le Mélantois.
Dans la production du sucre, la chaux est utilisée en tant que produit qui permet l’épuration des impuretés par un phénomène de précipitation.
Seclin
concentre les exploitations situées les plus au sud du Mélantois. Ce sont de
petites exploitations comparables à celles de Loos et Wattignies. La bonne
circonscription des données archivistiques en fait une commune intéressante et
exemplative en matière d’exploitations récentes de catiches.
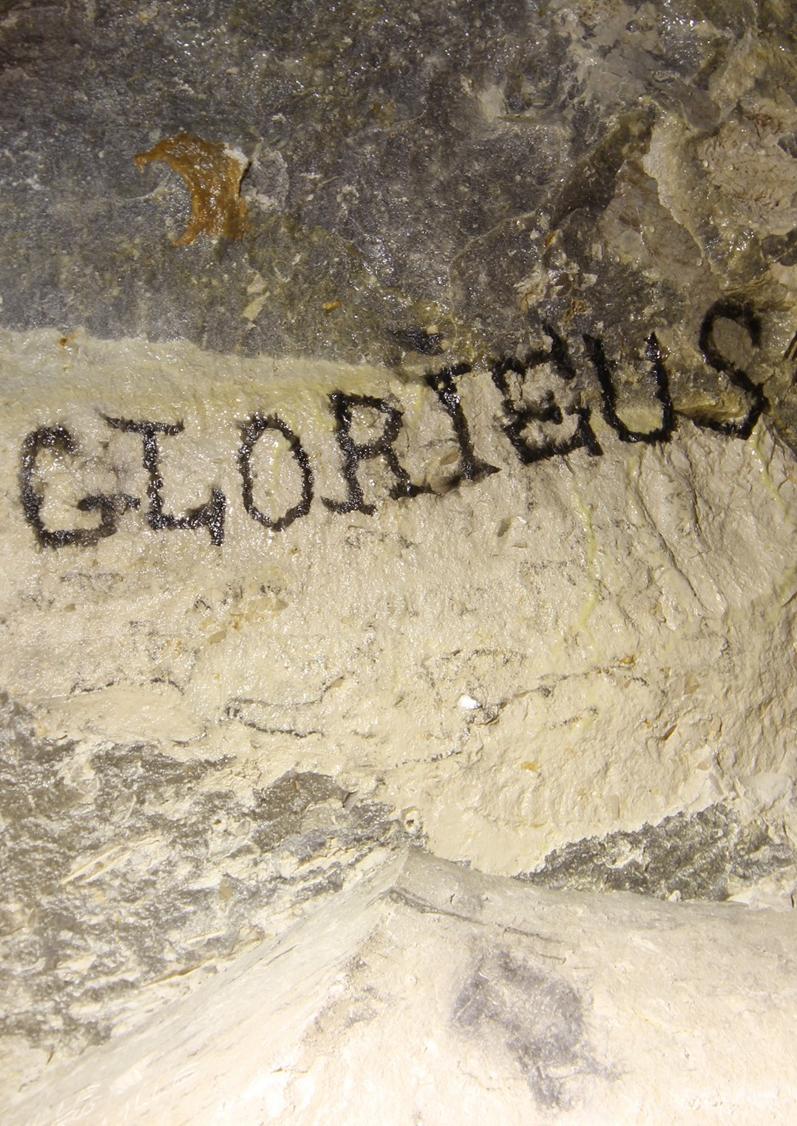
Vendeville, retour aux sources
Très nombreuses sont les exploitations par catiches dans le sud de Lille, on en suppose une valeur approchant les 300 ; c'est assez difficile à dénombrer car certaines sont minuscules, d'autres tentaculaires. Assez curieusement, Vendeville ne fait l’objet d’aucune publication spécialisée. Les textes font mention de « possibles excavations », sans précision aucune. Même Bernard Bivert reste fort évasif à ce sujet. Cette situation de vide documentaire n’a pas lieu d’être, car les catiches de Vendeville existent réellement, de plus il s’agit d’un réseau intéressant. Nous proposons un petit document de synthèse à ce sujet.
Nous avons actuellement connaissance d’une carrière, située sur l’extérieur du village. En une époque reculée, les carriers ont ouvert une exploitation dans les champs, de manière à ne pas sous-miner l’habitat. Avec l’urbanisation galopante, cet habitat a fini par rejoindre et recouvrir la zone de carrière. Nous n’avons connaissance que d’un seul site souterrain, bien que le PPRMT évoque une situation quant à lui presque catastrophiste. Cela nous semble être une projection à aborder avec moult précautions.
Quant à parler de la carrière souterraine de Vendeville, il faut plutôt évoquer deux sites, lesquels sont attenants. Ce sont deux exploitations, rejointes par un petit tunnel. Ce tunnel n’a pas une apparence muraillée. C’est une simple courte galerie informe, permettant de faire la jonction entre les deux sites. Sans être attentif, on ne se rend pas compte qu’il s’agit d’un tunnel. Par contre, les deux exploitations sont relativement dissemblables.
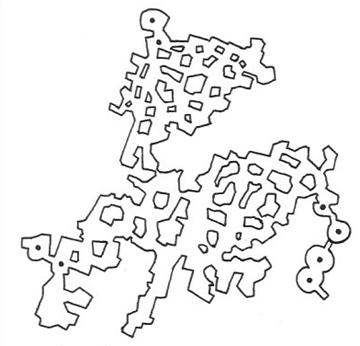
Le plan de l'exploitation.
La carrière la plus ancienne est de taille relativement restreinte, en excavation mixte catiches et chambres & piliers. Vu que tous les déchets d’exploitation ont été déposés au sol, elle a une apparence chaotique. Dans l’ensemble, elle est dans un état relativement bon. Elle sous-mine les champs. Vu les inscriptions, l’excavation aurait été réalisée dans une période avoisinant les 1770-1780. Des poursuites d’activité seraient possibles jusqu’à 1790, vu la dimension du souterrain, mais nous ne disposons d’aucune preuve si ce n'est la signature d'Eloy Bigotte à cette date.
La carrière la plus récente est de plus grande dimension : hauteurs, largeurs et dimension globale de l'exploitation. Les lieux sont en excavation mixte catiches et chambres & piliers. Il y a peu de catiches. Cette carrière est en bon état, sauf en quelques lieux ponctuels. Elle sous-mine principalement l’habitat.
Nous ne disposons d’aucune datation fiable car il n’y a pas d’inscription de carrier. Vu le type d’exploitation, il s’agit de travaux menés vraisemblablement dans une période étalée de 1810 à 1830.
A ce titre, nous contredisons deux citations de la Voix du Nord.
* La première carrière n’a pas servi aux travaux Vauban de la citadelle. Ces travaux sont antérieurs d’un siècle.
* La seconde carrière n’a pas servi aux fours à chaux. Il est clairement établi, vu les blocs, qu’il s’agissait du débit de pierres de taille.
Nous avons donc là deux sites d’extraction en vue de travaux de construction. Il peut tout à fait s’agir des rouge-barres locales ou bien de chantiers plus éloignés.
Vincent Loisel mentionne que les lieux ont été exploités en vue de la culture des champignons jusqu’en 1950. Il n'en reste aucun vestige à ce jour.
Les inscriptions relevées dans les deux carrières sont de trois ordres : les graffitis de carriers dans l’exploitation ancienne (1771-1790), les graffitis de réfugiés dans l’exploitation récente (1944), les graffitis récents et généralement de peu d’intérêt (1991), sauf un seul.
Le relevé des inscriptions
Carrière ancienne
Les chiffres 7 sont tous écrits sans la barre transversale, ce qui témoigne bien qu'il s'agit de graphes authentiques.
- Eloy Bigotte, 1790
- 1776 Bigotte
- Jean (…) Cordonn (…) 1776 – Nous estimons qu’il pourrait s’agir de Jean-Baptiste Cordonnier.
La datation n’appelle pas de doute. Le prénom quant à lui c'est compliqué. Le Baptiste est effacé. Disons que c'était un prénom très courant à l'époque, d'où la supputation.
- 1771 – La datation est douteuse car le dernier chiffre est abimé. Il pourrait s’agir de 1777.
- Monsieurs et M (…) 1778 M – Il pourrait s’agir de Monsieurs (en réalité Messieurs) et Madame quelque chose, en 1778. La date semble être ajoutée car elle est tracée à la pointe, le reste à la tête de pic. En dessous, le scripteur s’est entrainé à tracer un beau M. Monsieur est au pluriel, même si le « s » semble avoir été ajouté par après.
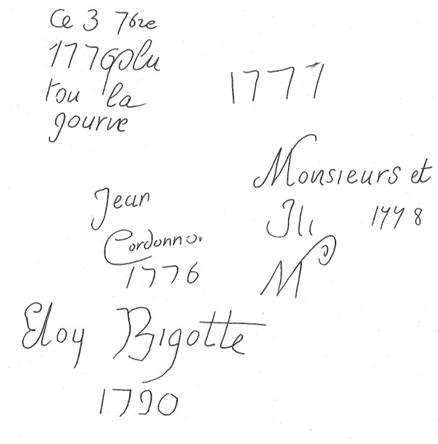
- Ce 3 7bre 1776 plu tou la journe – Nous avons ici un bulletin météo du 3 juillet 1776. Il a plu toute la journée. Il s’agit d’un mercredi. Comme en de nombreuses autres inscriptions, c'est écrit à la pointe de fusain.
- Bonne Bierre Pierre Lambrez Buillieu Jean Gaston Venn Cordonni(…) Camb(…) Lou(…) 177(…) 6+
Cette inscription est compliquée car fort difficile à lire, ainsi nous plaçons son interprétation sous caution. Nous supposons qu’il est écrit qu’il s’agit en cet endroit de « bonne pierre » à exploiter, et qu’en dessous figure le nom de l’exploitant (potentiel ?) à savoir peut-être Pierre Lambrez. En dessous, il pourrait s’agir de Jean Baillen, sous très hautes réserves, ainsi qu’un Gaston. Ce Gaston est a priori une erreur de lecture. C'est un prénom qui n'existait pas à l'époque. On retrouve (probablement ?) Jean Cordonnier. En dessous, éventuellement Cambier Louis. La date pourrait être 1776, mais le 6 est porté en dessous, en forme de C.
Dans tous les cas, c'est une inscription datant immanquablement de 177x et faisant référence à Jean-(Baptiste) Cordonnier. C'est donc une inscription relative à des questions de carriers et d'extraction de pierre.
Retrouve-t-on ces noms dans les archives ?
Oui pour Eloy Bigotte. Il avait 36 ans le 10 prairial an X, déclaré comme agriculteur auprès de l'administration de Templemars à cette date. Il serait donc né en 1765, donc 11 ans à son premier graffiti, 25 à son second. Concernant tous les autres, aucune information n'est disponible dans l'immédiat. On peut supposer que, comme bien des endroits, les ouvriers travaillaient la terre à la bonne saison, la pierre à la mauvaise. Lezennes témoigne beaucoup en ce sens.
Sur Vendeville, Cyrille Glorieus relève Jean-Baptiste et Jean-Félix Godefroy, tous 2 frères, carriers au village et résidant rue de Faches. Ces noms n'ont pas été localisés sur les parois.
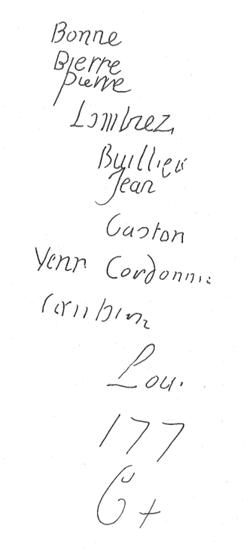
Carrière récente
- Glorieus – A la flamme. Il s’agit de l’inscription de Charles Glorieus, réfugié dans la carrière en 1944. Cette personne est le grand-père de Cyrille Glorieus.
- Moi Cyrille Glorieus / 23 ans de Lille / Ce 15-6-2013 / Descendant du village / De Vendeville / en Mélantois. Il s’agit de Cyrille Glorieus, petit-fils de Charles Glorieus et désormais habitant de Vendeville.
- Le grand mur
gravé (en interne, nous l'appelons le mur des lamentations).
A mon amour Odette / Odette Brackenier / 1814 / Jacques / Louis Dechand /
Toussaindechain / 1944 / J-M V / Jean-Marie / NJacques
Toutes ces gravures sont éparpillées et les / sont des symboles utilisés ici permettant de séparer chaque inscription.
Odette Brackenier : non identifiée. Il s'agit vraisemblablement de « Odette Brackenier » et non « Kenier », ce dernier patronyme n'étant pas un nom à consonance nordiste. L'écriture imparfaite au mur est dure à lire, d'où la faute possible. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une habitante de Seclin, veuve Hornain, décédée à 84 ans au printemps 2015. En 1944, elle avait 13 ans.
Louis Dechand / Toussain Dechain : ce ne sont pas des noms de Vendeville, mais de Faches. Nous ne disposons d'aucune information complémentaire.
Jacques N : il s'agissait de Jacques Nahant, dont la famille habitait à l'époque la ferme de l'actuel n°5 rue de Seclin.
Jean-Marie V : il s'agissait de Jean-Marie Verupenne ; si l'on regarde attentivement la paroi, « Verupenne » est bel et bien écrit. Né à Vendeville en 1934, y décédé en 1984. Fils de Clément et de Marie Grandpold. Il avait 10 ans en 1944.
Ces graffitis sont tous datés de 1944 sans exception. Cela donne l'idée que tous ces graffitis sont en réalité réalisés par des enfants.
Entre ces inscriptions se trouve un 1814. Cette date 1814 n’a rien à voir et nous ne savons pas à quoi ça fait référence. Serait-ce la date de l’exploitation ? Nous sommes amenés à penser qu'il s'agit en réalité d'une mauvaise lecture, car le scripteur a effectué là un tracé identique aux lettrages de 1944. Ce pourrait être : ?|8|4 ? soit une date d'août dans les années '40. Concernant cette date de ?/8/4?, cela pourrait correspondre à août 44 du fait que : « Les bombardements proches du village pendant la guerre étaient très fréquent en août 1944 à l’approche du front ».
Les inscriptions sont complétées par des dessins :
- Un avion bombardant une maison.
- Deux installations de DCA lançant des obus.
- Un avion avec des marquages allemands se faisant tirer dessus.
Ce type d'inscription est extrêmement rare.
ABRI – Ce qui témoigne bien que le lieu servait d’abri potentiel en 1944. Il s'agit simplement de potentialités, car Vendeville n'a pas été bombardée.
- Il y a aussi une inscription « Antoine Delbecque » écrite au noir de bougie un peu plus loin, qui correspond à un Vendevillois du même nom. Malheureusement, son graffiti est mal conservé et il y eut grande peine à déchiffrer correctement le nom. Il était fils d'Henri et de Prudence Lécluse, deux belges de Comines qui habitait n°23 rue de Seclin en 1975. A relever aussi une inscription « Smal Charles ».
- Dupont – Il s’agit d’une personne qui était employée au SDICS.
- Karl Glitergold 1991 – Cette inscription n’a malheureusement aucun intérêt historique. Il s’agit du dieu des gnomes dans Donjons et Dragons, dont l'orthographe exacte est Garl Glittergold avec 1 G et 2 T.
- Les dessins des visiteurs : Eric B / Jean-François (autoportrait) / G. / Franck / Grégory (autoportrait) / 09-05-1991. Nous supposons qu’il s’agit de visiteurs du souterrain, vendevillois et épris des lieux. Nous n'en identifions aucun.
A cela sont à ajouter les mentions trouvées dans les actes notariés. Nous relevons :
style='line-height:- Hippolyte Payelle, journalier, "ouvrier carrier" en 1876 lorsqu'il achète, avec un Vendevillois voisin, la maison de la famille Masse-Guillain, rue de Faches, mise en adjudication.
style='line-height:- Jules Longuépée exploitait une champignonnière à Vendeville jusque dans les années 1960. Dans les années 1920, lorsqu'il s'installe rue de Faches à Vendeville en se mariant avec une Verburgt, Jules est dit "champignonniste chez Crombet Thumesnil".
style='line-height:Il est aussi qualifié de "foreur de puits", ce qui explique alors les nombreux puits du village. Un acte de vente de sa voisine mentionne le fait que Jules avait un ancien puits à eau sur son terrain, qu'il a rebouché afin de construire sa maison (toujours existante), et qu'il a creusé un nouveau puits auquel il devait assurer l'accès pour ses voisins. Aurait-il creusé aussi un accès en carrière ?
- Dans un acte notarié de 1831, Jean-Baptiste Deschamps, carriéreur à Vendeville, est le même qui est désigné comme chaufournier quelques années après. L'acte est un devis-convention en vue de faire bâtir une maison à base de moellons.
Haubourdin, l’anecdotique
Bernard Bivert y recense l'existence d'une déclaration d'ouverture de carrière en 1914, par Monsieur Marty, administrateur délégué de la Société des Ciments et Chaux Hydrauliques du Nord. Il suppose que cette exploitation affectait le site de la cimenterie d'Haubourdin.
Les sites d'exploitation à ciel ouvert semblent avoir été assez mouvants. Rien ne s'oppose à des extensions en souterrain, mais nous n'en savons simplement rien. De ce fait, nous considérons Haubourdin comme une commune un peu à part dans le Mélantois. A ce jour en tout cas, il ne subsiste plus aucune exploitation souterraine à Haubourdin.

La carrière en 1931.
Templemars, l’inaccessible
Les carrières de Templemars sont de développement très limité et offrent un intérêt plus que sommaire. Nous listons les exploitations ci-dessous.
Il existe une carrière médiévale de petite taille, située au croisement de la rue Jules Guesde et de la rue Jean Mermoz. Nous ne connaissons rien de ce site, si ce n’est qu’il sous-mine la route et des terrains privés. Il ne se trouve pas à Templemars d’autre exploitation souterraine qui soit à considérer.
Il existe une carrière de type catiches au 41 rue Jean-Baptiste Mulier, à l’angle des rues Pierre Curie, d’Ennetières et Voltaire. Cette carrière comporte environ 6 catiches. Il est mentionné « environ » car certains puits en ont le volume mais ne sont pas obturés par un encorbellement. Une maison de type hangar est largement sous-minée.
Deux effondrements de terrain se sont produits rue Pasteur et rue Voltaire, révélant la présence de catiches. De même, au n°103 rue Jules Guesde près de la mairie, un affaissement datant de 1988 a révélé la présence d’une carrière souterraine.
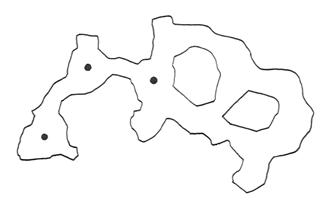
Une des petites carrières de Templemars.
Dans le passé de cette commune, nous relevons de nombreux intervenants liés aux carrières. Nous escomptions ne rien trouver dans le recensement de 1906. La surprise fut présente lorsque les enregistrements accumulés prouvèrent le contraire. Voici les personnes qui à cette date avaient un lien avec les carrières.
![]() Sury
Henri, né en 1842, tailleur de pierres chez Dhélin de Lille.
Sury
Henri, né en 1842, tailleur de pierres chez Dhélin de Lille.
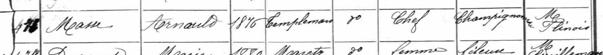
Masse Arnould, né en 1876, champignonniste chez Flinois.

Flourez Jean-Baptiste, né en 1849, champignonniste chez Crombez de Faches.
![]()
Masse Adolphe, né en 1859, champignonniste chez Crombez de Faches.
![]()
Laloux Edouard, né en 1862, champignonniste chez Crombez de Faches.
![]()
Milleville Maurice, né en 1877, champignonniste chez Crombez de Faches.
![]()
Milleville César, né en 1856, champignonniste chez Crombez de Faches.
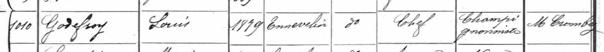
Godefroy Louis, né en 1879, champignonniste chez Crombez de Faches.
![]()
Mouveaux Charles, né en 1844, tailleur de pierres chez Carlier.
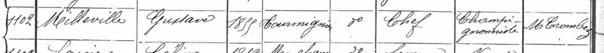
Milleville Gustave, né en 1859, champignonniste chez Crombez de Faches.
Outre ce relevé, nous avons connaissance d’un ouvrier templemarois : Pennequin Fleurisse Dominique, né en 1727 à Templemars et décédé le 5 mai 1759 à Faches. Il se déclare en tant que carriereur à Templemars. Il se marie le 15 mai 1759 avec Leclerc Anne Véronique.
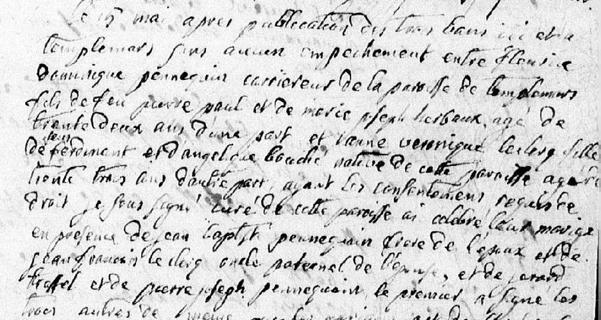
Fleurisse Pennequin.
Wattignies, l’Arbrisseau
La commune de Wattignies possède 16 carrières souterraines, qui sont toutes récentes et toutes creusées en tout catiches. Elles sont toutes situées sur le nord de la commune, majoritairement sur le quartier de l’Arbrisseau. Les déclarations de carrières concernant ces sites ont été perdues, ainsi les informations sont très lacunaires. Dans l’ensemble, ce sont des petites exploitations, il n’y a rien d’ampleur à Wattignies, sauf la carrière Potey.
Nous relevons les carrières suivantes :
W2864 – Une carrière, située aux 71 à 83 rue Clémenceau, 1 à 5 rue Pasteur, cité Gutemberg et cité Montgolfier. Cette petite exploitation affecte aussi bien les habitations que les jardins.
W2865 – Une carrière au développement assez compliqué, située au sud de la W2869.
W2866 – Une minuscule exploitation, de 6 catiches, sous la cité Montgolfier.
W2867 – Une assez vaste carrière au développement compliqué et fractionné, sous les habitations du chemin du Patronage. Cette carrière se poursuit sous les champs à l’est de la rue Pasteur.
W2868 – Une carrière située sous entre les n°83 à 91 rue Philippe de Girard. Cette toute petite carrière affecte les jardins.
W2869 – Une fort vaste carrière située sous les rues Jules Ferry, Clémenceau, englobant la totalité des champs au sud de l’école, jusqu’à l’établissement Pièces Auto Wattignies. Cette carrière est localement connue sous la dénomination « carrière Potey ». C’est la plus grande exploitation de Wattignies.
W2870 – Une carrière que nous ne connaissons que partiellement, au nord de la rue Jules Ferry et à la rue Jean Jaurès. Cette carrière a été en partie comblée en 1987 et 1994. Située sous la rue Jules Ferry et l’impasse La Fontaine, elle affecte partiellement l’école ; Les comblements mentionnés concernent une large part de la carrière, sous les habitations. Le site possédait 47 catiches, à ce jour en deux sites distincts il subsiste 19 catiches.
W2871 – Une carrière affectant les habitations localisées aux alentours des n°154-166 rue Clémenceau.
W2872 – Une petite carrière située rue Clémenceau et affectant l’établissement Mac Donald’s.
W2873 – Une seule catiche sous un garage de la rue Chevalier de la Barre.
W2874 – Une carrière a été découverte en 2005 suite à un effondrement, au croisement rue d’Haubourdin et des Aubépines, près du feu rouge. C’est un minuscule réseau de 11 catiches. Attention au fait que la tête de puits est extrêmement dangereuse. Un trou est masqué par la végétation.
W2875 – Une carrière a été découverte des n°1 au 7 rue Albert Samain. Il existe probablement une liaison avec la carrière située rue Chevalier de la Barre. Vu la construction récente d’un lotissement et notre plan datant de 1991, nous supposons que tout a été remblayé par le lotisseur. Cette carrière comprend / comprenait (?) 51 catiches.
W2876 – Une carrière existe à la rue Chevalier de la Barre, aux n°61 à 71, et aux n°59 à 75 rue d’Haubourdin. De multiples remblaiements rendent le site pour le moins compliqué. Cette carrière, non comptabilisée ici, est décrite à Faches-Thumesnil à hauteur de la centrale téléphonique. Cette carrière est une prolongation de la précitée.
W2877 – Quatre à six catiches isolées des n°13b à 26 rue Chevalier de la Barre.
W2801 – Ajoutons à cela une carrière à catiches que nous connaissons mais mentionnée nulle part, située dans le bois face à la rue Jean Mermoz. Cette zone est toutefois couverte de bleu dans le PER de Wattignies.
W2802 – Ajoutons une carrière isolée dans le champ à l’ouest de la rue Jules Ferry. De petite taille, cette exploitation en tout-catiches a très peu d’intérêt.
W2803 – Une petite exploitation en tout-catiches sous-minant la totalité du n°25 rue Jules Ferry.
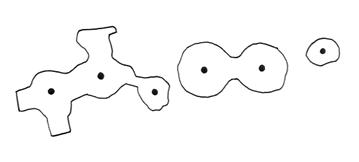
Le site W2877
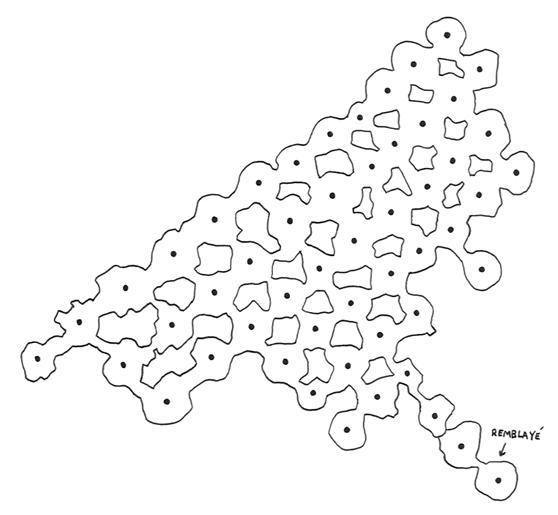
Le site W2875.
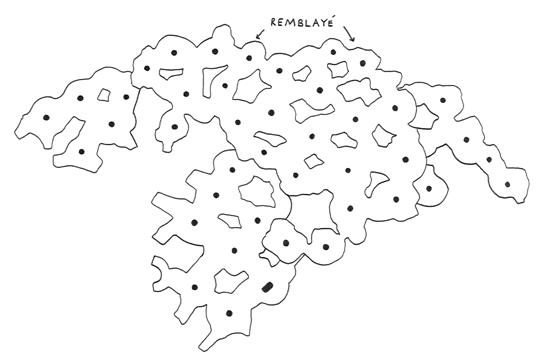
Le site W2870.
Concernant Wattignies, que trouver dans le recensement de 1906 ? Quelques carriers de catiches récentes, des champignonnistes vers Faches ? En réalité, le nombre d’enregistrements est élevé. Voici les personnes concernées par les carrières :
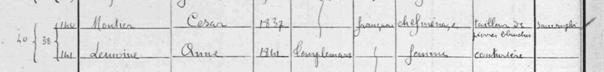
Moutier César, né en 1837, tailleur de pierres blanches.
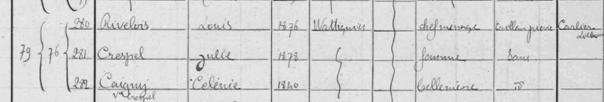
Rivelois Louis, né en 1876, tailleur de pierres chez Carlier à Lille.
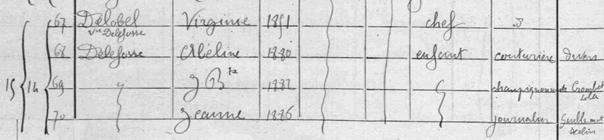
Delefosse Jean-Baptiste, né en 1882, champignonniste chez Crombez de Faches. Précision, l’enregistrement « chez Crombet à Lille » est inexact.
![]()
Brasdefer Edouard, né en 1851, tailleur de pierres chez Dhalluin à Lille.
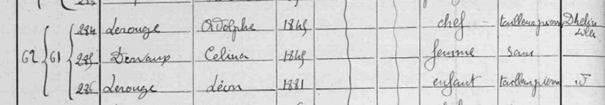
Lerouge Adolphe, né en 1845, tailleur de pierres chez Dhelin de Lille et Lerouge Léon, né en 1881, même emploi.
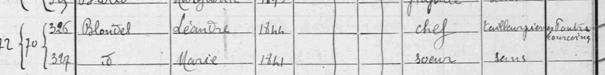
Blondel Léandre, né en 1844, tailleur de pierres à Tourcoing.
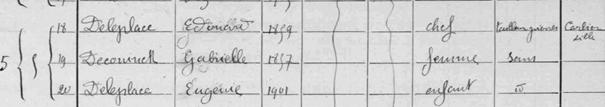
Deleplace Edouard, né en 1859, tailleur de pierres chez Carlier à Lille.
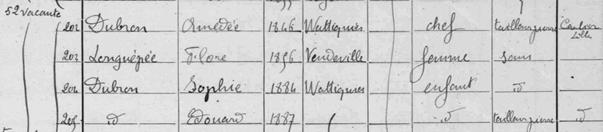
Dubron Amédée, né en 1846, tailleur de pierres chez Carlier à Lille et Dubron Edouard, son fils, né en 1887, même emploi.
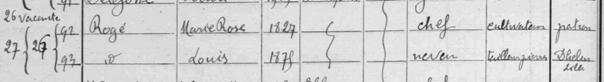
Rogé Louis, né en 1875, tailleur de pierres chez Dhelin à Lille.
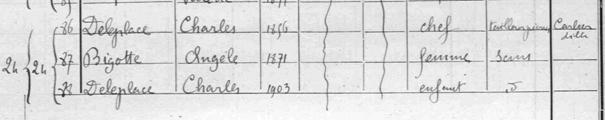
Deleplace Charles, né en 1856, tailleur de pierres chez Carlier à Lille.
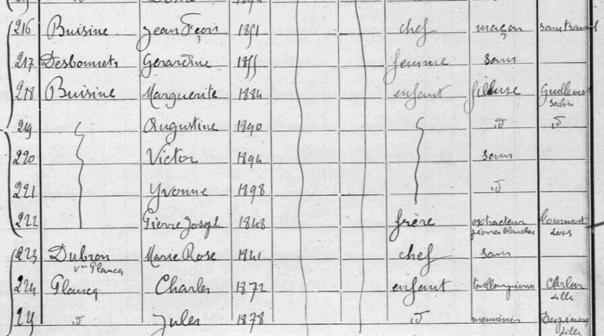
Buisine Pierre Joseph, né en 1848, extracteur de pierres blanches chez Tournant à Loos. C’est un des forts rares à se déclarer véritablement comme carrier.
Plancq Charles, né en 1872, tailleur de pierres chez Carlier de Lille.
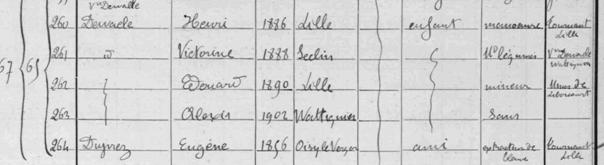
Dewaele Henri, né en 1886, manœuvre chez Tournant à Loos et Duprez Eugène, né en 1856, extracteur de blanc chez Tournant de Loos.
![]()
Leroy Edmond, né en 1881, champignonniste chez Crombet à Thumesnil.
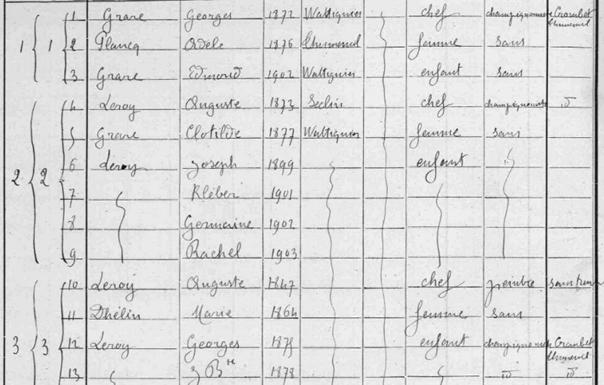
Grare Georges, né en 1877, champignonniste chez Crombet à Thumesnil.
Leroy Auguste, né en 1873, même emploi.
Leroy Georges, né en 1875, même emploi.
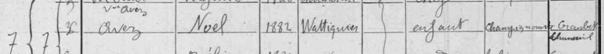
Avez Noël, né en 1882, champignonniste chez Crombet à Thumesnil.
![]()
Thybaut Edouard, né en 1876, tailleur de pierres chez Dhelin à Lille.
![]()
Plancq Adolphe, né en 1836, tailleur de pierres chez Dhelin à Lille.
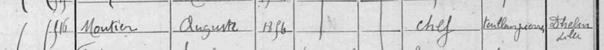
Moutier Auguste, né en 1856, tailleur de pierres chez Dhelin à Lille.
Nous
pouvons signaler aussi l’existence de Liagre Amand Fidèle Joseph, né le 5
décembre 1797 à Lille et décédé le 17 juillet 1862 à Wattignies. Journalier,
ouvrier carrier. Il se marie avec Roussel Virginie Augustine.

Loos, la carrière farouche
Les catiches de Loos forment un réseau
impressionnant. Après Lezennes, Loos est la première ville en matière de
densité de carrières. Les catiches sont accolées dans un dédale impressionnant.
Ces souterrains sont injustement méconnus. On entend parler des catiches de
Lille, de Lezennes, mais jamais de Loos. Pourtant le patrimoine est ici de
valeur, ancien et conséquent. Que demander de plus ? C’est en cela que –
plus encore que les autres communes, bien que chacune porte sa
spécificité – nous avons voulu décrire ces lieux autant que possible.
Autant que possible ne signifie pas pour autant une masse impressionnante de documentation. Les archives sont extrêmement pauvres. Nous avons collationné tout ce qui est possible et imaginable. Ainsi, ce document est une étude détaillée des carrières souterraines de Loos.
Les catiches de Loos sont situées très majoritairement (quasiment exclusivement) sous des terres agricoles et très peu sous l’habitat. Cela change de la situation de Lezennes, où les carrières médiévales sont situées sous un habitat qui s’est étendu. A ce titre essentiellement, les catiches de Loos, bien que formant un réseau extrêmement complexe, n’attirent pas l’attention. Effondrement s’il y a, celui-ci se trouve circonscrit à des terres cultivées. De nos jours, sauf le spécialiste, qui connaît véritablement les catiches loossoises ?
Au vu des plans, on pourrait les croire insipides, récentes, sans histoire. Etonnamment, c’est loin d’être le cas. Tout est présent en vue de tromper l’historien (nous y reviendrons), et pourtant indiscutablement, les carrières sont anciennes. Nous parlons de patrimoine injustement méconnu, c’est du simple fait que les « avantages », si l’on puit dire, sont totalement occultés.
Nous proposons ici une étude en deux parties.
1) La description des carrières existantes.
2) Les recherches généalogiques et historiques au sujet des carriers.
La description des carrières existantes
Bernard Bivert, dans son opus un, décrit avoir mené des investigations dans 26 carrières. Quant à ce nombre, de notre côté nous préférons ne pas compter. En effet se posent des problèmes d’ordre structurel :
- La plus grande carrière comporte d’après lui 948 catiches. La plus petite en comporte 3. Est-ce comparable ? Nous ne le pensons pas.
- L’ensemble du Bon Dieu Noir, c’est une seule carrière ou bien de nombreuses exploitations accolées ? Nous en sommes aux hypothèses avant les réponses.
En tout état de cause, Loos est la troisième ville en matière de volumes de creusements. Lezennes totalise le record, ensuite Hellemmes, puis vient Loos.
Selon Bernard Bivert, Loos totalise 3607 catiches pour 720.000 mètres cubes d’extraction.
De notre côté, nous avons actuellement comptabilisé 3164 catiches.
Les carrières s’organisent selon deux secteurs. « Seulement » deux secteurs devrions-nous dire, si l’on compare à Ronchin ou Faches, où les exploitations sont éparpillées sur le territoire. Deux secteurs, et encore c’est un choix, car ces deux espaces d’exploitation sont pour ainsi dire jointifs.
1) Le secteur du Chemin des Postes.
2) Le secteur du Bon Dieu Noir.
Le secteur du Chemin des Postes comporte une multiplicité de petites exploitations et une plus grande. Les petites exploitations sont quasiment toutes localisées dans un secteur restreint proche du chemin des Postes. Ce sont des réseaux en mauvais état, en voie de comblement, partiellement comblés ou totalement excavés et remblayés.
La plus vaste exploitation de ce quartier est située en pourtour et en dessous de la faculté de pharmacie. Elle déborde sur le territoire de Loos, mais la plus grande part est située à Lille. En cette raison, nous préférons la rattacher à Lille ; ainsi nous ne l’aborderons pas.
Le secteur carrier du Chemin des Postes n’est décrit dans aucun document ancien.
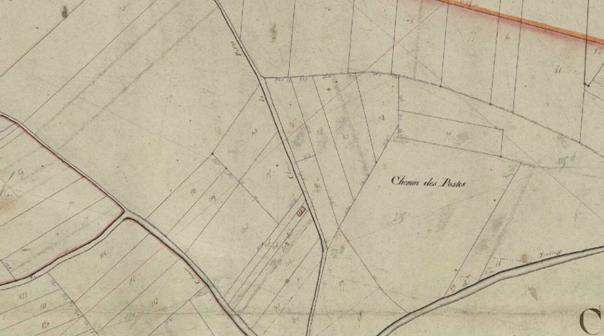
Le cadastre de 1814.
Ces exploitations du Chemin des Postes sont amplement comparables (voire même assimilables) aux carrières situées à Lille Sud, notamment le secteur CHRB Calmette. Ce sont des excavations réalisées à faible profondeur (du fait de la nappe phréatique), de faible ampleur, de faible qualité et dont l’état résiduel à ce jour est préoccupant. C’est à ce titre d’ailleurs que l’on s’en est préoccupé au fil du temps : elles n’existent que par portions et sont tôt ou tard vouées à disparaître.
Le secteur du Bon Dieu Noir.
Cette appellation originale correspond à une chapelle érigée au coin du chemin de Flesquières et du Chemin Vert. A la base, le nom est dû à la tunique noire que revêt l’ecce homo. Nous émettons de même l’hypothèse que ce nom est dû à la pierre. L’édifice est bâti en silex noirs. Cela donne une apparence originale à l’édifice. Les silex viennent à n’en pas douter des rognons trouvés dans les carrières.
Le secteur du Bon Dieu Noir est borné par la rue Guy Môquet à l’ouest, le chemin de la carrière d’Avesnes au nord, le chemin de Flesquières au sud, plus ou moins l’IRTS à l’est. Dans les temps anciens, les chemins ont fait objet de bornages (le chemin de Fléquières (orthographe ancienne), le chemin Vert, la rue Chevalier de la Barre). Il y eut de nombreuses infractions en matière de dépassements des limites.
Le secteur du Bon Dieu Noir n’est connu sur aucune carte ancienne, ce qui peut apparaître à la fois étonnant et significatif.
Etonnant, car le secteur carrier est immense.
Significatif, car tout simplement cela signifie qu’à la date de confection des cartes dont nous disposons, 1814, 1820, 1864, 1910, tout était achevé. De cet état d’achèvement nous sommes convaincus et de même nous y reviendrons.

Le cadastre de 1864.
Comme ce fut brièvement évoqué, les secteurs des Postes et Bon Dieu Noir sont proches d’être jointifs. Toutefois signalons que la structure n’est pas comparable. Nous estimons que le chemin des Postes relève de l’exploitation traditionnelle comme on en rencontre en de nombreuses villes du Mélantois (citons ici Lille, Seclin, Lesquin à titre de comparaisons). Nous estimons que le site du Bon Dieu Noir relève de l’exploitation de bagnards.
Une exploitation de bagnards
Cette notion est difficile à caractériser et pourrait faire l’objet de critiques comme quoi il s’agit d’une vue empreinte d’exagération. Disons alors que ce terme reste à préciser.
Dans une période troublée à la fin du XVIIème siècle, un individu du nom de Sébastien Le Prestre de Vauban (plus connu sous le simple nom de « Vauban »), reçoit l’ordre d’établir la citadelle de Lille, dite la Reine des Citadelles. Lille est prise aux Espagnols par les troupes françaises au mois d’août 1667. En cette année, Louis XIV ordonne aussitôt la construction d'une forteresse.
Afin que ces travaux titanesques soient menés à bien, Vauban va recruter dans la population paysanne locale des milliers de carriers, dans le but d’obtenir des moellons de craie. C’est ainsi qu’une bonne part de Lezennes fut creusée. C’est de cette manière aussi que Loos est creusée, la datation des sites en est témoin.
Vauban ayant du mal à trouver la main d’œuvre en suffisance et Louis XIV s’impatientant, les paysans son recrutés en masse. Cela se passe contre leur gré vu la pénibilité du travail et l’extrême pauvreté des salaires. Il en a résulté un travail de forçat, des désertions et de multiples relations conflictuelles.
La relation que Loos a avec sa terre est plus complexe que ce simple résumé imparfait. En effet, des exploitations classiques ont été ouvertes par la suite, au Bon Dieu Noir même ; des exploitations de barbe de capucin et de champignons ont été menées au sein même de ces galeries ; une chose encore, signalons que des réfugiés, des déserteurs, des promeneurs, des carriers, ont inscrit des textes aux parois.
Tout cela rend le schéma de creusement éminemment compliqué à étudier, ce qui somme toute est le cas dans une part non négligeable du Mélantois. Loos se trouve juste être exemplative.
L’étude des exploitations du Bon Dieu Noir
Ecrire à ce sujet est éminemment difficile. Une très large part de déduction entache l’analyse et des zones d’inconnues affectent des aspects essentiels. Au vu de ces facteurs conjugués, nous aborderons le sujet avec la prudence qui s’impose.
L’exploitation du Bon Dieu Noir est (fut) un seul très vaste espace de creusement, comportant deux grands satellites sur la partie sud et quatre très petits satellites insignifiants sur les pourtours. L’écrasante majorité du volume est (était) un unique souterrain. Les exploitations diverses et variées se sont donc quasiment toutes recoupées.
Pourquoi le mélange incertain entre le présent et le passé ?
- Un parce que les champignonnistes et les barbeux ont énormément cloisonné le site à l’aide de murs. Ces murs ont été érigés afin de clôturer les propriétés et canaliser les courants d’air. Il en ressort que le Bon Dieu Noir est cloisonné en 34 blocs différents. Ces 34 blocs ne communiquent pas.
- Deux parce que des remblaiements plutôt récents ont annihilé certains sites d’exploitation. Ainsi, cinq exploitations sont totalement rayées de la carte et six le sont partiellement.
Donc du point de vue historique, oui évidemment c’était un grand ensemble. Or désormais nous avons affaire à une multiplicité d’exploitations plus ou moins accolées et parfois sectionnées.
Si l’on fait abstraction des murs de champignonnistes et si l’on ignore les remblaiements, nous estimons qu’il y eut sur le site du Bon Dieu Noir le nombre de 40 exploitations différentes. Cette estimation est basée sur les éléments de reconnaissance suivants :
- La forme des galeries : piliers tournés, mixte ou tout-catiches.
- Le diamètre des catiches, parfois fort différent.
- Les massifs non creusés, formant des murs de dissociation.
- Parfois, l’orientation générale de l’exploitation.
Evidemment, cette base d’analyse pourrait être contestée. C’est un ordre d’idée. On se doute bien que sans la preuve, c'est-à-dire la déclaration de carrière, le nombre peut aussi bien être 38 que 42. Dans tous les cas, la différence de nombre doit être assez faible.
Le plan de l’exploitation est basé sur une orientation générale du nord-ouest vers le sud-est. Globalement, de Loos village vers Wattignies, dans un ensemble assez bien en longueur.
L’ensemble comporte 2363 catiches et un nombre non négligeable de secteurs à piliers tournés médiévaux.
L’inventaire des sites souterrains
* L’épi de Soil.
Il s’agit de carrières en tout-catiches, lesquelles donnent une apparence d’exploitation récente. Elles sont à ce jour supprimées, vu la construction d’un canal imposant dédié aux eaux pluviales. Les sites totalisaient 61, 11, 4 et 65 catiches, pour un total de 141 catiches.
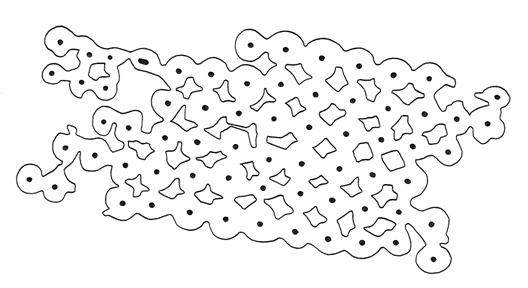
exploitation Epi de Soil 1
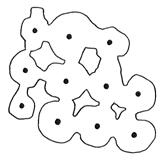
exploitation 2
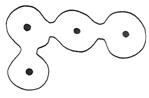
exploitation 3
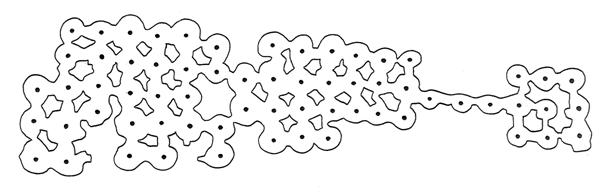
exploitation 4
* Non identifié, site à partir d’une carrière à ciel ouvert.
Les deux sites totalisent 31 catiches. Ce sont des carrières en tout-catiches qui n’appellent aucune remarque, si ce n’est qu’il est suspecté un creusement récent vu la forme des catiches. Le SDICS évoquant un plan d’archives, il est supputé que ces deux excavations n’existent plus. Tout laisse à penser que ces exploitations étaient situées dans l’actuel parc de nature et de loisirs de Loos.
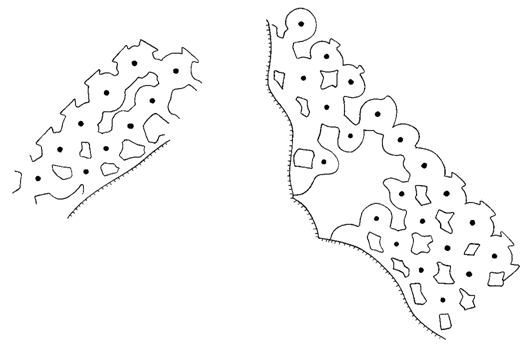
L’ancienne exploitation de la carrière à ciel ouvert
* Non identifié, site PTT.
Il s’agit d’une excavation située anciennement sur le site de l’usine Richter, « fabrique de bleu ». Nous n’avons retrouvé aucune trace de cette usine. D’après le plan d’archives, des fours avaient été montés dans les catiches. A ce jour, le site sous-mine (ou sous-minait ?) le garage du site de la direction régionale de la PTT de Loos. Nous ignorons tout d’un tel établissement. Serait-ce le chemin de la carrière d’Avesnes ?
Le site totalise 28 catiches.
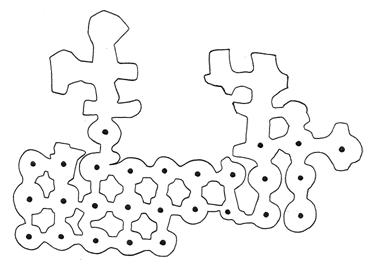
L’exploitation de l’ancienne usine Richter
* Rue Jules Vallès. Les sites totalisent 12, 11 et 138 catiches.
Ce sont deux petites exploitations, et un ensemble de deux vastes exploitations complémentaires. Le site de 138 catiches s’étire en deux excavations distinctes toutes en longueur et très bien ordonnées. Les sites sont à cheval sur le territoire de Lille. Le creusement est manifestement récent vu la forme des catiches.
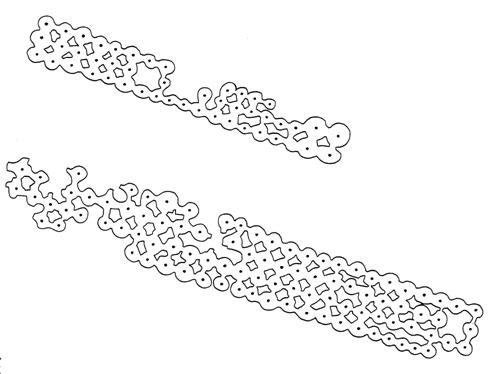
Les deux carrières de la rue Jules Vallès.
Un site secondaire
* Le chemin des Postes.
Il s’agit de plusieurs exploitations ; toutes affectent le chemin des Postes. Dans l’ensemble, ce sont soit des sites en mauvais état, soit en rémission (il y eut un certain nombre de comblements). L’un des sites, en tout-catiches, est imposant de par sa dimension.
Les sites totalisent 2, 14, 12, 56, 64 et 206 catiches, pour un total de 354 catiches.
Notons que l’un des sites comporte un secteur en piliers tournés et spécifiquement ce lieu pourrait correspondre à une exploitation notablement ancienne. Notons de surcroît que ce secteur ancien était non loin de communiquer à l’époque avec le site de la faculté de pharmacie de Lille, dont une partie est médiévale.
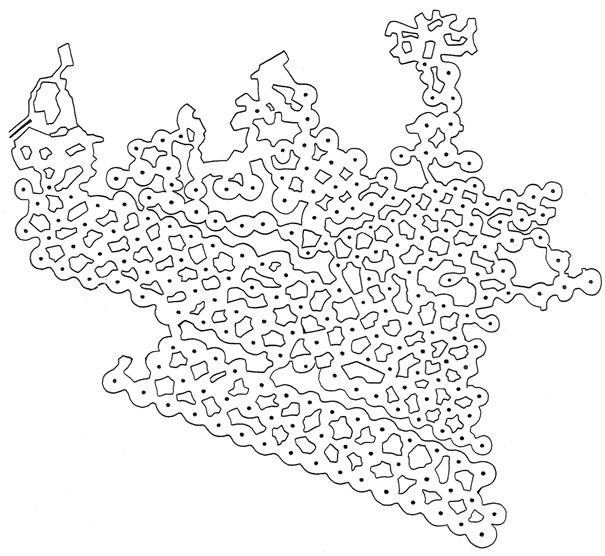
Exploitation 6
Nous ne connaissons pas de chemin d’Esquermes à Loos. Cette exploitation serait située sur le site d’Eurasanté, en territoire limitrophe avec Lille. C’est une petite exploitation en tout-catiches et une faible part en mixte. La datation pourrait être 1780-1800. Le site totalise 50 catiches.
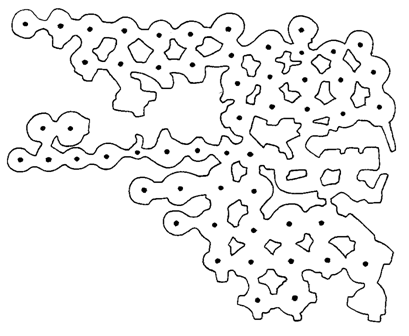
L’exploitation du chemin d’Esquermes
* Non identifié, chemin d’Avesnes.
Petite exploitation en tout-catiches, toute en longueur et très bien ordonnée. Le site totalise 43 catiches. Nous ne la localisons pas. Nous supposons que le nom fait référence au chemin de la carrière d’Avesnes.
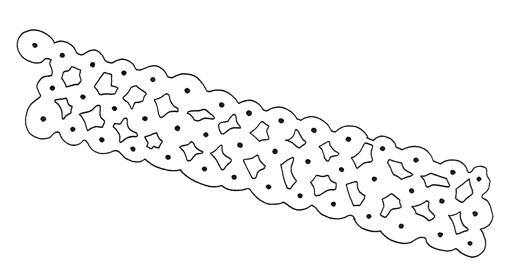
L’exploitation du chemin d’Avesnes
Les autres exploitations, si elles ne sont pas mentionnées ici, sont essentiellement celles de plans lacunaires. Soit les plans manquent soit ils étaient en mauvais état. En tout état de cause, une immense majorité des sites souterrains est très bien connue par topographies du SDICS.
* Le Bon Dieu Noir.
Le site totalise 2364 catiches.
Nous répertorions 9 exploitations médiévales en piliers tournés, 3 exploitations en mixte et 28 exploitations en tout-catiches. Le site est gigantesque, complexe et passionnant. Le plan ci-dessous reprend l’entièreté de l’exploitation. Vu le gigantisme, il n’est pas possible de faire plus lisible. De ce fait nous reprenons les lieux en annexe de ce document (dernières pages), en deux grandes planches distinctes.

Le Bon Dieu Noir, plan de la totalité de l’exploitation.
Du fait des champignonnistes, les 40 exploitations ne sont plus un seul volume. En effet, afin d’éviter les vols et surtout les courants d’air intempestifs, la carrière a été cloisonnée avec d’innombrable murs. Ce sont de fameux murs, épais de 50 cm à un mètre, élevés avec des déchets d’exploitation. Il en résulte que la visite des lieux est une véritable complication.
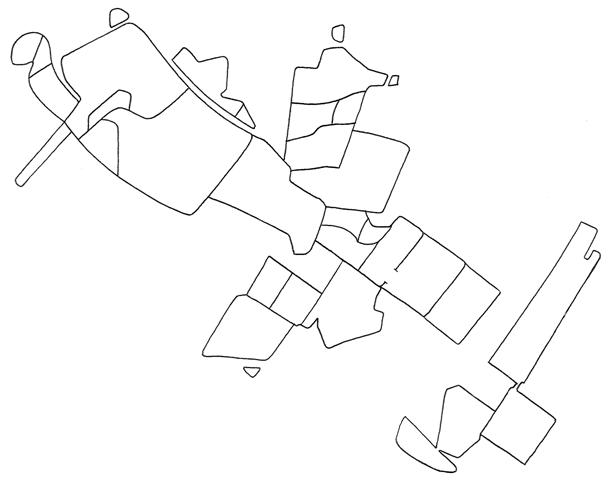
Le cloisonnement du site du Bon Dieu Noir, croquis.
Lorsque l’on considère le gigantisme de l’exploitation, des aspects frappants ressortent. En effet, le site du Bon Dieu Noir est une accumulation de style et d’époques. En aucun cas il serait possible de dire que c’est un volume uniforme – en tout cas ça l’est bien moins qu’à Lezennes. Cette situation donne une information très intéressante nous concernant : il nous est possible d’établir une chronologie de l’exploitation. C’est le document que nous proposons en page suivante.
Cette chronologie a été établie en tenant compte des aspects suivants :
- La forme des sites d’exploitation. Nous avons d’office considéré les piliers tournés comme étant anciens, étant donné que dans le Mélantois (et ce bassin d’exploitation uniquement, la situation n’est pas comparable ailleurs), les piliers tournés ont toujours révélé des excavations anciennes.
- L’emplacement des inscriptions, souvent datées, nous permettant certaines extrapolations ; il faut toutefois garder à l’esprit que des gravures récentes peuvent se trouver dans des exploitations anciennes, mais l’avantage de tout cela, c’est que l’inverse n’est pas possible et ça pour le moins, c’est une information intéressante.
- Nous avons considéré les techniques mixtes comme datant de 1700-1780, étant donné que dans les autres sites du Mélantois datés, cette fourchette est restée valable. Seule Lezennes est un ovni à ce sujet et il nous semble préférable de ne pas en tenir compte.
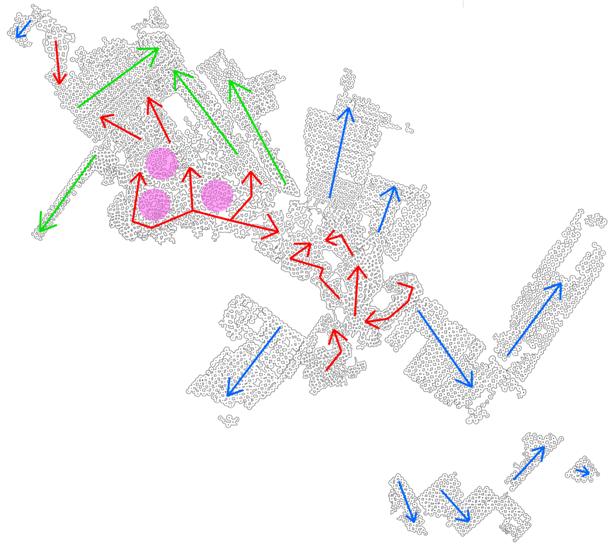
De ce croquis et cette estimation, il ressort les éléments qui suivent :
1) Au contraire de Lezennes, l’exploitation n’a pas été linéaire et uniforme. De multiples fosses sont ouvertes en même temps.
2) Plus particulièrement, nous relevons des centres d’extraction médiévaux aux ronds mentionnés en rose. Ces fosses sont ouvertes antérieurement aux travaux Vauban. Il est soutenable de dire que ces travaux sont XVème siècle. Il parait en contrepartie scabreux de les attribuer à la construction de l’abbaye Notre-Dame de Loos (XIIème siècle). En même temps, rien ne s’y oppose, mais il nous semble utile de préciser que nous ne disposons d’aucune preuve à dater le Bon Dieu Noir dans une période si précoce. Signalons à toutes fins utiles que l’abbaye n’est pas bordée d’une carrière à proximité immédiate.
3) Du Bon Dieu Noir, il ressort simplement que ce sont des travaux Vauban. Une large part des carrières est ouverte en vue d’extraire du moellon, destiné à l’érection des murs de la citadelle. Ces travaux sont mentionnés par les flèches rouges. Il est à préciser que le sens des flèches reste hautement hypothétique. Nous avons présupposé que les travaux anciens ont été agrandis. Pour autant, rien ne prouve que c’était le cas ! Des fosses indépendantes ont très bien pu être ouvertes. Disons au minimum que les secteurs couverts par les flèches rouges sont concernés. Il s’agit de travaux menés massivement dans la période 1667-1673.
4) Des extensions vont avoir lieu, symbolisées par les flèches vertes. Ce sont des travaux menés entre 1673 et 1780. Le rythme de l’exploitation commence à se tasser.
5) Les extractions liées à la chaux vont apporter un renouveau et de larges parts de travaux vont être menés vers le sud-est. Ces travaux sont symbolisés par les flèches bleues. C’est comme partout dans le Mélantois des volumes réguliers en tout-catiches, creusés à la hâte, ou de manière industrielle. Ces travaux sont imputables à une période bornée fin XVIIIème siècle et apparemment, 1925 concernant la dernière mise en exploitation.
De cette chronologie ressort la conclusion qu’il s’agit d’un creusement en dispersion. Il y a un effet de ruée vers l’or et une mise en exploitation fulgurante dans l’espace des travaux Vauban, en de nombreux points d’ouverture. Lors des travaux de confection des cadastres, les fosses ont disparu de la carte. Des extensions sont globalement réalisées dans un sens allant du nord-ouest vers le sud-est. Les périodes plus récentes sont des mises en exploitation des vides, avec la culture de la barbe ou du champignon. Les sites médiévaux sont manifestement anciens, mais peuvent difficilement être rapportés aux monuments locaux de l’époque. Une datation à la fin XVème siècle et/ou début XVIème siècle apparait prudente.
Les recherches généalogiques et historiques au sujet des carriers.
Loos possède un nombre faible d’inscriptions au regard d’autres lieux comme Faches ou Lezennes, ces derniers étant de vrais romans parfois. En contrepartie, signalons tout de même que Loos est très intéressante comparée à Lesquin, Wattignies ou Ronchin, secteurs identiquement de tout-catiches, où il n’y a pas un seul texte.
Comment nommer l’étude de ces inscriptions ? Serait-ce de la paléographie ? Cela semble imparfait. Eventuellement, nous pourrions appeler ça des études d’épigraphie, bien que ce qui nous intéresse n’est nullement l’écriture, mais bel et bien l’analyse du texte ancien. Est-ce simplement de l’archéologie ? Après tout, nous portons peu à peu à le croire. Peu importe. Ces textes révèlent des trésors : des noms, des dates, des situations historiques ou personnelles.
Les inscriptions présentes dans les diverses exploitations du Bon Dieu Noir sont les suivantes :
A – le roy de france l’an 1698 fu fait une général de tout ses solda
y faloy le nombre de 7 cenz 30 mille home
B – pense a la mor . 175..
C – Julien Bonvien 1663
D – Iesus Maria 1704 Aien panse A la mort
E – pense A la mort Laron 1706
F – prie dieu pour son Ame
achete cest terre par ignas du bois et
marie vienno sa fème 175..
de six de ho de beauran + 4 S consterre
G – 1732 ignace du bois
H – ignace du bois
antoine du bois
madeleinne cordonnie
amoureuse de
l’un et de l’autre
1721
I – fut fait pour … pourz 40 million de
bile banque. le roy de france fait
lA pay l’An
1713 morut lA…
l’an 1714 la piece de 48 patar
l’An 1722 valoit 10 gros
Le roy en tuteur A fait faire
de bile de banque de 15 # de cens
# mille # cacun portoi son Argen
A banque pour de bile
Ils on pre tout perdu
1721 le colsa valoi IV #
le ble 7# et 9#
J – ignas du BOIS 1717
K – Nicolas Bonvin de caryncri 7 n 1714
Nous proposons une analyse de chaque inscription.
A – L’année 1698, le Roi de France fut fait le général de tous ses soldats. Il fallut le nombre de 730.000 hommes.
Faut-il analyser cela comme un cours d’histoire, ou bien est-ce le témoignage d’un conscrit ? A notre avis, il s’agit plus d’un récit, car les conscrits n’avaient guère l’occasion d’échapper à la traque. Il s’agit visiblement de la période suivant le décès du roi Espagnol Charles II de Habsbourg et la crise de succession de la lignée des Habsbourg. En 1698, Le roi soleil voulut éblouir l’Europe, qui en ce temps de crise risquait de se coaliser contre lui. Il fit la recrue de 730.000 soldats d’après l’inscription. Nous ne pouvons retrouver trace de cette valeur exacte dans un document historique, mais seulement la mémoire d’une forte recrue de personnel militaire. La date est bien 1698 et non 1693, cette dernière correspondant à une période de grande famine.
Considérant la date, nous supposons que cela provient d’un carrier.
B – Il s’agit d’une inscription d’une personne qui pense à la mort. Ce terme se retrouve trois fois dans le souterrain. La date est de 1750 à 1759.
C – Julien Bonvien 1663. Les u sont recouverts d’un û ce qui signifie bien qu’il s’agit d’un u. Concernant le v, le doute existe et il pourrait s’agir de Julien Bonnien. La date est celle d’une mise en exploitation. Cette personne nous est inconnue, dans toutes les orthographes possibles.
D – Jésus Marie 1704, je pense à la mort.
E – Pense à la mort, Laron 1706. Deux ans après, les mêmes inscriptions.
F – Je prie Dieu pour son âme. Cette terre a été achetée par Ignace Du Bois et Marie Vienno, sa femme. 1750 à 1759, date non identifiée. Ensuite ça se corse : De six de ho de beauran + 4 S consterre. Nous ne trouvons pas de lecture possible.
Il s’agit d’un carrier, nommé Ignace Dubois, et qui écrit avec l’orthographe de l’époque. Il fut actif en tant que carrier de 1690 à 1732. De ce fait, toutes les dates 175x sont à mettre au conditionnel et sont probablement 173x, vu la forme des 3 de l’époque. Il note provenir de « Lo », qui est avec « Los » les deux orthographes de l’époque.
Son associé était Pierre Emblans, provenant du hameau d’Ennequin, ou plutôt « Ennequien » avec l’ancienne orthographe.
Ignace Dubois semble féru de petites histoires locales et nous supposons qu’il est l’unique auteur de toutes les inscriptions marquées au goudron, relatant des petits faits locaux. Ainsi, le journal « Le Nord » du 13 janvier 1914 relate la visite d’un homme au pseudonyme de Robsta, lequel a relevé les inscriptions complémentaires suivantes (nous ne les connaissons pas) :
- Une femme est morte à Lo ayant 22 enfants, son nom était …
- Un homme a brûlé sept fermes.
Le tout est accompagné des termes dépressifs : - Mes gins, priez pour nous.
Serait-ce là le témoignage du carrier Laron ?
G – 1732 ignace du bois
H – Ignace Dubois, Antoine Dubois. Madeleine Cordonnier, amoureuse de l’un et de l’autre.
Cette inscription de 1721 sent encore à plein nez les petits récits croustillants rédigés par Ignace Dubois. Notons que tous nous sont inconnus, donc ça n’aide pas à savoir si mariage s’est ensuivi !
I – Il fut fait pour 48 millions de billets de banque (et non 40). Le Roi de France fait la paye l’an 1712. L’an 1715 il mourut (et non 1713 car il s’agit de Louis XIV). La pièce de 40 patars (et non 48) valait en 1722 la somme de 10 Livres et 10 gros (le signe # signifie Livre). Le roi, ayant tuteur (il s’agit de Louis XV) a fait faire des billets de banque de 15 Livres, de 100 Livres, de 1000 Livres. Chacun portait son argent à la Banque pour des billets. Ils ont presque tout perdu.
1721, le colsa valait 4 Livres, le blé 7 Livres et 9 Livres.
Il s’agit de la triste aventure du banquier écossais John Law de Lauriston, sous le règne du Régent. Wikipedia précise à ce sujet (propos non vérifiés !) : Ce mois-là, plus d'un milliard de livres de billets de banque furent émis, et le capital de la banque se monta à 322 millions de livres. Cependant, la fin du système Law était proche. Les ennemis de John Law – parmi eux, se trouvaient le duc de Bourbon et le prince de Conti – poussèrent à une spéculation à la hausse dans le but de faire s'effondrer le système. Le prix des actions passa de 500 à 20 000 livres. Puis certains des plus gros possesseurs de billets commencèrent à demander à réaliser leurs avoirs en pièces d'or et d'argent, ce qui fit immédiatement s'écrouler la confiance dans le système
Dès le 24 mars, ce fut la banqueroute du système de Law. Les déposants se présentèrent en masse pour échanger le papier-monnaie contre des espèces métalliques que la société ne possédait plus. Plus personne n'eut confiance ; la banqueroute du système avait ruiné les déposants. En décembre 1720, John Law, ruiné, est obligé de fuir le royaume. Sous la protection officieuse du Régent, Law se réfugie à Venise.
Sacré Ignace Dubois, ce sont de bien rares récits ces cours d’histoire !
J – ignas du BOIS 1717
K – Nicolas Bonvin de caryncri 7 n 1714
Nous retrouvons un Bonvien, ou Bonvin, cette fois-ci sous le patronyme de Nicolas Bonvin. Il nous est totalement inconnu, nous supposons qu’il s’agit d’un carrier.
Le mot qui suit nous est inconnu.
Les carriers, carriéreurs et carrieurs de l’époque nous sont inconnus pour ainsi dire presque en totalité, vu le volume colossal exploité. Pour bien faire, nous devrions avoir une liste de 400 carriers. Il n’en est rien.
Cela conforte au minimum une hypothèse, forte au demeurant : la très grande majorité des exploitations était achevée avant l’obligation de déclarer les carrières, ce qui revient à dire que sur les affaires de 1800, l’exploitation était pour ainsi dire terminée à Loos.
En terme de déclarations de carrières, nous relevons 12 mises en exploitation, lesquelles sont détenues pour certaines par :
* Potier Léon, 1876.
* Deroller Louis, 1876.
* Denoyelle Florent, 1876.
Il est cité que tous les trois étaient liés au Sieur Pélicier, chaufournier.
* Monsieur Tournant-Leroy, 1913, qui gère deux exploitations.
* Dufermont Henri, 1925.
Notons encore que lors d’un mariage le 2 juin 1829 à Houplin-Ancoisne, un témoin du nom de Jean-Baptiste Lepot, 29 ans, se déclare comme carriéreur de pierres blanches à Loos.
Par la suite et bien plus tard, notons que les carrières furent utilisées assez massivement en tant que champignonnières et culture de barbe de capucins. Jusque dans les années 90, un exploitant barbeux était Monsieur Serlet. Jusqu’en ces dernières années, un exploitant barbeux était Monsieur Jean-Pierre Delebarre. Au fur et à mesure des décennies passant, la culture de barbe est devenue de plus en plus confidentielle.
La
culture de barbe de Monsieur Delebarre est située rue du Hameau d’Ennequin. Les
catiches ont toutes été désobturées et refermées avec des dalles de béton.
Le recensement de 1906
Dans le recensement 1906 de la population de Loos, nous nous attendions à avoir une foule de barbeux et de champignonnistes. Ce fut l’échec presque complet ! Il y a peu de champignonnistes. Quant aux barbeux, nous soupçonnons qu’il s’agit des maraichers et des cultivateurs. Mais comment en être sûr ? De ce fait, les enregistrements sont réduits à peau de chagrin.
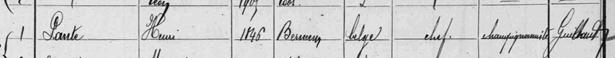
Laute Henri, né en 1864, champignonniste chez Guilbaut de Lille. Il s’agit de l’établissement de Monsieur Guilbaut-Mathieu, classé comme étant champignonniste à Lille. Nous le localisons quant à nous dans le Bon-Dieu-Noir. Nous relevons en effet dans une archive (bien du style romantique de l’époque le court texte suivant : nous voici sortis de Lille pour aller… : oh, pas bien loin, à Loos et à Ennequin visiter les anciennes carrières de blanc transformées en champignonnières par M. Guilbaut-Mathieu.
![]()
Lis Paul, né en 1877, champignonniste chez Guilbaut de Lille.
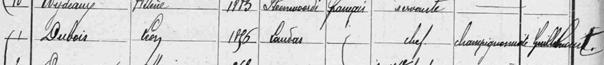
Dubois Léon, né en 1876, champignonniste chez Guilbaut de Lille.
![]()
Deconninck Eugène, né en 1848, champignonniste chez Guilbaut de Lille.
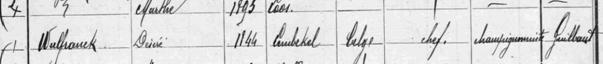
Wulfranck Désiré, né en 1844, champignonniste chez Guilbaut de Lille.
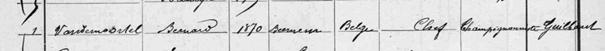
Vandemortel Bernard, né en 1870, champignonniste chez Guilbaut de Lille.
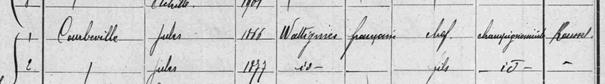
Courbeville Jules, né en 1846, champignonniste chez Roussel. Son fils, même nom et même emploi, né en 1877.
![]()
Rogier Achille, né en 1884, champignonniste chez Crombet à Faches.
Conclusion
Le fait que Loos est représentée en assez large partie par des travaux Vauban reste indéniablement une surprise. Nous nous attendions à des travaux récents liés à la chaux sucrière, comme dans de nombreuses catiches du Mélantois. Il est simplement à conclure que le site d’extraction de Lezennes ne suivait pas par rapport au caractère impérieux des travaux menés à la citadelle. Le site de Loos est moins connu – bien qu’étant d’ampleur – étant donné qu’il sous-mine des champs et que la refermeture des travaux a été précoce. En tout cela, Loos représente un territoire dont l’étude est bien loin d’être achevée.
ANNEXES (deux pages suivantes)

Le Bon Dieu Noir, planche 1

Le Bon Dieu Noir, planche 2

Lille, les dernières catiches
Lille est une annexe des catiches du Mélantois. Cela forme quelque part une étrange affirmation, car on aurait tendance à croire la capitale se révéler le moteur. En réalité, Lille n’est que le commanditaire des moellons. Ce n’est que lorsque l’offre n’a plus suivi la demande qu’un réel essor des carrières lilloises a eu lieu. Le point sur la question en quelques mots.
Le territoire de Lille est affecté par un certain nombre de carrières souterraines. Elles ne sont pas à traiter à part, étant donné que très peu d’éléments les distinguent des frères et sœurs du Mélantois. De ce fait, nous en donnons une description au même titre que les monographies réalisées sur les communes du Mélantois. Nous n’en disposons pas des plans. De ce fait, nous serons réduits à réaliser une étude succincte.
Ce qui les distingue du Mélantois :
- Elles sont toutes à faible profondeur, du fait d’une nappe phréatique présente en niveau assez haut.
- Elles sont toutes d’un petit développement, la craie étant assez souvent de moins bonne qualité.
Ce qui ne les distingue pas du Mélantois :
- On retrouve un panel varié de carrières, lesquelles sont médiévales ou récentes, en piliers tournés, en mixte ou en tout catiches. Dans tous les cas de figure, elles possèdent un aspect proche des carrières souterraines du Mélantois.
- Globalement, ces carrières sont à considérer comme des extensions géographiques de grands sites existants, tels que Faches et Loos. En effet les carrières de Lille se situent toutes dans un vaste croissant situé au sud : Lille-Sud essentiellement, Moulins, Faubourg de Béthune et Wazemmes accessoirement. Il ne se trouve aucune exploitation à Saint-Maurice ou en Ferrain.
A l’exception du site médiéval de la faculté de pharmacie, tous les sites sont d’une exploitation relativement homogène. Ce sont à ce titre des exploitations la plupart du temps en mixte-catiches. Au sein de la construction de la citadelle de Lille, les villes de Lezennes et Loos n’arrivaient plus à suivre. C’est ainsi que Lille a tenté de palier, à faible échelle, afin de fournir autant de craie que possible à Vauban, qui ne cessait de s’impatienter. Dès lors, la majorité des carrières date de 1668-1671. Quelques-unes semblent malgré tout liées à de l'activité de chaufournier.
Nous allons inventorier les sites qui nous sont connus. Cet inventaire est plus une liste qu’une réelle monographie. La raison est que ces ensembles souterrains nous sont quelque peu méconnus.
LI-1 : Cette carrière est située rue Elsa Triolet. C’est un tout petit volume d’exploitation.
LI-2 : Cette exploitation est située sur le site Centraco, présent au sud de la rue de Cannes et à l’est du chemin des Postes. En cette localisation, cette exploitation forme une parfaite prolongation des exploitations connues à Loos, notamment sur le chemin des Postes. De Loos, elle n’est pas séparée par un massif de non-exploitation. Ce sont seulement des remblais (récents) qui fractionnent le site.
LI-3 : Il s’agit de la plus belle exploitation lilloise, à ce titre emblématique. Cette carrière est située sous la faculté de pharmacie, rue Paul Doumer. Ce vide souterrain est immédiatement attenant à Loos et considérant les vides d’exploitation situés à l’Epi de Soil, l’ensemble est difficilement dissociable. A ce titre d’ailleurs, une petite moitié du volume excavé à la faculté de pharmacie se situe administrativement parlant sur le territoire de Loos.
La carrière de la faculté de pharmacie est compliquée à décrire, car plusieurs aspects sont conjugués. D’abord, citons la présence, à l’est, d’une vaste carrière médiévale. Elle est entièrement en piliers tournés. Elle forme un grand maillage de galeries sinueuses. Il n’y a que peu d’équivalents dans le Mélantois pour une telle dimension : citons les exploitations de la rue Kléber à Faches et certains quartiers du Lezennes médiéval. La partie sud de la carrière de la faculté de pharmacie a subi du remblaiement, lors de l’installation de cuves d’une station essence. A ce jour, ladite station n’existe plus.
Sur le flanc ouest, la carrière est creusée dans un tout catiche soigné et aligné. On se croirait pour un peu sur le site de la Croisette à Faches. Cette carrière n’est connue que par plans anciens, car Tout laisse à penser qu’un remblaiement précoce de toutes les catiches a eu lieu avec des remblais. En tout état de cause, ce site n’est pas visitable. A une certaine époque, le volume en tout catiches jonctionnait le réseau médiéval. Cet impressionnant réseau, clairement dissocié en deux parties distinctes, est le plus vaste sur le territoire de Lille.
Citons pour simple mémoire que de nombreuses très petites carrières sont situées au nord de la précitée, et donc face à la carrière Centraco.
LI-4 : C’est une des nombreuses exploitations située à proximité immédiate du CHRU. Nous ne donnons pas bien cher de l’avenir de telles exploitations, localisées en plein centre urbain ; le remblaiement complet est une affaire devenue peu à peu inéluctable. Géographiquement, ce type d’exploitation représente plus ou moins une extension du vaste ensemble du Bon Dieu Noir à Loos. Autour de cette exploitation nommée LI-4 se trouve ce que nous avons regroupé sous la dénomination LI-5, à savoir quatre très petites exploitations éparses. L’une de ces dernières a été comblée en mai 2014. Si l’on cumule tous ces sites souterrains, cela constitue un joli volume.
LI-6 : Cette exploitation se situait rue des Coquelicots. Elle a été totalement comblée lors d’un vaste projet immobilier.
LI-9 : Il s’agit d’une petite exploitation située rue Balzac.
LI-10
: Cette exploitation au contour flou nous concernant se trouvait à proximité du
Cimetière du Sud. Elle a été totalement comblée suite à des projets immobiliers
conséquents.

Le plan d’exploitation de la faculté de pharmacie.
LI-7 : Une exploitation souterraine a été trouvée à proximité de l’école Turgot, rue du Faubourg des Postes. Cette exploitation ancienne a d’ailleurs posé des problèmes lors de la construction de l’école Turgot. Elle fut découverte de manière fortuite. De ce fait, la structure du vide souterrain a été consolidée avec des murs en briques.
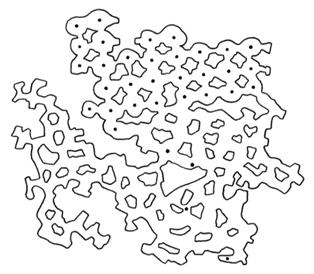 L’exploitation
de l’école Turgot.
L’exploitation
de l’école Turgot.
LI-8 : Cette zone comporte quelques petits vides souterrains éparpillés, globalement situés rue Courtois et au croisement de la rue du Four à Chaux. Il ne serait pas étonnant que ce fut le site d’un four à chaux, comme le nom de la rue en témoigne. Nous sommes dans une extrémité nord du bassin d’excavation. Les sites d’extraction situés plus au nord que les Portes de Lille semblent tout à fait exceptionnels (ce qui est le cas, apparemment unique à présent, de Wazemmes).
LI-11 : L’excavation est située sous la rue Paul Bourget. C’est un minuscule site d’extraction qui forme une prolongation géographique des deux carrières Faches-Thumesniloises de la rue du Faubourg d’Arras. Dire que ce site est lillois, c’est une vue administrative. Le site ne se distingue en rien des exploitations de Faches.
LI-12 : Cette exploitation se trouve sous la rue Vaisseau le Vengeur. Il en va de même que pour la LI-11, où nous voyons en cette carrière une extension des réseaux souterrains de Thumesnil. Signalons le fait assez rare que des vestiges existent en cette carrière. Des réfugiés y ont logé durant la seconde guerre mondiale. Les individus ont accroché des panneaux avec leurs noms aux parois, de manière à se réserver un espace.
LI-13 : Un site existait au croisement des rues de l’Asie et Paul Parisot. Cette exploitation a été totalement comblée suite à un projet immobilier d’envergure.
LI-14 : Il s’agit de la carrière de la rue Godefroy Cavaignac. Elle est globalement à rattacher au bassin d’extraction de Loos.
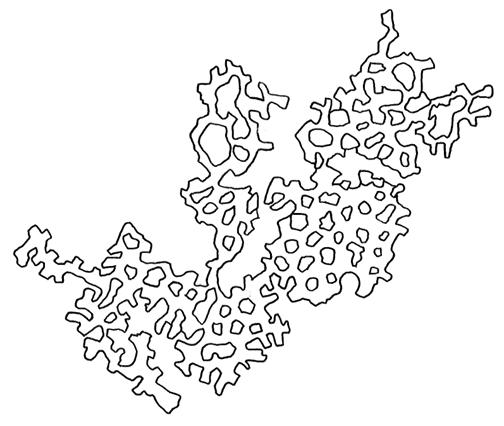
La carrière de la rue Godefroy Cavaignac.
Nous inventorions de ce fait plus ou moins 14 sites souterrains, se subdivisant parfois en plusieurs minuscules réseaux. Notons qu'il existe des catiches près des tours Vallès et Gide. Comme elles sont majoritairement situées sur le territoire de Loos, nous les avons documentées en cette monographie. Avec ces deux là, le total est de 16. Les carrières se sont toujours trouvées dans des zones non urbanisées à l'époque : champs, prairies. C'est l'urbanisation galopante qui a provoqué l'émergence d'un habitat au-dessus des catiches. Contredisant un énième article de presse bâclé, précisons que les carrières lilloises ne permettent pas de rejoindre Lezennes. Les secteurs de jonctions sont établis sur le territoire d'Hellemmes, encore que, c'est devenu inexact de nos jours car une grosse ligne de remblais interdit toute jonction.
Bernard Bivert n’établit pas d’estimation du nombre de catiches lilloises et le volume correspondant. Etant donné que ça a un aspect assez proche de Seclin, nous estimons que cela doit approcher les 200.000 mètres cubes. La ville de Lille évoque 16 carrières inspectées régulièrement et 1503 puits d’exploitation et catiches à ausculter.